HÉLÈNE DUCCINI Faire voir, faire croire
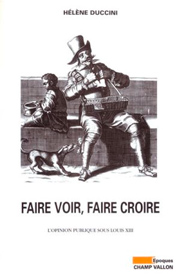
Hélène Duccini propose une histoire inédite du règne de Louis XIII: un parcours à partir du « quatrième pouvoir » que constitue l’arme de la propagande et de la communication.
Informer et convaincre, informer pour convaincre : l’époque de Louis Le juste et de Richelieu, âge de la raison d’État, est marquée, en effet, par un développement méconnu de l’information politique, de la publicité royale et de la contestation qui envahissent la rue et la place publique. Ses supports en sont les pamphlets, petits opuscules de quelques pages, concurrencés, à partir de 1631, par La Gazette, l’hebdomadaire de Théophraste… (lire la suite)
HERVÉ DRÉVILLON Lire et écrire l’avenir

Le thème central de ce travail est la disqualification de l’astrologie au XVIe siècle. Alors que, traditionnellement, cette disqualification est expliquée par les effets conjugués de la révolution scientifique et de la Contre-Réforme, l’auteur cherche à montrer que ce n’est pas tant le savoir que la littérature astrologique qui a été visé. Déplaçant ainsi la problématique, il relève l’importance des raisons sociales et politiques qui marginalisent cette science que la Renaissance adorait et qui n’a jamais été véritablement réfutée par la science du XVIIe siècle.… (lire la suite)
ROBERT DESCIMON, JOSÉ JAVIER RUIZ IBANEZ Les ligueurs de l’exil
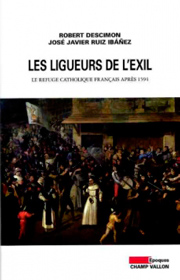
En 1585, à la mort du duc d’Anjou, frère d’Henri III, l’héritier du trône devint le roi de Navarre (futur Henri IV), chef du parti protestant. Après un quart de siècle de guerre civile, cette perspective était inacceptable pour les catholiques radicaux. Ils formèrent une Ligue, que dirigeaient les Guise, d’où le nom de ligueurs que l’histoire leur a attaché. Mais ce fut Henri IV qui remporta la victoire militaire et politique, au prix, il est vrai, de sa conversion au catholicisme.
Alors, en 1594, certains de ces ligueurs choisirent l’exil plutôt que de vivre sous l’autorité d’un « hérétique relaps ». Ils étaient si attachés à une conception… (lire la suite)
VINCENT DENIS Une histoire de l’identité
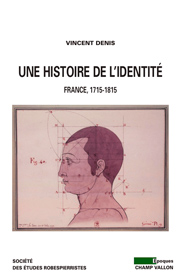
Comment établir l’identité d’une personne à une époque où n’existe ni photographie, ni empreinte digitale, ni même état civil fiable? Entre la Régence et la Restauration, la France a été le siège d’une révolution silencieuse d’une ampleur jusqu’à présent insoupçonnée: la naissance de l’identité individuelle, une «identité de papier» fondée sur le registre, le certificat, le passeport: les soldats, les mendiants, les vagabonds, les criminels furent les premiers à être «fichés». Avant que l’ensemble de la société ne soit, à son tour, «identifiée».
Quels sont les instruments de cette identification de la personne? Les techniques et… (lire la suite)