GILBERT HOTTOIS Entre symboles et technosciences
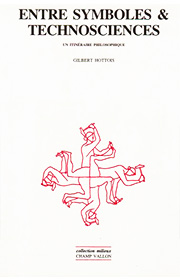
Le rapport, traditionnellement de symbolisation, de l’homme à son espace, au temps et à lui-même, a été modifié par la science contemporaine, plus proprement appelée technoscience, pour devenir plus opératoire, faisant surgir la question de l’articulation de l’opératoire (les technosciences) et du symbolique (les cultures et les traditions), y compris la philosophie elle-même en tant qu’activité symbolique. Cette problématique connaît actuellement une acuité maximale à propos des technosciences biomédicales et est à l’origine de l’intense affairement éthique – «bioéthique» et «biopolitique»… (lire la suite)
A. GUILLERME, A.-C. LEFORT, G. JIGAUDON Dangereux, insalubres et incommodes

Le paysage industriel n’est pas le fruit de la nécessité. L’État intervient dès 1806 pour protéger la capitale des nuisances – olfactives et visuelles – générées par l’artisanat et la toute nouvelle industrie. Généralisée à tout l’Empire en 1810, l’enquête préalable à toute nouvelle implantation, dite commodo et incommodo, est le premier manifeste du développement durable, entre l’économique, le social et le politique. Le décret du 15 octobre 1810 gère ainsi la géographie des manufactures parisiennes: les plus dangereuses sont chassées du centre et vont essarter les faubourgs, alors que les quartiers aisés et les communes résidentielles… (lire la suite)
ANDRÉ GUILLERME La Naissance de l’Industrie à Paris

Pour devenir capitale industrielle de l’Europe continentale, Paris développe entre 1780 et 1830 deux révolutions techniques. La première, biochimique, se déploie grâce à l’humidité ambiante et à la fermentation des matières organiques qui imbibent le sous-sol et la nappe phréatique : la capitale est la principale productrice de salpêtre et assure ainsi près du tiers des besoins en poudre. Peaux, graisses, os, sang, grains, chiffons, poils, verre, ferraille, cendres, ces matières brutes sont collectées, triées et transformées en atelier pour devenir des matières premières de haute valeur travaillées par le corroyeur, le hongroyeur,… (lire la suite)
ANDRÉ GUILLERME Bâtir la ville

Les visages de la ville industrielle apparaissent dès la Restauration grâce à la mise en œuvre de nouveaux matériaux – chaux hydraulique, ciment artificiel, mâchefer, zinc, bitume, goudron – et aux performances nouvelles exigées des matériaux courants – bois, pierre, fer, plâtre, brique –, grâce à de nouvelles techniques plus mécanisées – éclairage au gaz –, plus rationnelles – alimentation en eau -, plus technologiques, plus exigeantes quant à l’emploi de la main-d’œuvre et qui bouleversent le savoir et l’organisation des métiers traditionnels. L’élaboration de ces matériaux est en France principalement… (lire la suite)