BERTRAND TILLIER Les artistes et l’affaire Dreyfus
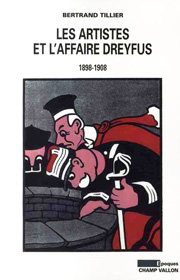
L’affaire Dreyfus a favorisé l’avènement de la figure de l’intellectuel et de ses modes d’intervention dans la vie politique. Assimilés à cette catégorie, les peintres, sculpteurs, graveurs et autres producteurs d’images ont joué un rôle décisif dans le cours de l’Affaire, où leur magistère a été symétriquement revendiqué par les dreyfusards et les antidreyfusards.
Ce livre propose d’interroger les rapports spécifiques de la communauté des artistes et de leur œuvre avec cette crise politique et morale majeure, qui avait jusqu’alors peu retenu l’attention de l’historiographie. Les calculs de Rodin, la frilosité de Maurice Denis,… (lire la suite)
BERTRAND TILLIER La Commune de Paris

Aucune révolution n’aura entretenu de relations aussi compliquées avec ses images, ses représentations et ses artistes, que la Commune de Paris — dès 1871 et jusqu’à la veille de la Grande Guerre. Qu’il s’agisse de peintures et de sculptures, de photographies et de gravures de presse ou encore de caricatures, étudiées dans cet ouvrage, l’image produite en regard de la Commune paraît en permanence échouer à représenter les événements du printemps 1871, sur le vif comme à retardement, au plus fort de l’événement comme dans sa mémoire. La Commune semble toujours parvenir à se soustraire à sa représentation, tant chez les artistes favorables… (lire la suite)
ANN THOMSON L’âme des lumières

Cet ouvrage aborde d’un point de vue original la période de la « crise de la conscience européenne » et son prolongement jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Il prend comme fil conducteur l’émergence d’une conception laïque et matérielle de l’être humain, problématique au cœur d’aspects clés des Lumières. En suivant les différents moments du débat autour de l’âme humaine — qui touche au fondement de la doctrine chrétienne —, il étudie les polémiques théologico-politiques de cette période dans lesquelles s’insère ce débat.
La première partie, consacrée à l’Angleterre après la Glorieuse Révolution, analyse les luttes idéologiques et religieuses… (lire la suite)
ALAIN THILLAY Le faubourg Saint-Antoine et ses «faux-ouvriers»
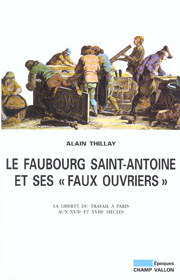
« Tout Paris sera le faubourg Saint-Antoine : point de talent, point de solidité, beaucoup d’intrigues, nulle réalité dans les fortunes, point de confiance qui n’est attachée qu’à un établissement solide ». Alors que Turgot propose d’abolir les corporations de métiers en février 1776, les maîtres boutonniers parisiens stigmatisent le faubourg Saint-Antoine et ses artisans. Dans cet espace périphérique constitué au xviie siècle, la monarchie a en effet privilégié l’installation d’artisans de tous horizons en dérogeant à l’organisation des communautés de métiers, laissant les coudées… (lire la suite)