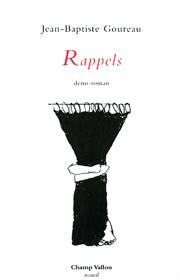Sous le fracas des applaudissements, les comédiens s’inclinent à la perpendiculaire, remplis d’alarmes: « Ces gens ont-ils vu ce que j’ai essayé de montrer? Est-ce qu’ils s’en souviendront une fois rentrés chez eux? et plus tard, dans un an? dans trente ans? Après ma mort? »
Quant aux metteurs en scène que l’on tire des coulisses lors des premières, ils saluent avec défiance: « Me suis-je fait comprendre? Saurai-je un jour jusqu’à quel point j’existe pour le public? Qu’est-ce qui peut bien lui passer par la tête? »
Le battement des mains empêche de scruter l’expression de ces visages de spectateurs, opaques même aux lumières, comme si des masques les dissimulaient: feu et passion en apparence, mais, qui sait? au dedans secs,ou moqueurs, ou absents.
En voici donc un qui s’extrait du noir, l’esprit occupé à renouveler ses souvenirs: le spectacle de ce soir, Beckett, Thomas Bernhard, Antoine Vitez, la Grèce, une actrice d’Ariane Mnouchkine, et, dans le va-et-vient desnoms, toujours Stendhal et La Chartreuse de Parme.
Jean-Baptiste Goureau participe à la revue Le Nouveau Recueil (Champ Vallon). Pendant cinq ans, il y a tenu, sous le titre de Rappels, une chronique trimestrielle consacrée aux relations de la mémoire, du théâtre et de la littérature. Rappels / demi-roman est son premier livre.
Le dessin de couverture est de Valérie Églès.
Lire un extrait
«A faute de mémoire naturelle j’en forge de papier.»
Montaigne, Essais, III, 13
I
Que reste-t-il du théâtre hors du théâtre? La représentation est d’essence volatile, éthérée, «éphémère», pour employer le vocable à la mode. Délébile et délétère. Une émanation d’épithètes.
Aussi le spectacle ne prendra-t-il de substance que par le désir de se le remémorer; le spectacle ne sera rien sorti du souvenir qu’il laisse; le spectacle sera ce que je me rappelle.
Bérénice montée par Klaus Grüber à la Comédie-Française, il y a neuf ans: à chaque acteur sa zone. Dans une cuirasse de bronze, la pourpre sur les épaules, Richard Fontana (Titus) évolue côté cour, dans un espace renfoncé en arc de cercle, éclairé verticalement par un puits de lumière; une sphère de pierre aussi haute que lui, vue de la salle, occupe l’arrière-plan. Je me suis dit que c’était l’espace de la Loi. Fontana parle le vers: il multiplie les coupes expressives, les accélérations, les apocopes. Il ne tient pas en place. Côté jardin, dans une robe de soie blanche ajustée, Ludmila Mikaël (Bérénice) glisse latéralement le long d’un couloir proche de la fosse, contre un mur où palpite le rideau d’une porte faite d’un voile oriental. Elle chante le vers: ce lamento accompagne sa danse-pâmoison jusqu’à la frontière qui sépare les amants et au-dessus de laquelle ils s’étreindront une fois. Entre-deux, en avant-plan, quasi immobile, cheveux longs noués en une queue de cheval partant du sommet du crâne, robe de guerrier nomade, Marcel Bozonnet (Antiochus) déclame le vers: son parler-chanter rapproche les dictions de ses partenaires, les lie, les mêle dans une inéluctable exténuation: Hélas!
Antoine Vitez: «Chacun de nous porte en soi un musée imaginaire du théâtre, fait des spectacles que nous avons le plus aimés. Et comme on voudrait bâtir un théâtre qui donnerait vie à ce musée, hélas irrémédiablement enfoui dans la mémoire! Ce qui reste, c’est la mémoire de l’événement, et de son effet sur la vie des gens. Naturellement, cette mémoire est changeante, contestable, diverse, d’un témoignage à l’autre, et plus encore quand il s’agit de la mémoire reconstituée, celle que l’on a des événements qu’on n’a pas connus soi-même (ainsi je me souviens de la Commune de Paris, comme je me souviens du jeu de Rachel), et qui nous est autant nécessaire que la mémoire directe, car il faut bien se faire une famille, des ancêtres… Surtout quand on n’en a pas.»
De peur d’arriver en retard, nous avons couru sous la pluie depuis la station de métro. Le T. E. P. donne la dernière mise en scène de Jacques Lassalle pour le Théâtre national de Strasbourg (avant qu’il ne succède à feu Vitez au poste d’administrateur de la Comédie-Française). Deux actes de Molière: Sganarelle ou le Cocu imaginaire et Le Mariage forcé. Éblouissement. J’avais retenu des précédents spectacles (Remagen, La Locandiera, Tartuffe) l’influence de mon cher Bresson, un zèle pour le dépouillement, le goût des coulées de lumière, du gris-clair, de la poésie du quotidien. Je découvre ici un art paradoxal du détail, à travers lequel des corpuscules de la représentation se singularisent les uns des autres en un halo de significations distinctes. Ce Sganarelle est joué dans une boîte en bois modulable. L’espace est empli par les acteurs, leurs brèves courses, leurs mouvements, leurs regards. Enfin Sganarelle se retrouve face à lui-même. La lumière a décliné. Les noirs et les ocres dominent. Olivier Perrier baisse la voix d’un ton, se dirige à pas sûrs côté cour, près de la rampe, s’accroupit, soulève une planche, et hisse de la cache, à l’aide d’une cordelette, un plateau chargé d’une bouteille et d’un verre. Côté jardin, le vin coule de l’une à l’autre dans le tempo du phrasé. Les gestes entraînent les paroles. Cette parodie de monologue s’efface derrière une méditation sur le cocuage et la poltronnerie qui empêche de s’en venger. À chaque revirement de décision, l’acteur porte à ses lèvres la robe écarlate du verre (sans boire). Cinq fois il laisse retomber son bras. L’inflexion se teint d’une sorte de rêverie comique, comme si Sganarelle s’étonnait de se voir Sganarelle et se demandait ce qui l’y forçait. Le temps s’est dilaté à l’infini du point de fuite. Olivier Perrier tresse doucement ensemble humiliation, malepeur, tristesse, amertume de n’être que soi. Mes pensées s’échappent dans l’aspiration de ce début de roman.
Avec Bernard Dort a disparu, le mois de mai dernier, un musée imaginaire sans égal. Outre que son conservateur incarnait la précieuse espèce du témoin de bonne foi, il répertoriait en son esprit l’intégralité du théâtre français et continental depuis l’immédiate après-guerre. Cinquante années de mémoire qui lui permettaient, particulièrement ces derniers temps, dans sa critique radiophonique ou les notes libres de La Pratique du spectateur, la mise en relation des spectacles du présent avec ceux du passé, en une totalité à la fois objective et imprégnée de la conviction que celle-ci n’existait que par le regard porté sur elle. Jusqu’à la fin, Bernard Dort avait su trouver sa place dans toutes les salles d’Europe (y compris lorsqu’il monta sur scène). Lui seul évitait le journalisme, lui seul était en position de formuler ce qu’il avait vu, entendu, compris, lui seul se ressouvenait.
L’élément humain constitue l’inconnue de la représentation. À quelque degré de précision qu’atteigne l’écriture dramatique, si rigoureux soit le dispositif de mise en scène, on pourra compter sur le comédien pour tout remettre en cause. Un beau soir vous croyez avoir ouï Firmin prononcer Vieil as de pique!, et vous voici à vous colleter avec votre voisin de siège. La mémoire du théâtre se nourrit de hasards et d’accidents. Sans une bourde, qui aurait entendu parler du grand Hègélochos, tragédien fétiche d’Euripide, vedette à gros cachets des Dionysies? Aristophane l’a immortalisé dans les Grenouilles:
exesti th’ôsper Hègélochos hèmin légein.
ek kumatôn gar authis au galên orô.
(Nous pouvons dire comme Hègélochos:
«Au sortir des flots je vois l’embellette.»)
La langue avait fourché au malheureux: scandant un vers d’Oreste, il avait articulé galên («belette») au lieu de galèn («embellie») pour la joie d’un public peu charitable. Sa carrière ne s’en était pas relevée. Du coup, grâce à la citation d’Aristophane, l’incident infime s’est ciselé dans l’airain. L’altération du texte s’est transmuée en texte. Cette inflexion d’une seconde a volé par-dessus deux mille cinq cents ans d’oubli avant de tomber dans notre oreille.
Deux jeux pour un même rôle, celui de Léontès dans le Conte d’hiver. En novembre, au théâtre d’Aubervilliers, l’acteur anglais de la Royal Shakespeare Company crie sans discontinuer: on ne saura jamais pourquoi Léontès se veut trahi par sa femme et son meilleur ami. Pendant que ses compagnons de troupe, consternés, le contemplent bras ballants, il crache à la rampe une rage incompréhensible. En janvier, au théâtre de Gennevilliers, sur le bord du plan inclinable inventé par Stéphane Braunschweig, Pierre-Alain Chapuis se déplace avec hésitation. Il nous épie comme à la dérobée, et les paroles qui peu à peu persuadent du pire sont portées par un murmure désinvolte crevé de petits gloussements. La voix monte à l’aigu devant l’image qui se précise (les Cornes), et devant le traditionnel costume qui lui pend au nez (le Cocu). Il suffit de l’exactitude d’un phrasé liant dramatique et farcesque pour que l’obsession funeste du personnage à l’affût de son propre malheur me paraisse aveuglante de clarté: plutôt l’horreur de la tragédie que la risée de la comédie. Plutôt monstre que pitre. L’intonation nous a fait entendre le chevauchement des deux possibilités.
Pourquoi ai-je employé le présent? La mémoire des spectacles me semble à la fois actuelle et intemporelle, ou plutôt simultanée. La trame qu’elle impose ne fond pas les motifs, pas plus qu’elle ne les unifie. Je me souviens par bribes. Mon esprit extrait des séquences du spectacle, non sans lui consentir des pertes énormes. En ce sens, la représentation théâtrale ne constitue qu’une hyperbole de l’œuvre littéraire. Dans En lisant en écrivant, Julien Gracq se demande quelles images il a retenues de la Chartreuse – et bizarrement, à son insu, les épaves qu’il recueille du «naufrage» (la descente de l’armée à Milan, Waterloo, les rives du lac de Côme, la Tour Farnèse, les oiseaux de Clélia, l’évasion, le prince de Parme « – avec l’aide du film», l’orangerie du palais Crescenzi) diffèrent assez peu, comme l’a signalé Michel Charles, de celles relevées par Proust dans le Contre Sainte-Beuve. De deux choses l’une: soit le texte, la représentation programment par avance leurs propres morceaux choisis, et les sélections de la mémoire ne sont que des vérifications; soit, en exposant une expérience de lecteur ou de spectateur, il s’agit de tenir compte de ce qui l’ourdit, la complique, la transforme. Ainsi, sous la plume de Julien Gracq, La Chartreuse de Parme devient inséparable du Contre Sainte-Beuve comme Stendhal de Proust: à notre tour de rallonger cette «mémoire critique» en lui cousant les page arrachées d’En lisant en écrivant, d’Introduction à l’étude des textes, et de bien d’autres encore… Dans les deux cas, au demeurant, la Chartreuse, d’œuvre figée, se fait soudain, entre les mains de qui se la remémore, matière souple, élastique, conductrice. Mais, qu’il existe un monument (le livre), ou non (le spectacle), tout n’en subsistera pas dans notre esprit à part égale. Contre ce morcellement, nul réseau ni entrelacs n’armera l’ensemble. Il n’est pas d’étoffe si forte qui ne se puisse tailler en lambeaux. Nous rappelant la Chartreuse ou la Bérénice de Grüber, nous recomposons une variante.
Quel est mon premier souvenir de théâtre? J’ai sept ou huit ans, et mes parents m’ont emmené voir le 1789 du Théâtre du Soleil. Je me rappelle malaisément les courses des bateleurs en bas, dans la salle, car le spectacle a basculé avec le récit de la Prise de la Bastille. Les acteurs montent dans les gradins, et chacun raconte de son point de vue. C’est une comédienne échevelée, peut-être blonde ou châtain, vêtue d’un jupon cerise et d’une chemise blanche délacée, qui conte à ma travée son épopée: les sommations, le ralliement des «gardes françaises» (le nom sonne de façon étrange), les vagues d’assaut, les déflagrations, le parfum de la poudre, un vieillard qui tombe, un enfant «étoilé de sang». L’indignation et l’exaltation font rouler ses seins nus hors de sa chemise par houles saccadées. J’entr’aperçois régulièrement leurs fraises sombres qui se détachent sur la poitrine blanche. Je sais déjà que je ne l’oublierai pas; je ne sais pas que je ferai tout pour connaître à nouveau un tel moment. À quoi tient l’amour du Théâtre?