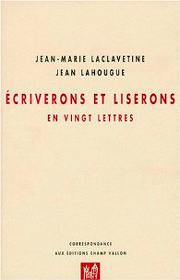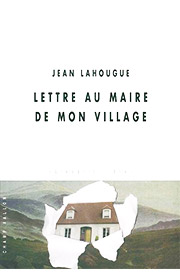Confrontation des deux points de vue opposés sur la création littéraire, à travers la correspondance tantôt patiente et tantôt passionnée, didactique ou incisive, acerbe et courtoise, de deux auteurs contemporains d’importance. Si Jean Lahougue parvient à travers une argumentation très serrée et jamais en défaut à pousser Jean-Marie Laclavetine dans ses retranchements, ce dernier résiste vaillamment et avec humour aux assauts redoutables de son interlocuteur. Un retour à la théorie qui a le mérite, en l’actuelle confusion, de présenter sans cuistrerie les choix qui s’offrent au roman de demain. Le dossier qui suit les vingt lettres constitue une défense de la littérature à contraintes et sa base théorique, avec en annexe le cahier des charges du Domaine d’Ana (quinze règles cryptogrammatiques, trois règles de contenus, cinq règles numériques, quinze règles graphiques).
Lire un extrait
Ecriverons et liserons en vingt lettres
L’extrait
Cette correspondance entre Jean-Marie Laclavetine, membre du comité de lecture des Éditions Gallimard et romancier lui-même, et Jean Lahougue, auteur du Domaine d’Ana (Champ Vallon, 1998), est née du refus, par Gallimard, de publier ce dernier roman. Elle commence tout naturellement par la lettre justificative de ce refus.
1
Cher Jean Lahougue,
Paris, le 5 février 1996
Je me fais aujourd’hui le porte-parole du comité de lecture pour vous annoncer une nouvelle peu agréable; Le Domaine d’Ana ne pourra pas être, en l’état, publié dans la collection blanche. Si la réponse a été si longue à venir, c’est que votre manuscrit a donné lieu à de longues et âpres discussions, à des lectures successives, à des avis contradictoires, dont je voudrais tenter de vous rapporter l’essentiel sans rien omettre ni trahir.
Le Domaine d’Ana est un livre profond et amusant. On y sent passer les ombres familières de Lewis Caroll, de Borges, de Perec – et bien entendu celles, encore plus présentes, de Conan Doyle et de Jules Verne (on n’est jamais loin du Château des Carpates). Mais le livre ne se résume pas à un catalogue des thèmes du fantastique (le savant génial, la demeure inquiétante, l’invention maléfique, etc.) ; par un tour de force assez original, vous conjuguez l’idée ancienne de la toute-puissance du verbe et la préoccupation contemporaine de la réalité virtuelle. Le pari est ambitieux. Cette science-fiction sur la fiction littéraire s’écrit de surcroît dans un style digne d’Anatole France, ironiquement cuistre et précieusement cocasse, qui peut lasser, mais qui est souvent délectable. On retrouve dans ce roman, comme dans la plupart de vos œuvres, une forme de fantastique logique qui exigerait la plus extrême rigueur d’exposition et de développement. Le problème vient de ce que vous vous contentez d’une apparence de rigueur, et ne parvenez qu’insuffisamment à imiter la solide composition des récits du siècle dernier, et à en ressusciter le charme. Cette demi- réussite tient peut-être aussi au manque de consistance des personnages principaux, trop souvent réduits à une caricature (Noé) ou à une présence presque fantomatique (Ana). Tous les lecteurs le soulignent : le jeu érudit est servi par une langue remarquable d’élégance et de maîtrise. Mais cette élégance et cette maîtrise, justement, finissent par constituer un handicap pour le roman; tout au plaisir de faire miroiter vos phrases ciselées, vous en oubliez trop le rythme du récit – et le plaisir du lecteur. Il y a là un manque évident de fluidité et de simplicité de la narration. L’histoire pourrait être captivante, et elle y parvient par moments ; mais elle est racontée avec beaucoup trop de lenteur. L’exposition des principes du dictionnaire de Noé, par exemple, est interminable. Il faut attendre la page 40 pour lire enfin : » Ce fut par un tel soir de printemps que la grande aventure commença… » ; l’intrigue commence alors à se dérouler timidement, pour prendre forme vers la page 80. Les dialogues, nombreux, sont beaucoup trop bavards; chaque réplique est suivie ou précédée d’un long (et bien souvent inutile) commentaire du narrateur. L’ensemble (275 pages de 2 000 signes, soit environ 360 pages standard) doit absolument être élagué, clarifié, revivifié et très nettement raccourci, de façon à permettre au lecteur de se sentir vraiment entraîné dans ces aventures loufoques au pays des mots.
Ce travail serait, de l’avis général, indispensable ; mais il n’est pas certain qu’il suffise à remettre le roman sur ses rails. Vous seul, en l’occurrence, pouvez évaluer la pertinence de ces critiques, et juger s’il est ou non opportun de remettre l’ouvrage sur le métier, Quelle que soit votre décision, sachez, cher Jean Lahougue, que vous trouverez toujours ici des lecteurs très attentifs,
Jean-Marie LACLAVETiNE
2
Montourtier, le 8 février 1996
J’ai bien reçu, cher Jean-Marie et attentif lecteur, votre réponse du 5, et suis heureux de pouvoir enfin donner un nom, un visage et qui plus est une écriture connus aux lares de la maison-mère.
À vrai dire, je m’attendais un peu au contenu de votre lettre et suis persuadé que les louanges et reproches formulés seront ceux de la plupart des critiques.
Oui, certes, aux lenteurs du récit. Oui, sans conteste, au caractère stéréotypé des personnages. Oui, bien sûr, à la redondance des dialogues (et il faudrait parler de celle des illustrations). Oui enfin à la lassante préciosité du style, et ce n’est pas un hasard si les figures s’en matérialisent au chapitre 11 sous forme de croûtes, de bimbeloterie de capharnaüm et autres « rogatons de musée des horreurs « …
En revanche, vous ne serez pas surpris de me trouver plus réticent face à l’imputation de fausse rigueur qui fonde votre critique. Si du moins l’on admet qu’il n’est de rigueur (et de règles), dans une démarche aussi aléatoire qu’une écriture de fiction, que relative à ses postulats, à sa logique interne et à ses enjeux propres. Or de ceux-ci, je ne trouve guère de traces dans votre rapport, sinon celles d’un profond malentendu.
C’est de cela, précisément, qu’à deux reprises j’ai souhaité m’entretenir avec le Comité. Plus que jamais, cet échange me semble aujourd’hui nécessaire.
Bien sûr, j’aimerais que tous les lecteurs du Domaine soient présents, à commencer par les plus réservés d’entre eux. je souhaiterais même (j’ignore si cela se fait, mais je propose tant de choses qui ne se font pas … ) qu’Antoine Gallimard soit des nôtres. Si toutefois vous deviez être mon seul interlocuteur, cher Jean-Marie, croyez bien que je n’en serais pas moins honoré. Un seul impératif dont vous me pardonnerez : il nous faudra disposer de deux heures. C’est le temps que je m’accorde pour convaincre. je crois pouvoir affirmer que ce temps ne sera perdu ni pour vous ni pour moi.
je vous laisse le soin de fixer vous-même ce rendez-vous, sachant que le mercredi et le vendredi sont les jours de la semaine où il m’est le plus facile de me libérer.
Bien sincèrement vôtre,
Jean LAHOUGUE
3
Cher Jean Lahougue,
Le 16 février 1996
Je suis bien entendu disposé à vous rencontrer dès que vous le souhaiterez. Je crains qu’il ne soit pas envisageable de réunir à cette occasion tous les lecteurs du Domaine dAna, et qu’il faille vous contenter d’un tête-à-tête! Mais le point essentiel n’est pas là. Quels que soient les pouvoirs de votre éloquence, je n’ai pas la capacité de faire revenir le comité de lecture sur une décision. Les oppositions à une publication en l’état ont été trop fermes et argumentées pour que je puisse remettre cette question à l’ordre du jour, tant que des modifications substantielles n’auront pas été apportées au manuscrit, allant dans le sens des suggestions que je vous ai transmises. J’ai à cœur de défendre votre livre – et je ne suis pas le seul – mais je ne pourrai pas le faire sans cela. Nous pouvons nous voir, si vous voulez, le mercredi 28 février, ou le vendredi 8 mars, vers 15 heures 30, par exemple. je ne pourrai que vous répéter ce que je vous ai déjà écrit ; mais je serai en tout cas heureux de vous rencontrer.
Très cordialement,
Jean-Marie LACLAVETINE