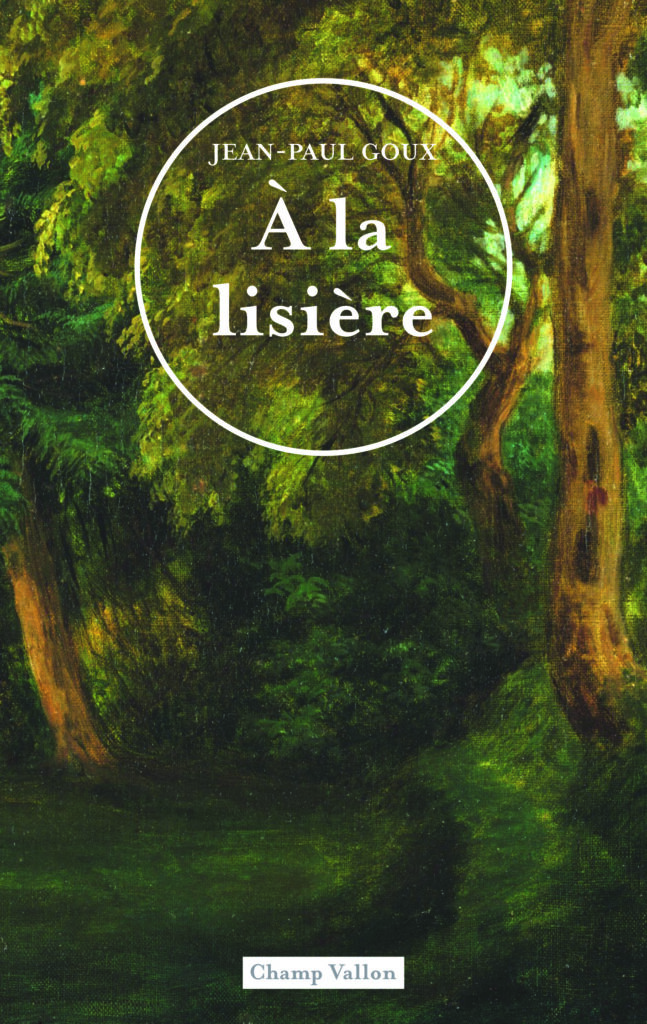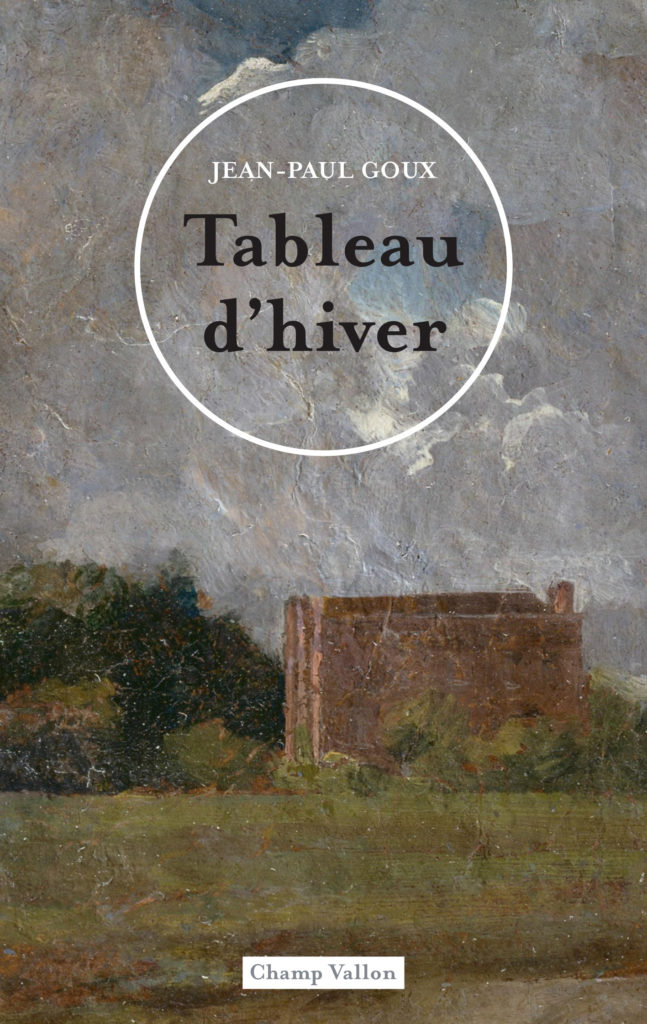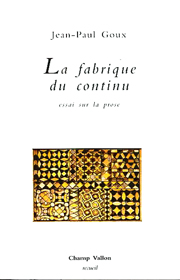Après la disparition de Claire, une artiste qui dessinait d’innombrables ciels et les formes mouvantes et éphémères des arbres et des nuages, Thibaud cherche le moyen de garder vivante l’œuvre de sa compagne : il invite chez lui deux jeunes amis pour leur confier ce qui l’habite désormais. Et ce n’est donc pas sous le sceau de la mélancolie, qui tient « enclos dans l’impuissance de l’irréversible », que s’écrit ce roman, mais bien sous celui de la nostalgie qui apprend « à inventer l’avenir ». Tout dans ce roman est appel au vivant, au désir du vivant, sensible dans les descriptions de la beauté harmonieuse de la maison et de son jardin, dans le calme et l’isolement des lieux, dans la ferveur qui habite les personnages du roman, et le désir profond de ce qui peut naître ou renaître autrement, dans la ferveur et la beauté d’une écriture prêtant infiniment attention « aux formes infinies du monde naturel. »
Annie Clément-Perrier
Né en 1948, Jean-Paul Goux est l’auteur d’une œuvre littéraire d’exception. À la lisière vient après Tableau d’hiver (Champ Vallon, 2021).