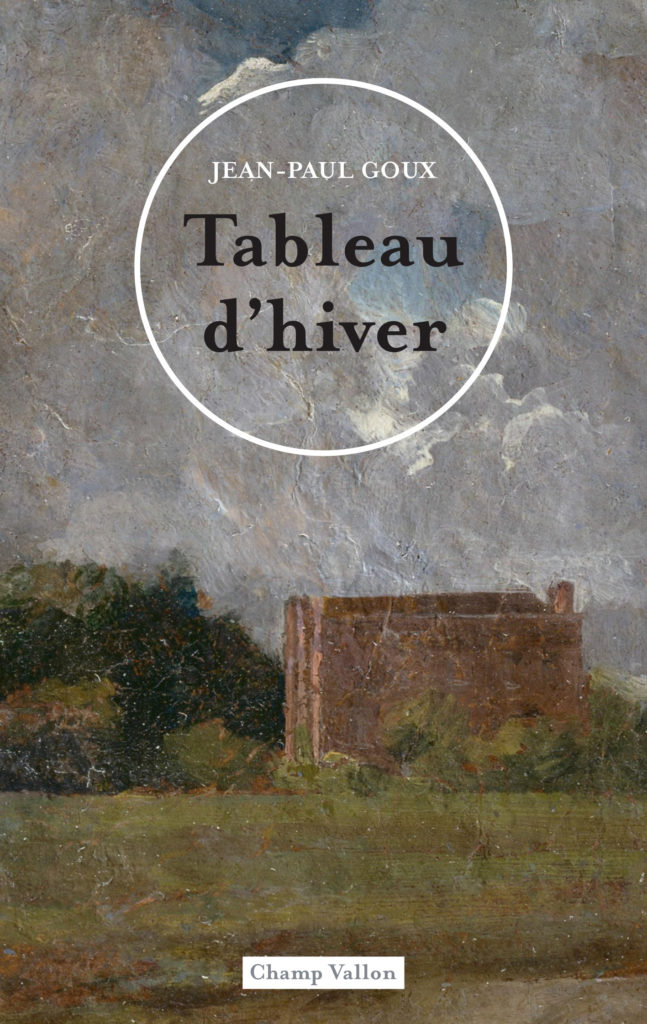(pp. 7-12)
En descendant sur le quai de la Loire, près du pont Aristide Briand, ce matin de début mars, j’ai pensé que j’attendais une jeune fille: «Comme il y a vingt-cinq ans!», me suis-je dit. La plupart du temps, la pensée des étudiantes ne me préoccupe pas exagérément. Mais si j’ai fini par accepter sans plus m’en étonner que ce soit un bien curieux métier à exercer que celui où l’on passe quelques heures par semaine, dans une ville qui n’est pas la vôtre, celle où vous habitez, à parler de littérature devant un public pour l’essentiel constitué de jeunes filles, je ne cesse jamais tout à fait de m’émerveiller — je ne cherche pas un meilleur mot, il convient au sentiment de surprise mêlé de gratitude, à cette reconnaissance émue et un peu éblouie que mille choses ici suscitent en moi régulièrement, car il n’y a guère de journée où je n’aie l’occasion d’être émerveillé. Je me dis souvent qu’on est ici en province, et dans cette vieille province française policée où la pierre blanchit lorsqu’elle vieillit et se patine, où le fleuve est large, les ciels toujours proches comme sur un bord de mer, et les arbres légers: la forêt est loin, et ses bauges odorantes et grasses, aussi loin que Paris. Il y a bien de temps à autre une adolescente mal embouchée, qui n’a pas encore remisé ses hargnes de lycéenne, ou qui déjà se satisfait de savoir user de ce petit ton sec et suffisant, revêche et obscurément rancuneux qu’on voit à tant de petites jeunes femmes qui cherchent à prendre leurs marques. Elles sont si rares, ces mal embouchées, qu’elles en prennent un intérêt tout exotique: on ne peut s’empêcher de penser qu’elles doivent venir d’ailleurs et que, récemment transplantées, elles n’ont pas encore eu le temps de s’acclimater. Car vraiment, ce qui vient ici, ce qui vient bien, ce sont mille choses toutes simples et émerveillantes: un salut spontané, un vrai sourire, un remerciement qu’on ne cherche pas à bâcler, une voix qui se pose, sans vous sommer de quoi que ce soit, et qui vous fait ainsi une place, une maladresse qui se reprend comme on lève une équivoque, par souci de clarté et par souci de l’autre, celui à qui l’on parle, et puis un regard confiant, une porte qu’on vous tient, un corps qui s’efface pour vous laisser passer ou qui se glisse quand vous l’avez laissé passer, tout cela, une gentillesse, une manière de reposer son stylo sur la table, indulgente, patiente ou navrée, un jour où décidément il vaut mieux arrêter le cours avant l’heure parce qu’on n’est plus que fatigue et confusion d’esprit, cette manière de vous dire de mille façons diverses qu’on n’est pas un ennemi, qu’on n’a pas de revanche à prendre contre vous, et qu’en somme on n’est pas un chien. Je me dis aussi qu’il faut sans doute avoir passé quelques années dans des collèges et des lycées, à enseigner dans des collèges et des lycées, pour que ces mille choses toutes simples puissent continuer d’émerveiller. Mais peut-être qu’au fond, il y a deux ou trois ans, ou même l’année dernière, toutes ces jeunes filles à qui je prête des grâces naturelles, venues de la nature des pierres, des ciels et des eaux du fleuve, n’étaient rien autre chose que de petites rancuneuses. «Mais je ne le crois guère, je ne le crois même pas du tout», me suis-je dit.
Il y a sur le quai, tout près du pont de la Loire, vers l’aval, une espèce de petit square dont la laideur et la bêtise font songer à ces «jardins» du quai Saint-Bernard, au pied de Jussieu. Mais quand on s’est assis sur l’un des bancs de bois, on cesse de voir les bouts de pelouse en forme de haricot posés sur un sable brun, la rangée des lauriers taillés, les quelques jeunes peupliers encore bien chétifs sous lesquels trônent des bancs de ciment, on ne voit plus que les quatre vieux saules pleureurs, au tronc noueux, aux branches tortes et noires. «La seule chose que j’aime dans les saules, me suis-je dit, c’est qu’ils sont en ville les premiers arbres qu’on voit verdir, et les derniers qui restent verts. Le grand pleureur de l’île de la Cité, par exemple, devant le chevet de Notre-Dame, garde ses vieilles feuilles jusqu’en janvier et se met à reverdir dès février. Pour le reste, il y a dans le saule quelque chose de détestable, qui va contre la vraie nature de l’arbre: il pend, ses rameaux pendent comme une vieille perruque.» Ce matin-là de début mars, l’osier des saules commençait à peine à jaunir, ne dissimulait rien encore de l’architecture torturée des branches et faisait tout juste un pâle tamis brumeux derrière lequel s’apercevaient les premières arches du grand pont qu’éclairait par en dessous le soleil encore bas, tandis que les piles restaient dans l’ombre. Je me suis assis sur un banc encore un peu humide d’une pluie nocturne, j’ai regardé le fleuve, et puis le ciel, et de nouveau, comme au matin, au réveil, j’ai senti une main m’empoigner le cœur lorsque je me suis dit que j’allais voir Marine. Non, la plupart du temps la pensée des étudiantes ne me préoccupe pas outre mesure — Marine, elle, c’est autre chose. «Cette idée de penser à une étudiante en la nommant par son prénom! Toutes celles que je reçois chaque semaine pour les entendre parler un peu d’elles, apprendre à les connaître, si peu que ce soit, je n’y songe jamais deux minutes avant de les voir, et je ne les connais pas par leur prénom! Je suis là, deux heures avant l’heure, à me demander si “Marine” c’est plutôt joli ou tout à fait idiot! D’après cet article du Monde, l’autre jour, sur cette énième sociologie des prénoms, c’est un des grands succès des années quatre-vingt — mais tout de même, elle est née avant! Je crois que c’est plutôt joli. Le bleu, la flotte, les gens de mer, la peinture, la Brise, les chars d’argent et de cuivre qui battent l’écume… D’ailleurs, elle est rousse. Le père, capitaine de frégate, a rencontré une Normande à Cherbourg, ou une Anglaise, à Plymouth, après des manœuvres de l’OTAN, mais que ferait-il ici, au bord d’un fleuve qui n’est pas navigable! Etude à faire sur la répartition territoriale des rousses. Sûrement déjà fait. Beaucoup de rousses ici, d’ailleurs. La guerre de Cent ans, forcément. Marine Carteret est l’arrière-arrière-petite-nièce d’un soldat d’Henri VI, qui a fait souche sur les rives de la Loire. Il suffit de lui demander: “Pourquoi êtes-vous rousse?” C’est tout simple.»
Est-ce qu’on sait comment on se parle à soi-même? On n’y pense pas quand on le fait, et sitôt qu’on y pense, on pense qu’on y pense, et on s’écoute parler. J’ai pensé que ce qu’on pouvait faire, après coup, c’était tout au plus tenter de conserver le mouvement — l’allant et la mobilité — de ce qui passait en soi, exactement comme ces nuages que je voyais au-dessus du fleuve. Le feu, le vent, la mer, les nuages: ce qu’il y a de commun entre ces intercesseurs familiers de la rêverie, c’est évidemment le mouvement: il la pousse, mais il la «fixe» aussi, sans quoi on n’éprouverait aucune sorte de plaisir, si le plaisir a bien partie liée avec la répétition. Je me suis dit que «Marine», si commun qu’il soit devenu, était un peu plus joli que ces ahurissants prénoms qu’on ne découvre jamais sans une grande consternation, en début d’année, en parcourant les listes d’inscrits. Toutes ces Katia, ces Estelle et ces Esteline, ces Ludine, ces Ludivine, ces Axelle et ces Karine, quelle vie difficile on leur a préparée! Et cette manie des finales en -a, ces Sandra, Sabrina, Vanessa, Linda, Lydia ou Anita! Prénoms sans visage: comment pourrait-on mettre un visage sur une Jennifer, une Gladys, une Nadège, cinq ou six Stéphanie, autant d’Elise, de Séverine, de Corinne et de Géraldine? Evidemment, parfois, on trouve une Guillemette ou une Guillemine, on s’y arrête un instant, celui qu’il faut pour saisir que c’était là sa seule raison d’être, et l’on passe, un peu ravi, un peu inquiet quand même, sur une Tiphaine, une Montaine, une Lorène, avec une question sans réponse sur la multiplication de ces finales-là. Mais comme l’on aimerait savoir très vite identifier les quelques bienheureuses qui s’appellent tout simplement Marie, Claire, Anne, Aude ou Aurélie! Marine est une Marie de la mer; Marine est rousse; Marine écrit, bien sûr — les étudiantes en lettres écrivent beaucoup, ce n’est pas tout à fait surprenant; ce qui surprend toujours, c’est à quel point c’est transparent, et doublement, parce que cela se devine très facilement, et parce qu’elles en font état sitôt qu’on le leur demande ou sans même qu’on le leur ait demandé. Je me suis rappelé l’instant où Marine Carteret m’a confié ce qu’elle écrivait. Que se dit-on quand on se parle à soi-même et qu’on évoque un souvenir?