CHRISTIAN JOUHAUD Voir le passé
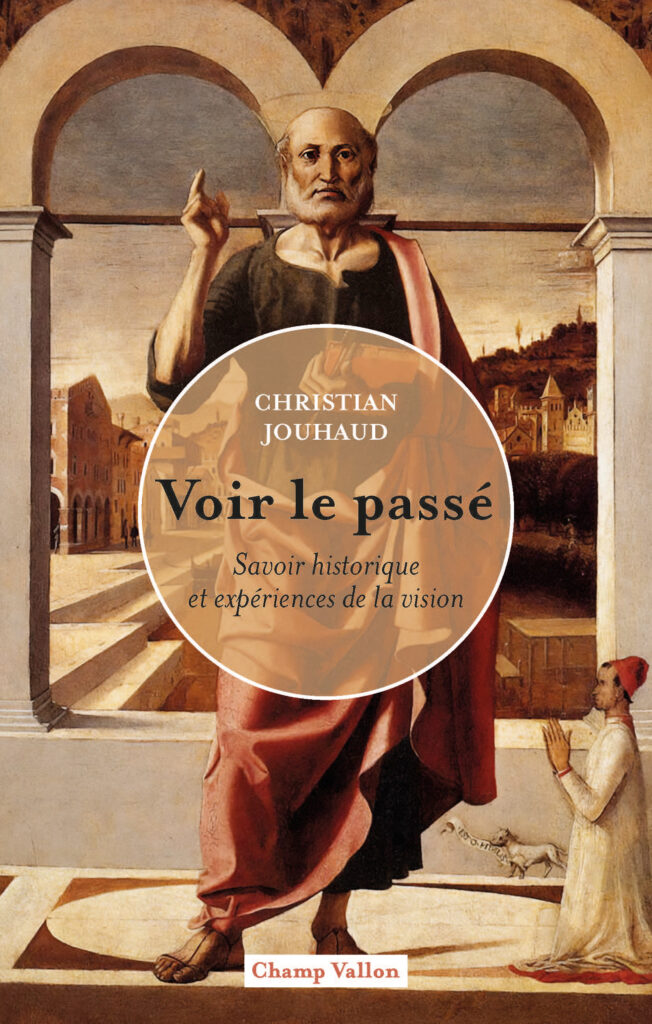
La machine à voir le temps existe-t-elle ? Certes avec les yeux on ne peut voir du passé que des traces qui ont traversé le temps (textes, images, ruines). Pourtant il n’y a pas de frontière étanche entre les images mentales produites par l’expérience de voir et celle de croire voir ou de penser voir. C’est pourquoi ce livre croise des manières de voir vécues dans le passé avec des expériences de vision de ce passé vécues par l’historien. À cette fin, cinq chapitres cheminent d’une collection d’histoires de voir (du XVe au XXe siècle) vers l’acte de faire voir pour persuader, puis, à travers une série de désarrois en face de ce qui est vu, vers la rencontre… (lire la suite)
KARINE ABIVEN Sur l’air de la Fronde
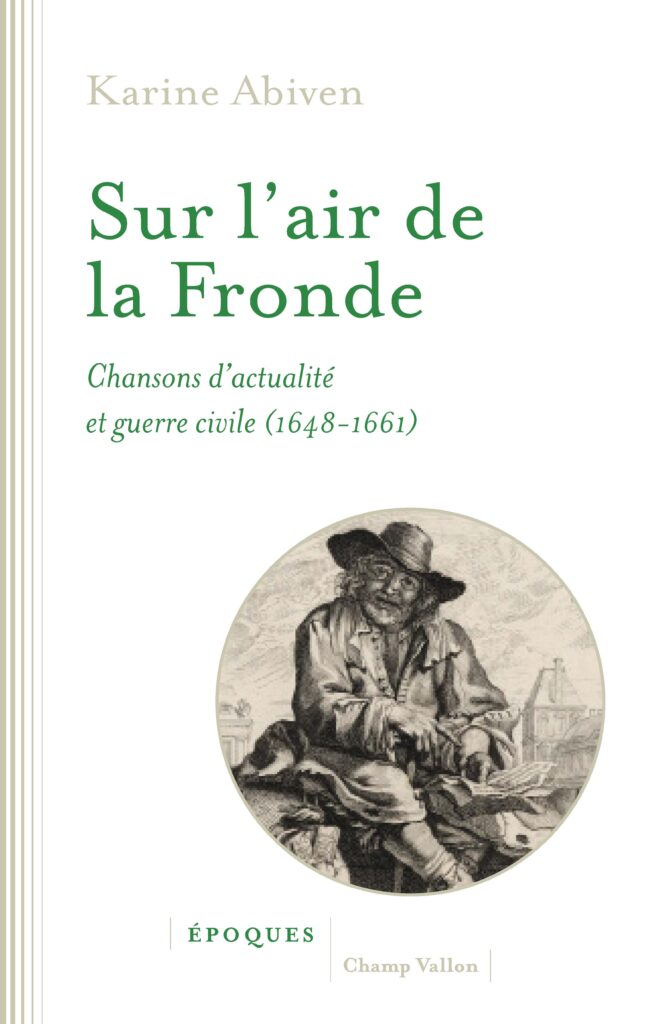
Peut-on connaitre les mots qui circulaient dans les rues de Paris pendant les révoltes anciennes ? Les chansons nous offrent une chance d’approcher ces discours qu’on diffusait sur des airs connus, à destination d’un public ciblé ou élargi. Ainsi, pendant la Fronde (1648-1653), des milliers de couplets ont circulé dans les rues de Paris, à l’écrit ou à l’oral, avant d’être collectés jusqu’au XVIIIe siècle. Les chefs des factions en lutte s’en servaient pour diffuser efficacement des éléments de langage sur les rapports de force du moment. Mais d’autres chansons d’actualité, mises en circulation par les petits métiers de Paris, peuvent… (lire la suite)
JOSÉ-LUIS DIAZ «Moi qui ai vécu tant de vies»
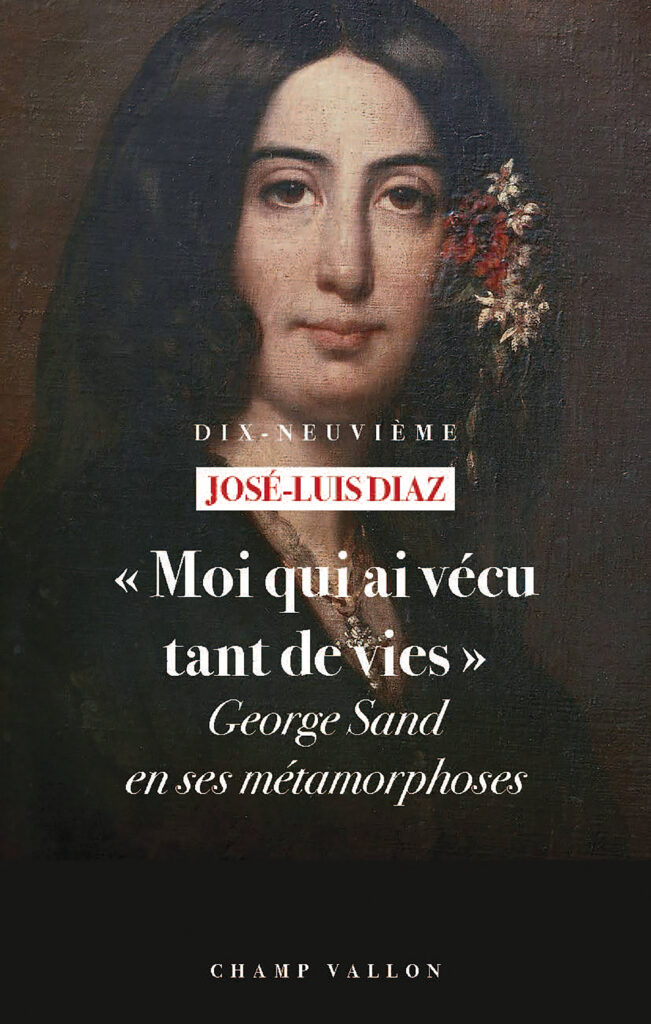
Ce livre de synthèse consacré à Sand montre à quel point elle fait partie de ces écrivains qui, comme le note un critique en 1837, « marchent de transformations en transformations », vie et œuvre dans son cas ne cessant de se poursuivre. La vie-œuvre de Sand est suivie, en prêtant attention à ses points névralgiques : naissance à l’écriture puis entrée en littérature (1812-1832) ; ces deux moments de crise que sont l’écriture de Lélia (1833), puis sa relation avec Musset (1833-1835) ; la conversion à la politique (1835) du voyageur « artiste » des Lettres d’un voyageur (1835-1837). Sand est aussi observée comme femme auteur, comme critique… (lire la suite)
FRANÇOIS GUILLET Vertige du jeu
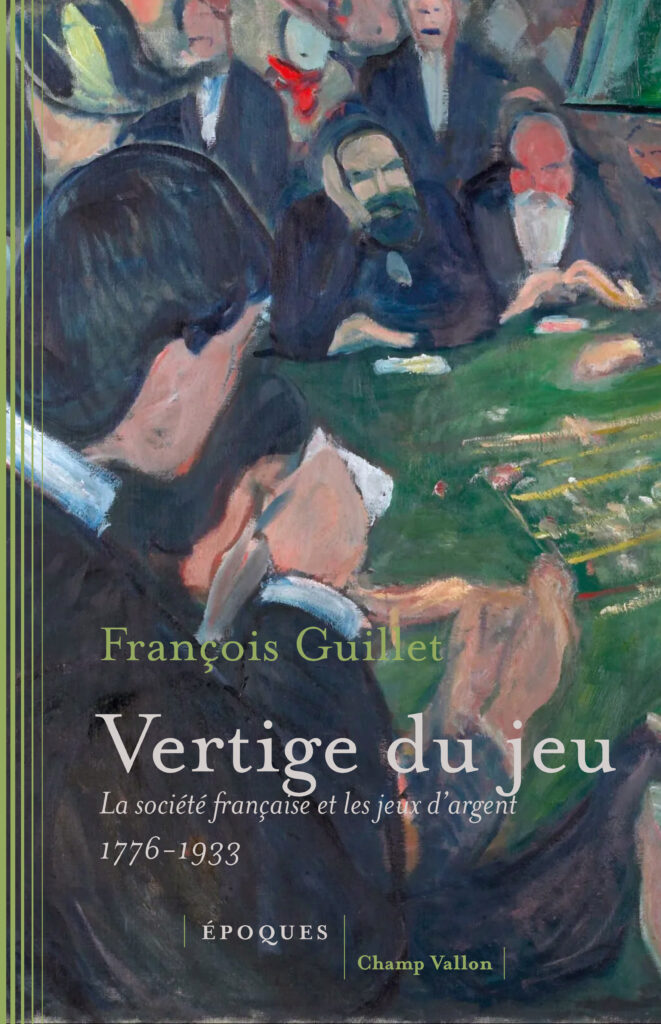
1776 marque la création de la loterie royale et 1933, la renaissance de la loterie nationale. La première date correspond au moment où l’État prend acte du développement du jeu dans la société urbaine et tente d’en tirer parti. Le jeu marque ensuite de son empreinte la période révolutionnaire et la première partie du XIXe siècle, jusqu’à la suppression de la loterie et la fermeture des maisons de jeu, en 1836 et 1838, puis se déplace pendant la seconde moitié du XIXe siècle dans les cercles, les casinos et les champs de courses. Acculé, l’État est contraint à nouveau, en 1933, d’avoir recours à la loterie pour financer ses dépenses.
L’ouvrage … (lire la suite)