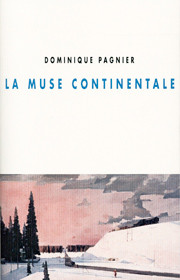Même si elles appartiennent à cet axe de l’Est cher à l’auteur, on ne trouverait guère plus opposées qu’Autriche et Russie qui offrent leurs décors aux récits composant ce livre. La première est exiguë ; son paysage s’inscrit dans la verticalité ; elle est le lieu confortable d’une rêverie nostalgique dans un hôtel d’opérette situé sur les bords d’un lac alpin, et sa capitale, où vécut l’auteur, est ici le théâtre baroque d’une singulière expérience qui motive une spéculation sur le Temps et la Mort. La Russie offre au contraire d’éprouver la dimension d’horizontalité à travers les avenues et les parcs de Moscou, ou encore la vastitude céleste au-dessus des rudes immensités au nord de la Volga. Ainsi la vieille république d’Europe centrale confite dans le passé et la Russie ouverte aux révélations deviennent les deux extrémités d’un itinéraire initiatique dont, avec ce mélange de gravité et d’humour qui lui est propre, Dominique Pagnier livre ici le récit.
Lire le début
La muse continentale (récits)
Extrait
(pp. 7-18)
I
Un meurtre au « Cheval-Blanc »
À Jean-Benoît et Agnès,
souverains de Volkhanie
Ce pays sans mer, personne ne le prend plus au sérieux. À cause de ses chants montagnards, de son folklore costumé, de ses drames troglodytiques et de son exiguïté qui l’oblige à s’organiser verticalement. L’Autriche, il n’y a plus que moi encore pour la considérer comme une puissance majeure. Une puissance impérialiste qui joue le rôle de gendarme du monde, du monde qui m’intéresse. Ça m’a pris il y a longtemps, bien avant le remariage de mon père avec Mina, la Viennoise.
J’avais dix ans. J’étais en convalescence chez mes grands-parents maternels à Nice. Un dimanche après-midi, ils m’emmenèrent voir un film qui jouissait de l’agrément de l’Office catholique du cinéma. C’était Kitty, une bluette viennoise tournée en 1956, où apparaissait pour la première fois un couple qui, dans l’histoire de ce genre, allait faire parler de lui : Romy Schneider et Karlheinz Böhm. Tout cela se serait oublié à la longue si, quelques mois après que je fus rentré à Troyes, mes autres grands-parents ne m’avaient emmené voir L’Auberge du Cheval-Blanc en version filmée, avec l’indéfrisable Peter Alexander. Une actrice aujourd’hui oubliée y portait le Dirndl, cette admirable invention vestimentaire des pays alpins. Mais les acteurs principaux étaient le décor : l’hôtel, le paysage de Sankt Wolfgang, son lac et le Grosser Sparber, une montagne penchée de forme tronconique qui se trouve de l’autre côté du lac. Ce dimanche après-midi de mai, alors que nous rentrions de la séance à pied, les rues de notre faubourg troyen m’apparurent encore plus souffreteuses que d’habitude. Mon père était loin, en Allemagne pour ses affaires, ma mère à Nice ou ailleurs ; c’est en ce temps que le rêve autrichien s’empara de moi, définitivement, et dans le même moment que les regards des garçons de mon âge se tournaient vers l’Amérique. Je n’eus même pas la peine de faire un vœu, d’invoquer une puissance céleste. Tout s’arrangea pour je me retrouvasse au Cheval-Blanc, un Noël, quelque cinquante ans plus tard.
Le Cheval-Blanc n’est pas le sanatorium Berghof de Davos mais je pourrais y attendre l’apparition de Madame Chauchat. Dehors, sous le crépuscule, ce décor alpestre enneigé, l’énigmatique corne du Grosser Sparber, sur quoi, en surimpression dans la grande baie de la salle à manger, se voient les reflets des lustres à l’intérieur, font que, à peine attablé, en attendant Mina et le reste de la famille, je guette une apparition. Peut-être pas Madame Chauchat, plutôt une jeune orpheline qu’accompagnerait sa tutrice, toutes deux sorties d’un autre roman. Mais des visages féminins d’hôtels, de trains, de théâtres, j’en ai déjà une collection. Et depuis un certain nombre d’années, j’ai passé la défroque d’un vieux garçon incapable d’une passion, même d’une durée limitée. Et je me suis mis à collectionner d’autres choses, les planches de Juvenile drama, les dioramas anciens, les tabatières, les billets de banque autrichiens imprimés lors de la crise de 1923. Pourtant, ce soir, ce lieu impose d’attendre une apparition.
En veste de chasse noire à parements verts, le maître d’hôtel fait une dernière inspection des tables, tandis que les premiers pensionnaires arrivent pour le dîner. Un Russe, oligarque probablement, et sa famille nombreuse s’installent à deux tables de celle où je me tiens ; ce n’est pas chez eux que je trouverai de quoi distraire mon cœur pour les quelques jours que je vais passer ici. Ni chez les Anglais, famille aussi nombreuse et distinguée, qui prennent place entre ma table et la grande baie ouverte sur le lac livré maintenant à la nuit. Mina arrive suivie de sa nièce, Wetti, que j’ai portée dans mes bras quand elle marchait à peine, et de son petit garçon Ludwig, alias Wickerl. Le papa, qui s’appelle Volker, ou plutôt Volki, nous rejoint peu après.
Mina est très à l’aise dans cet hôtel. Elle est très à l’aise partout. Récemment, en Australie, quand le pneu de sa voiture éclate en plein désert à trois cents kilomètres de tout lieu habité. Elle en a vu aussi, dès son enfance. Notamment les Cosaques à Vienne. Je ne me rassasie pas de cette histoire. C’était en 1945 dans la cour d’une ferme de Marchfeld, où elle s’était réfugiée avec sa mère ; les cosaques de l’Armée rouge essayaient de faire manger un poste de radio, puis une culotte de cuir à leurs cavales. Mina avait cinq ans. Aussi sa jeunesse dans le VIIe arrondissement de Vienne ; elle écoutait Radio Rouge-Blanc-Rouge, la station de propagande américaine dans l’Autriche occupée. Elle portait très bien le Dirndl aussi ; la première fois que je l’ai vue ainsi, c’était dans mon coin de Champagne ; derrière elle il y avait des tas de charbon et des citernes à fuel ; elle ressemblait à Sissi impératrice. Depuis la mort de mon père, c’est plutôt l’impératrice Marie-Thérèse. Mais ma belle-mère n’est pas Madame Chauchat.
Volki nous rejoint enfin. Je dois parler de ce garçon qui est sans doute le seul à avoir compris de quoi était fait mon intérêt pour son pays. Il parle un français qu’il a appris en Turquie dans un collège tenu par les frères des Écoles Chrétiennes. Ce n’est pas du levantin, mais un français nostalgique. Ainsi use-t-il parfois d’expressions vieillies comme « énervé », dans le sens de « mou, privé de nerfs », sens qui a complètement disparu chez nous. Pour préserver cette langue si aimable, il n’y a plus que des espèces de petites colonies françaises oubliées par le temps et le totalitarisme mondial. Qu’on ne s’imagine pas pour autant que je sois un défenseur des langues régionales. Ces langues sont très bien pour les pays germaniques. Ça va avec les costumes régionaux qui n’ont jamais été abandonnés. Elles ont même donné une littérature. Mais en France pas grand-chose d’intéressant. Une langue doit avoir produit une littérature, et une grande, à laquelle une civilisation peut s’adosser. Enfin, Volki est un arrière-petit-neveu d’un ancien chancelier d’Autriche, lequel est resté à la postérité pour avoir en 1955 prononcé sur le balcon du palais du Belvédère, ces mots qui font encore frémir ici : « L’Autriche est libre ! » Il est advenu que sa mère, depuis longtemps veuve, est morte il y a quelques mois, et, alors qu’il déménageait la vaste demeure que cette femme distinguée habitait sur les hauteurs verdoyantes de Vienne, il est tombé sur des effets de chasse de son père, certains hérités du chancelier. Il y avait entre autres des médailles saintes et un de ces blaireaux en poil de chamois qu’on accroche à son chapeau. Dès qu’il les a vus, il a pensé à moi et à un chapeau de modèle Graf Andrassy avec lequel je lui avais rendu visite un jour à Vienne. Toute la famille a été contente de me voir parer mon feutre de ces choses. Depuis, je collectionne ces petites décorations religieuses et cynégétiques. Ça m’intéresse plus que les visages de femmes et Madame Chauchat, que je n’attends plus.