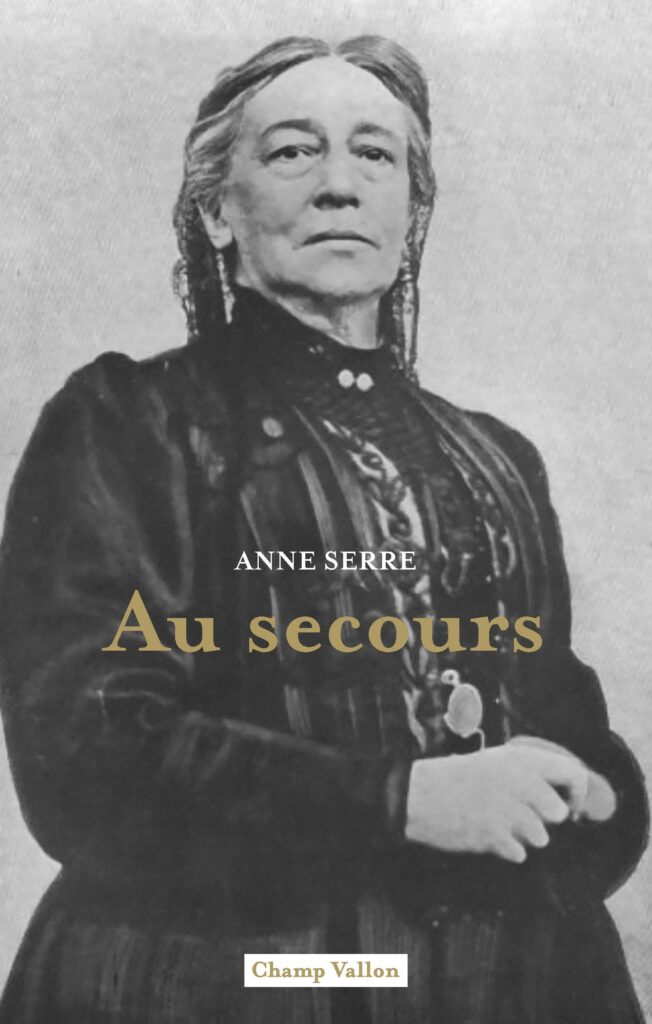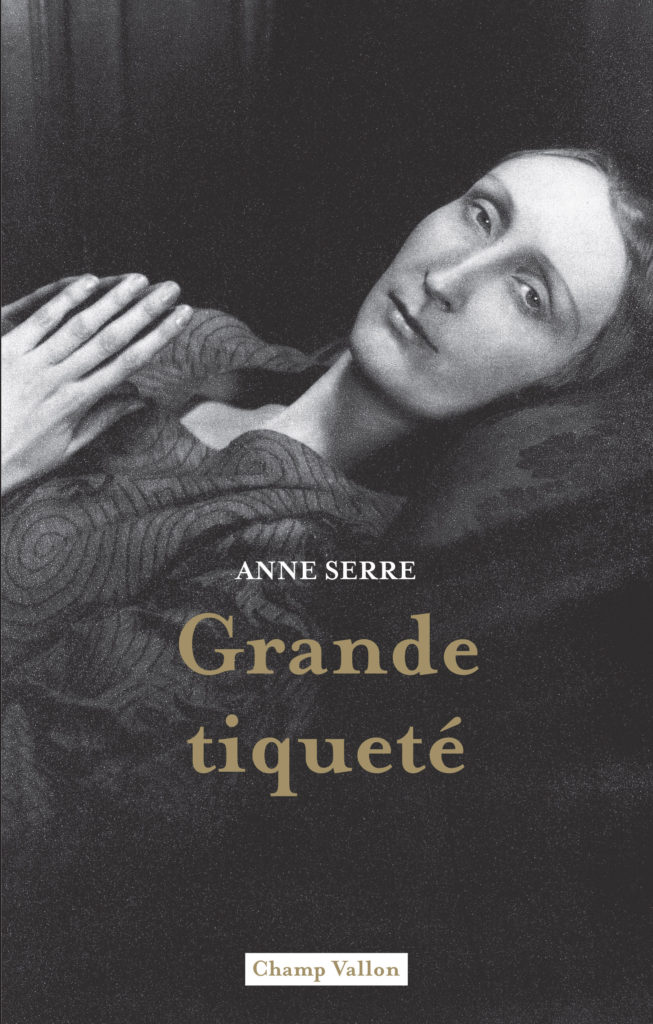Au secours
L’extrait
(p.-7-15)
Je suis informée de tout ce qui vous arrive et demain je serai là. Ne craignez rien, je me chargerai de tout, je m’occuperai de tout, je ne veux pas que vous ayez à souffrir ni à vous plaindre de quoi que ce soit, je viendrai et tout ira bien, ayez confiance. Voulez-vous que je vous dise en détail de quelle manière je viendrai? Cela vous rassurera peut-être. Eh bien pour commencer je prendrai ma barque, celle que vous connaissez, qui a un fond plat et qui est peinte en vert, même si ce vert avec le temps et à cause de l’humidité s’est bien effacé. Donc je détacherai ma barque. Je la détacherai du petit hangar à bateaux que vous connaissez et qui est situé, rappelez-vous, à l’arrière de l’île. Il fait un peu sombre ces jours-ci et je suis seule mais je n’aurai pas peur de traverser le jardin noir. Après tout j’ai trente-huit ans, et je suis affolée de n’avoir encore rien fait de véritablement adulte dans mon existence. Par exemple je n’ai sauvé personne, je n’ai été au chevet d’aucun mourant, je n’ai pris aucune décision irrévocable. Je n’ai encore rien fait de ma vie, je dois le reconnaître. Je détacherai la barque en ayant peur de tout: de l’obscurité, du voyage à faire, du froid, mais passons. Je ne dis pas cela pour vous montrer le courage qu’il me faudra et m’en vanter, je vous le dis pour me donner à moi-même ce courage qui me fait défaut. Bon, je sors de la maison, j’ai pris une veste chaude, des gants de laine, une écharpe, et je porte un pantalon épais et de grosses chaussures pour ne pas sentir l’humidité car l’humidité aussi me fait peur quand elle est froide. Je fermerai la porte avec la grosse clef que je glisserai dans ma poche. Ainsi vêtue je me sentirai un peu masculine, cela m’aidera à vivre dans ces circonstances.
Vous savez que mon île me fait penser à «l’Ile des morts» de Böcklin. Alors pourquoi donc l’avez-vous achetée? me direz-vous en levant un sourcil. Je crois que je l’ai achetée à cause de cela, mais aussi, souvenez-vous en, parce qu’elle n’était pas chère. Personne ne voulait y habiter. Non, je ne cherchais pas à fuir. J’ai d’abord pensé à acheter une chambre dans une ville, à ne donner mon adresse à personne et à y aller régulièrement. Mais quand on m’a présenté cette île… Et d’ailleurs rappelez-vous, vous m’avez engagée vous-même à l’acheter. Vous disiez: «C’est une affaire, ce serait idiot de rater cela». Vous aviez parfaitement raison, ma belle… Que vous êtes jolie! Est-il possible qu’étant si jolie vous ayez tant besoin de moi? Mais peu importe, je viendrai. Je ne cherche pas à me défiler. Oh, non, je ne cherche pas cela. Un appel et j’accours. Un appel terrifié et j’accours dix fois plus vite. Il me suffit de détacher ma barque, de glisser sur l’eau noire, d’accoster, de prendre un train ou de louer une voiture. Je ne conduis pas très bien, faute d’habitude, mais ne vous souciez pas, je conduirai très bien pour voler vers vous, et nous n’avons à redouter ni l’une ni l’autre un accident.
Ayant quitté la maison et fermé la porte avec la lourde clef, j’entreprendrai de traverser l’île – si noire, si obscure la nuit – en passant sous les arbres, en franchissant les rochers par lesquels on peut descendre au hangar à bateaux. Que c’est bête de ne pas l’avoir rendu plus accessible! J’aurais pu faire tracer un chemin pour y aller directement, il me restait un peu d’argent, j’aurais parfaitement pu faire arranger cela et je ne l’ai pas fait. Je ne pense jamais à l’avenir. Je ne pense jamais qu’un jour vous allez m’appeler, qu’il me faudra partir en hâte, peut-être nuitamment, en novembre. Même ici j’ai pris des habitudes de confort: ma lampe, mon feu de bois, mes rideaux rouges pour réchauffer les pièces. Depuis que j’ai quitté ma jeunesse je n’ai eu de cesse de repousser la nuit, le froid, l’humidité, et de me bâtir obstinément un nid. C’est à ce signe que je constate que j’ai quitté ma jeunesse. Avant, je n’avais pas peur du froid. Souvent j’essaie de me rappeler comment c’était avant, j’essaie de retrouver mon état d’esprit d’alors et je n’y arrive pas. Je me rappelle que je ne portais que de très minces pull-overs et un mince manteau d’hiver. Des écharpes et des gants? Je n’en suis même pas sûre. Est-ce que j’avais froid? Il se peut, mais ce froid me paraissait naturel, il ne m’inquiétait pas, ne me donnait pas ce sentiment d’abandon et de solitude qu’il me donne aujourd’hui. Avec les années j’ai acheté des pull-overs de plus en plus chauds, des manteaux épais, j’ai même désiré un manteau en peau doublé de fourrure à l’intérieur! Entre «avant» et «après» il n’y a pas de frontière précise hélas, aucun événement sur lequel on pourrait revenir. Entre l’avant et l’après il n’y a eu que le temps qui passait, des grippes, des paresses, des moments de relâchement. Mais me voilà résolue à venir puisque vous m’appelez.
Ayant traversé le jardin je descendrai au hangar en m’agrippant aux rochers pour ne pas tomber dans le lac, il ne manquerait plus que cela. Je descendrai avec précaution. Pourquoi n’ai-je pas pensé à faire mettre une lampe? Encore une négligence. Je ne sais pas me faciliter la vie, mais c’est peut-être mieux ainsi d’un certain point de vue. Je pense que vous m’approuveriez. Parvenue dans le hangar il me faudra détacher la barque qui y est arrimée à l’aide d’une chaîne. Ai-je la force de faire cela seule en pleine nuit avec un vent violent qui s’engouffre partout et pas la moindre lueur à l’horizon pour me donner de l’allant? Je sais qu’on peut se surpasser dans les circonstances difficiles. J’ai éprouvé cela deux ou trois fois dans ma vie, c’est peu, mais cela suffit à vous rendre capable. La chaîne glissera, je mettrai un moment à la détacher, je vérifierai que les rames sont bien là, et repoussant le mur à l’aide de l’une d’elles, ayant sauté sur le fond plat de la barque, je sortirai de chez moi, de l’île, et en avant.
Une fois que je me serai éloignée de quelques mètres je me sentirai déjà un peu mieux. Je ne sais pas si c’est le fait d’agir qui réconforte, ou si, dans mon cas, c’est de m’éloigner de ma maison. Bizarre pensée. Est-ce que ma maison me ferait peur? N’y serais-je pas bien? C’est un comble lorsque l’on a décidé de vivre retirée et que l’on a tout mis en œuvre – acheter une île, difficile d’accès – pour donner corps à ce désir. Voilà tout de même cinq ans, presque six, que je vis ici. Vous rappelez-vous le jour où nous avons fêté mon installation? Comme j’étais sûre d’avoir fait le choix qui convenait! Comme j’étais fière d’être parvenue à faire quelque chose de cohérent de ma vie! Vous sembliez avoir quelques réticences, même si par délicatesse envers moi, pour ne pas gâcher ma résolution, vous ne les manifestiez pas. Vous vous promeniez dans le jardin en disant: «Quelle vue! Que c’est beau! Est-ce que ces arbres ne sont pas extraordinaires?» Vous caressiez leurs branches et j’avais le sentiment que vous étiez surtout ravie de n’avoir pas à demeurer ici. Je me trompe peut-être. Il se peut que vous ayez été sincèrement éblouie par le lieu. Non. Non, ce n’était pas vous cette voix pleine d’exclamations d’admiration. Vous n’êtes pas comme cela. Je me souviens qu’en Italie lorsque nous regardions quelque chose de vraiment beau, il y avait de la tristesse dans vos yeux. Et vos promesses! Pas du tout vous, non plus: «Je viendrai souvent, méfie-toi, tu m’auras tout le temps dans les pattes! » disiez-vous en me menaçant du doigt gentiment. Pourquoi me parliez-vous ainsi? Étiez-vous si effrayée de ce que je devenais? Il fut un temps où vous ne faisiez pas tant de mines, où vous vous exprimiez clairement sans chercher à me tromper. «Je ne suis absolument pas d’accord avec toi», disiez-vous. «Tu as tort, tu te fourvoies totalement, j’en mettrais ma main au feu», disiez-vous encore. Je préférais lorsque vous me parliez ainsi, cela me donnait à réfléchir ensuite, j’aimais bien que vous ne soyez pas d’accord avec moi.
Le soir de la fête qui célébrait mon installation dans l’île, j’ai bien senti que vous attendiez impatiemment le lendemain pour pouvoir repartir. Il était convenu que vous passeriez la nuit, la matinée suivante, et que vous me quitteriez l’après-midi. Je ne sais à quels signes exactement je sentis votre impatience d’être au lendemain. Vous avez dû dire un mot ou deux concernant cette journée, les souligner de «avant que je ne parte» ou «quand je serai partie». Le mot «départ» est revenu au moins deux fois, ce qui signifiait que vous y songiez. On ne parle pas de son départ lorsqu’on veut rester, ou alors juste dans les dernières minutes. Quand on aime être quelque part on se fait semblant à soi-même de n’en jamais partir, on fait comme si c’était éternel. Et comme vous étiez jolie le lendemain! Tout animée par le bonheur de vous en aller. Je ne dis pas que vous étiez heureuse de me quitter, non, je sais que vous m’aimez, mais je dis que vous étiez heureuse de quitter cet endroit qui ne vous plaisait pas au fond, vous paraissait trop brutal, bizarre. Je vous ai regardée partir comme si vous étiez une femme et moi un homme. Vous aviez mis votre robe rouge, cette robe qui avait un tel chic, une telle singularité qu’à plusieurs reprises j’avais tenté de vous convaincre de me la donner. Mais cette fois vous n’aviez pas cédé (vous n’avez jamais vraiment cédé lorsqu’il s’agissait d’un vêtement aussi réussi), vous saviez bien que vous étiez exquise avec, si personnelle. Vous agitiez les bras dans la barque qui vous emmenait, pour me faire signe, me témoigner votre affection, et sur l’eau qui portait votre voix vous juriez: «Je reviendrai! À bientôt! Prends soin de toi!»… J’étais contente de mon île mais triste que vous partiez. Je n’aurais assurément pas souhaité que vous restiez toujours – je voulais vivre seule – mais votre présence me charmait tant, me surprenait tant, même après toutes ces années au cours desquelles je vous avais vue très souvent, où j’avais voyagé avec vous, beaucoup bavardé, qu’au moment d’en être privée je sentais se creuser en moi une petite entaille.
Quand je suis rentrée après vous avoir vue devenir un point à l’horizon, j’ai cessé de penser à vous, d’évoquer votre image, dès la porte refermée. J’avais trop à faire, toute ma vie à organiser. Je me souviens que j’entrepris de visiter chaque pièce en détail – ce que j’avais déjà fait avant votre arrivée – imaginant ce que je mettrais ici, comment j’arrangerais là. Je n’avais pas à proprement parler d’idée de décoration mais je pensais: ce serait bien si cette chambre était bleue, là je pourrais dormir de temps en temps, il me faut des rideaux épais et très colorés, et suçant un bonbon je restais au seuil des pièces, les mains dans les poches, imaginant ma vie.
Si je veux être absolument sincère, je dirai que vous n’aviez pas vraiment de place dans mes projets. Pardonnez-moi. Mais comme mon installation dans cette île marquait le début d’une vie nouvelle, d’une nouvelle manière de vivre, il était assez naturel que je vous en exclue un tout petit peu, ne croyez-vous pas? N’auriez-vous pas fait la même chose? Vous allez me dire que jamais vous n’avez eu vous-même de projet de vie nouvelle et que vous regardez ces grandes décisions d’un œil un peu sceptique. C’est faux! Avez-vous donc oublié que vous avez souhaité vous marier? Et cela, n’était-ce pas une vie nouvelle? Si ce n’était pas une vie nouvelle je vous demande de me dire ce que c’était. Si vous me dites l’air piqué: «Un prolongement naturel», je vais vous regarder avec mon œil ironique (peut-être me donnerez-vous votre robe rouge, alors?).
Quand j’aurai détaché la barque il s’agira de ramer dans l’eau noire mais cela n’est pas désagréable. J’enfoncerai doucement les extrémités plates de mes rames dans l’eau, je m’efforcerai de faire le moins de bruit possible comme si je m’enfuyais d’un fort où j’aurais été condamnée à rester jusqu’à la fin de mes jours, je feindrai de m’évader. Il ne me sera pas très facile de me repérer car aux abords de l’île on ne distingue pas les lumières des rivages. Pendant un long moment on erre un peu dans les ténèbres, mais je me souviens qu’il faut d’abord ramer dans une certaine direction, garder ce cap un bon quart d’heure, puis les lumières du rivage commencent à apparaître.
Ce que nous souhaitons, vous et moi, c’est entrer dans la danse, n’est-ce pas? Faire partie du monde qui tourne en étant l’une ou l’autre des ouvrières qui actionnent une roue, et cela en tenue de travail, dans des conditions pas toujours agréables mais de telle manière que nous nous sentions dignes? C’est bien cela que nous souhaitons? Alors pourquoi vous décourager? La force de votre désir n’est-elle pas assez grande pour que vous vous mainteniez en toutes circonstances la tête hors de l’eau? Il faut croire que non puisque vous flanchez et m’appelez au secours, comme si moi, ma pauvre petite, comme si moi je pouvais venir en aide à qui que ce soit… Non, non, ne vous méprenez pas, je ne me défile pas. Je viens, j’accours, mais qu’espérez-vous? Mon affection va vous réchauffer un instant, et vous serez de nouveau aux prises avec ce que notre existence a de difficile.