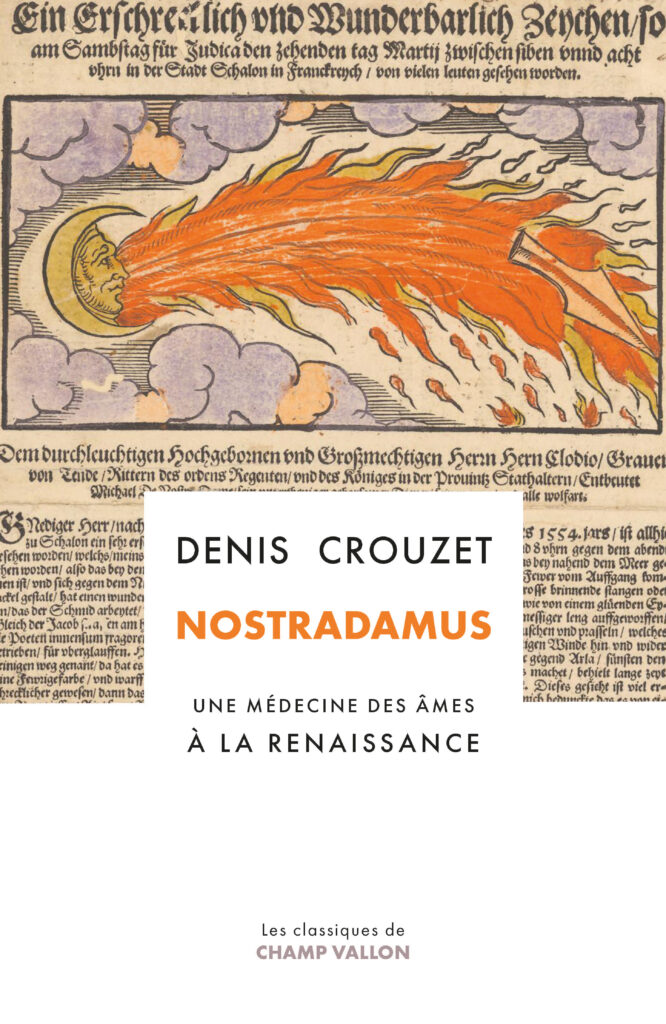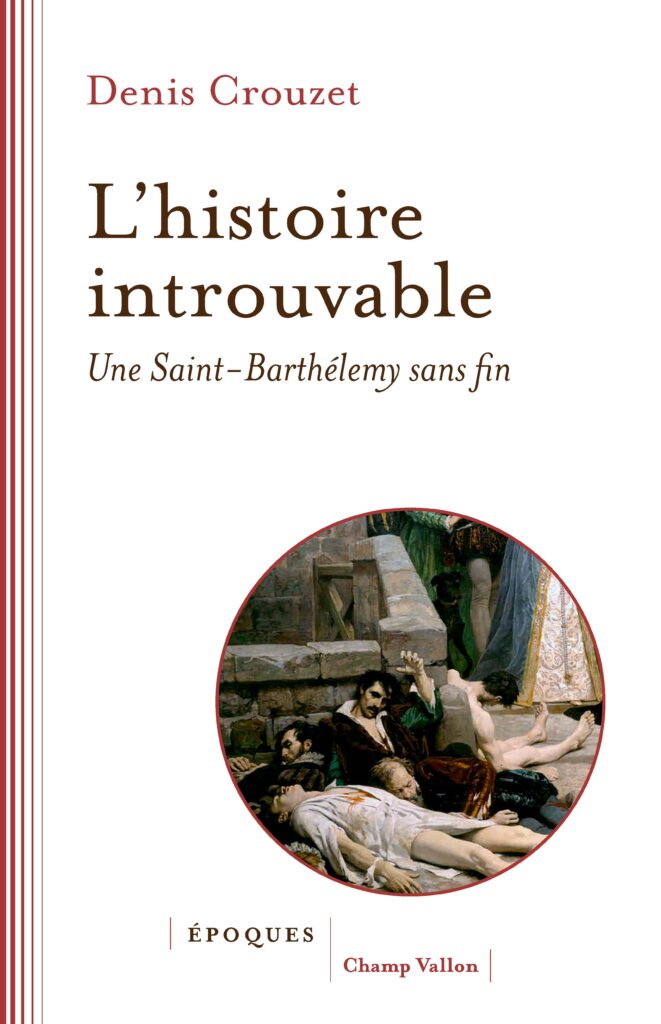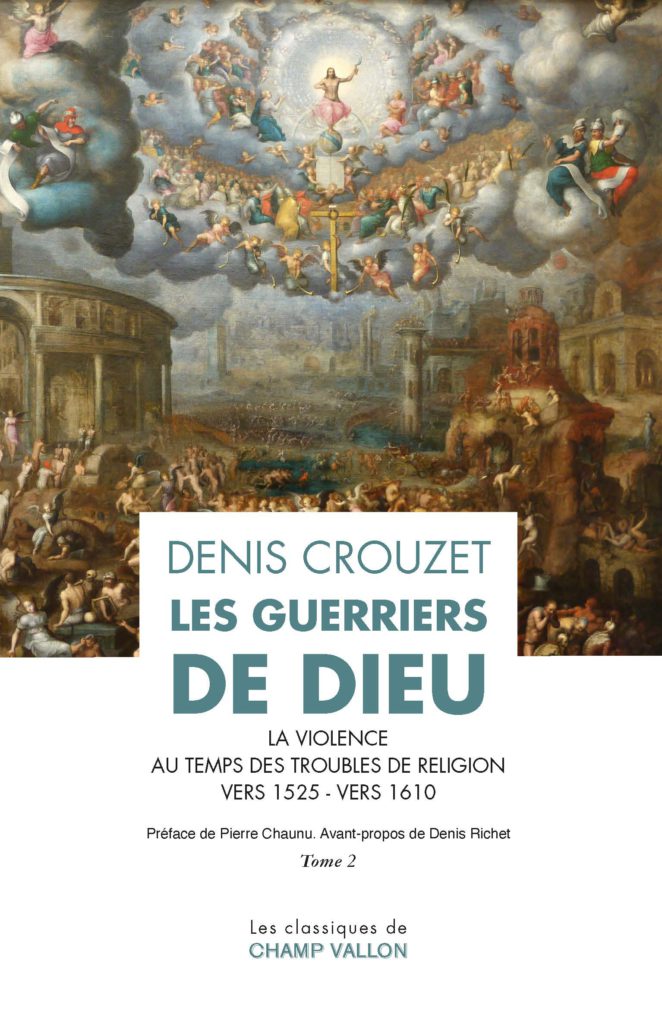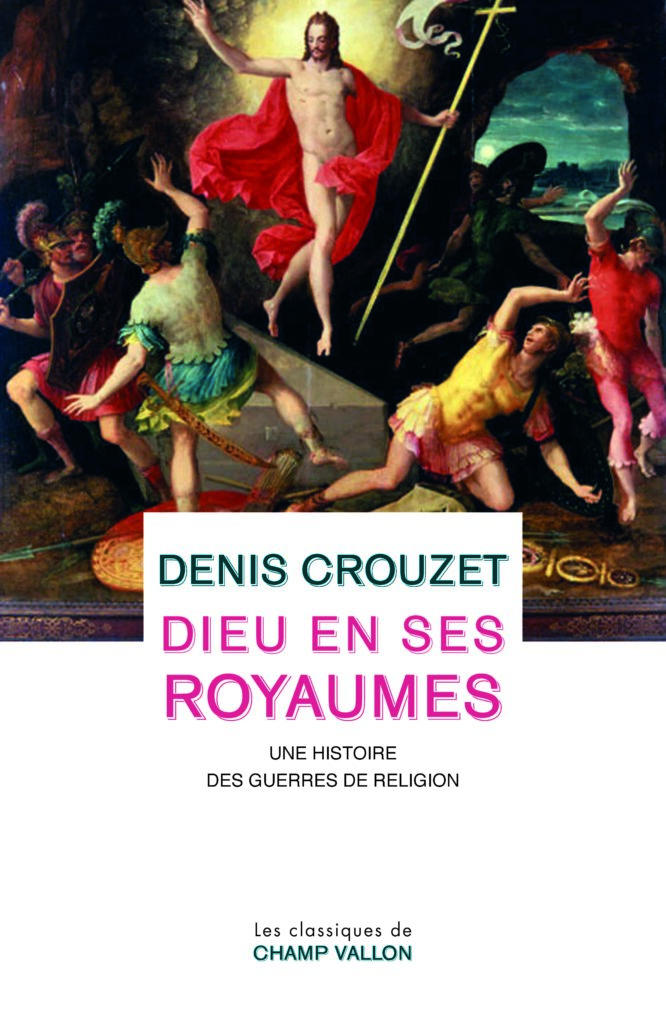Ses prédictions ont tant alimenté les pronostics les plus fous des marchands d’apocalypse qu’on en oublie que Michel de Nostredame (1503-1566), dit Nostradamus, était un homme de la Renaissance.
Pour Denis Crouzet, on s’évertue en vain à donner du sens à ses Prophéties, qui échappent précisément à toute tentative d’interprétation. Plutôt que de dire l’avenir, Nostradamus aurait voulu « prophétiser », c’est-à-dire délivrer aux hommes la parole de Dieu. En penseur du doute, il les conjure de prendre conscience de leur ignorance et de leur nature résolument pécheresse. Dans un siècle traversé par les violences les plus extrêmes, celui des guerres de Religion, Nostradamus est un chrétien doté d’une foi profonde, évangélique, qui, refusant les déchirements confessionnels, tente d’initier ses contemporains à une piété de l’intériorité fondée sur la présence, en soi, du Christ. Un rêve de paix intérieure inspiré par Marsile Ficin, Érasme et Cornelius Agrippa, et nourri par Marguerite de Navarre, la sœur du roi François Ier. Comme Rabelais, pour qui le récit burlesque était une thérapie contre les maux de ce temps, Nostradamus se pensait en médecin des âmes, en plus d’être un médecin des corps. Effrayant ses lecteurs en leur dévoilant des lendemains terribles et menaçants, il leur montrait que la haine était le plus grand des périls et que le seul remède était de vivre dans l’amour et la paix du Christ.
Professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Paris IV-Sorbonne, spécialiste des guerres de Religion et des pratiques de violence à la Renaissance, Denis Crouzet construit une œuvre pénétrante, de ses Guerriers de Dieu (1990) au récent Paris criminel. 1572 (2024), en passant par Michel de L’Hôpital (1998) et Christophe Colomb (2006). Réédition de l’édition Payot (2011).