OLIVIER BARBARANT Temps mort
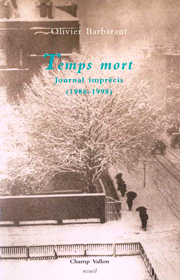
« À reprendre la première phrase de ce journal, en date de 1986, je ne perçois guère de changements en moi-même. Une plus grande simplicité peut-être (mais tout changement doit-il nécessairement relever du progrès » ? n’est-ce pas là une vaine consolation imaginaire, pour se féliciter d’avoir vieilli ? et la vie commune à présent avec une femme, qui m’épargne l’ancienne hystérie du désir – encore que. Davantage de bonheur, et surtout plus de capacité à s’extraire des ennuis quotidiens où je croyais alors trouver je ne sais quelle clé, quelle porte sur la pensée, confondant un peu trop peut-être … (lire la suite)
OLIVIER BARBARANT Odes dérisoires
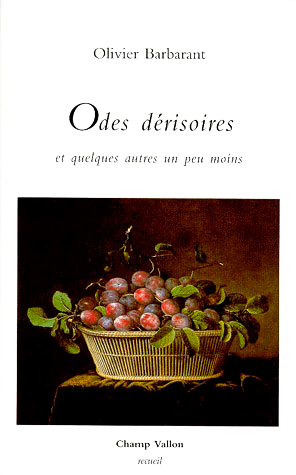
« Un chant précaire, qui tient cependant à chanter, et prétend même se réclamer de grandes formes pour célébrer les tressautements de l’âme: mes émotions sont dérisoires — et j’y tiens. Un goût prononcé pour la disparate: des tas de prunes et Caravage, Aragon et la cathédrale de Laon, des passions anciennes et de plus récentes, des fontaines et du goudron, des lycéens et un vieillard, Bérénice et des fêtes foraines… En amour, je ne choisis pas. Un portrait en feu, et dans tous les sens qu’on voudra… »… (lire la suite)
OLIVIER BARBARANT Louis Aragon
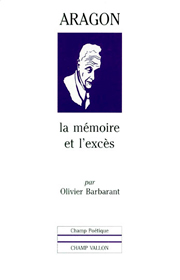
Concernant Aragon, l’homme et ses ambiguïtés éclipsent l’œuvre et ses réussites.Sa poésie souffre particulièrement d’un état de fait: trop connue, et donc méconnue, elle se voit réduite à quelques vers célèbres, quelques dates circonscrites, quelques légendes (Elsa, la résistance, l’Histoire…) jamais véritablement lues.Pour la première fois depuis la mort de l’auteur, le livre veut donc relire la totalité d’une trajectoire poétique qui ne se réduit ni à l’usage du vers, ni à l’imitation, ni à l’exploitation de quelques grands thèmes. De 1919 à 1982, Aragon débat… (lire la suite)
OLIVIER BARBARANT Douze lettres au soldat inconnu
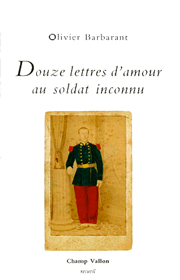
Quoi de plus raide, et ennuyeux, qu’un mythe national? Le culte qu’on lui rend sert à fossiliser la mémoire: il fait écran à l’histoire, à ses drames, à la tragédie. Avant sa gloire — paradoxale puisqu’elle l’éclipse — le soldat inconnu était pourtant un homme. Cette évidence sert de point de départ à une correspondance imaginaire adressée par un jeune homme d’aujourd’hui à celui de jadis, pour tenter de redonner vie à celui qui a, donc, doublement disparu. L’entreprise, folle, de retrouver le poids de chair d’un cadavre enclenche alors une série de métaphores croisées: à sa guerre répondent d’autres malheurs, à sa mort d’autres morts, à son… (lire la suite)