JEAN-MICHEL RABATÉ La pénultième est morte
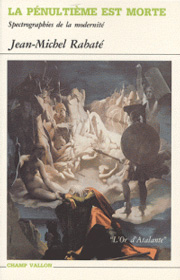
La question d’une histoire de la modernité et d’une redéfinition de ses critères réunit les dix essais formant ce recueil. L’auteur explore ici l’archéologie du concept de « modernité » au sens philosophique (Spinoza, Marx et Freud servent de repères privilégiés) et artistique à la fois.Dans ce domaine, le concept naît d’un soubassement français (Rimbaud, Verlaine et Mallarmé) pour aller vers des métamorphoses plus récentes (Breton, Beckett) ou contemporaines (les essais-romans de Barthes, la poésie de Michaël Palmer).… (lire la suite)
JEAN-MICHEL RABATÉ La beauté amère

Autant Freud avouait n’avoir que peu de choses à dire sur la beauté, autant les écrivains nous disent combien le côté ineffable, voire mystique, d’une expérience du beau se trouve pris d’avance dans une fiction, dans une intrigue qui se noue aux racines de la subjectivité. Genèse du récit, généalogie des pulsions: l’auteur reprend le fil des concepts psychanalytiques, et montre en quoi les silences de Freud, ses réticences mêmes, ouvrent une problématique, développée par Lacan, qui forme peut-être l’envers des esthétiques classiques. La notion d’une beauté tragique de l’entre-deux-morts, écran tendu sur la fascination du vide et de… (lire la suite)
JULIEN MILLY Au seuil de l’image

Lieu d’où ressort une puissance de métamorphoses, le seuil ouvre l’image au déséquilibre. Cet ouvrage met en évidence les différentes identités de l’entre. Y sont saisies des organisations spécifiques de l’intermédiaire : de la peinture (Veneziano, Botticelli, Vermeer, La Tour, Rembrandt, Music, Velickovic) à la poésie (Bonnefoy, Jabès), de la photographie (Alain Fleischer, Jeff Wall) aux installations (Christian Boltanski) et au cinéma (Bergman, Antonioni, Sokurov, Claire Denis). Des œuvres filmiques contemporaines (Kiarostami, Lars von Trier, Wong Kar-Wai) précisent les caractéristiques actuelles d’une écriture du … (lire la suite)
CATHERINE MAVRIKAKIS La mauvaise langue

La langue n’est-elle pas, par définition, inadéquate, mauvaise? Pour pallier ses défauts, le linguiste, l’écrivain, le philosophe ou le fou se met à l’écoute; il entend dans une autre langue ce qui ne pouvait s’énoncer dans l’impureté de la sienne propre.
Travaillant le concept de crypte, l’auteur met au jour, à travers les œuvres de Mallarmé, Nodier, Hölderlin, Khlebnikov, Hofmannsthal et le cas Schreber, les filiations ratées entre la langue pure et la langue familière, les généalogies impossibles entre langue morte et langue vivante, les héritages impensés du père au fils, de la mère à la fille, les contaminations terrifiantes du … (lire la suite)