MURIELLE GAGNEBIN et JULIEN MILLY (dir.) Les images honteuses
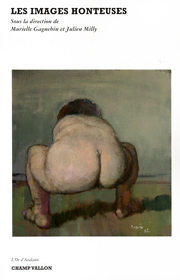
Il y a des images propres à représenter la honte et, à côté, des images éhontées, enfin des images qui éprouvent, en leurs plis, la honte. Dira-t-on que notre culture se plaît à jouer avec l’impudeur, l’opprobre, l’abjection? Cherche-t-elle à les piéger ou à les exalter? Que signifie la tentation du snuff movie: ces films «interdits» qui veulent capter le travail du trépas sur les visages ou dans les postures ultimes, et ainsi porter atteinte à ce qui est au plus profond de l’être, à l’identitaire ?
C’est de «la gale de la psyché», de l’esthétique du laid devenu «trash», «destroy», apologie de l’immonde qu’il est ici question. «Rougir de honte»… (lire la suite)
MURIELLE GAGNEBIN et SUZANNE LIANDRAT-GUIGUES (dir.) L’essai et le cinéma

Appliquée au cinéma que devient la notion d’essai qui a ses lettres de noblesse en philosophie ou dans le domaine littéraire ? On constate que le terme est doublement revendiqué par les cinéastes eux-mêmes et par la critique. Mais les uns et les autres l’envisagent-ils semblablement ? De fait, l’essai au cinéma peut revêtir plusieurs significations que les chapitres de cet ouvrage examinent tour à tour. Une première partie regroupe les textes qui ont trait à l’émergence historique du terme tandis que, dans la seconde partie, d’autres tentent de décrire quelques mécanismes psychiques de la création propres… (lire la suite)
MURIELLE GAGNEBIN (dir.) Yves Bonnefoy : lumière et nuit des images

Habitée par l’énigme, l’image ne cesse de nous provoquer dans nos certitudes et ouvre au «leurre» comme à la «présence», dirait Yves Bonnefoy. Dans ce livre qui est consacré à son œuvre, l’image se trahira sans cesse: éclaire-t-elle ou trompe-t-elle l’être dans son rapport au monde ? Lumière ou nuit de l’image?
Parfois le poète se prononce en faveur de l’image: «L’homme a besoin d’images». Yves Bonnefoy invoque alors «le blé de l’image», mais ailleurs il la dévalorise et va jusqu’à mentionner «la boue de l’image aux yeux déserts», voire sa disparition: «Et bientôt même il n’y a plus d’image», car «leur syntaxe est incohérence, de la cendre».… (lire la suite)
MURIELLE GAGNEBIN (dir.) Les images parlantes
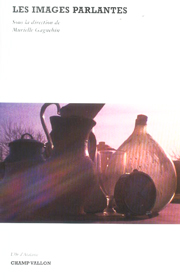
Les Images parlantes : l’étrangeté habite ce titre !
Les détournements de l’image vers quelque langage codé, les contrebandes de l’image au gré de textes particulièrement transgresseurs (hiéroglyphes aventureux, cryptogrammes religieux, trésors de l’iconologie, subversions insolites de l’Art brut, mécanismes sulfureux du rêve, étranges translations d’un langage dans un autre), les transports sur la langue sont multiples.
Une évidence s’impose donc: l’image ne parle pas, mais elle doit être parlée. Dès lors s’ouvre le domaine des fables et des fictions émanant de l’image elle-même, aptes toutefois à la spécifier comme à la sonder… (lire la suite)