JEAN-PAUL GOUX Tableau d’hiver
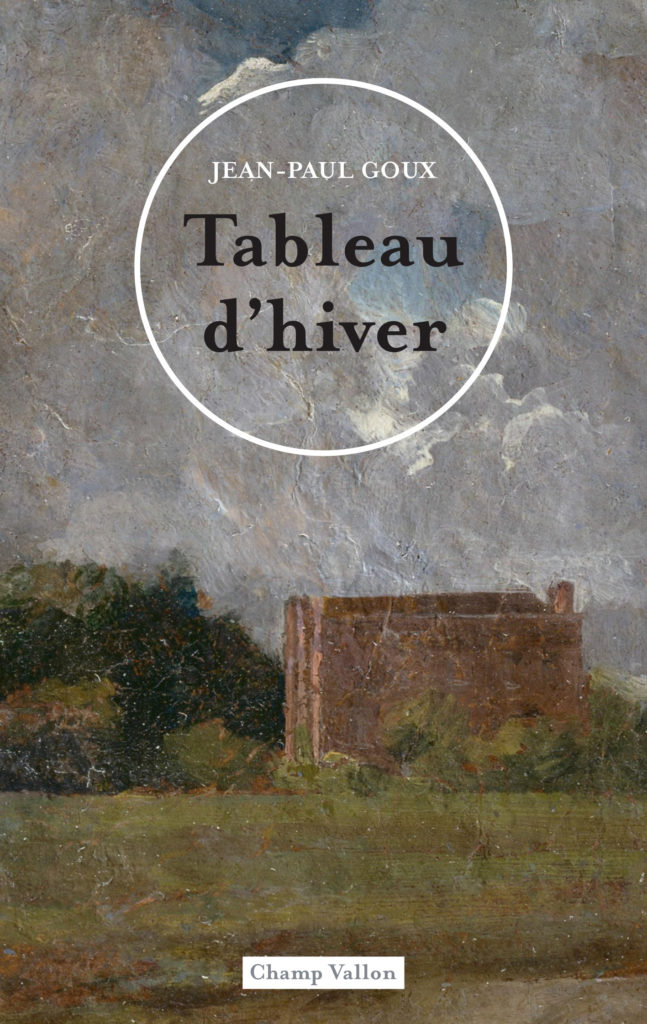
«De telles pensées, ces pensées vivantes de votre absence, je devais apprendre à vivre avec elles, comme j’apprenais à vivre seul avec votre maison. ». Le roman de Jean-Paul Goux s’écrit avec délicatesse autour de la mort de Claire, compagne de Thibaud le narrateur, et artiste qui dessinait au crayon et au fusain des nuages et des arbres contemplés par la fenêtre de leur appartement parisien, mais surtout de sa maison Au milieu des bois. Une maison dans laquelle Thibaud veut peu à peu réapprendre à « habiter le temps ». Or, cette maison offre un espace dans lequel s’est déposé et se dépose le temps, temps passé avec Claire, temps présent … (lire la suite)
LE MAGASIN DU XIXe SIÈCLE N° 11
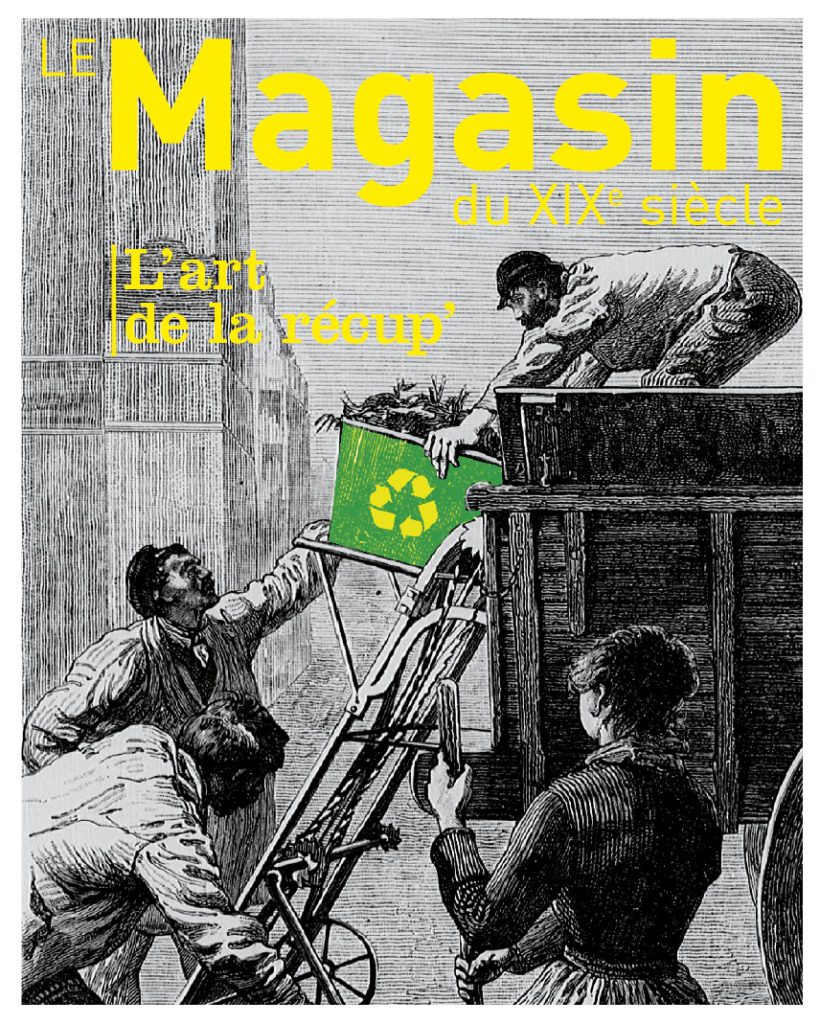
«L’art de la récup’
Leur XIXe siècle : Entretien avec Michelle Perrot, par Jean-Yves Mollier
Dossier : L’Art de la Récup’
« Faire du neuf avec du vieux » : la récupération des détritus de tous ordres
Denis Saillard « Métamorphoses alimentaires à Paris au xixe siècle »
José-Luis Diaz « Balzac bric-à-brac »
Jean-Didier Wagneur, « Privat d’Anglemont : « dirty jobs » »
Marine Le Bail « La bibliophilie du rebut »
Jean-Yves Mollier « Le guano »
Shoshana-Rose Marzel « Un mal-aimé : le vêtement d’occasion dans le roman du xixe siècle »
Plagiat, viralité, copier-coller : l’art d’accommoder les restes culturels et littéraires … (lire la suite)
PAULINE VALADE Le goût de la joie
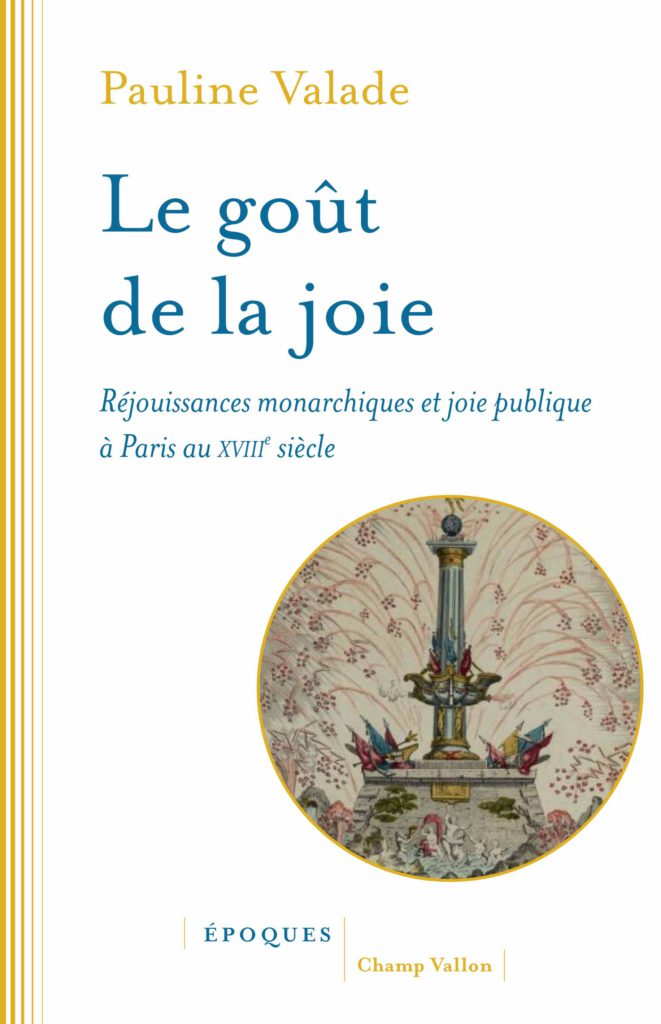
Au XVIIIe siècle, Paris célébrait chaque événement heureux pour la Couronne. La Maison du Roi, le Bureau de la Ville et le Châtelet de Paris organisaient les réjouissances. Les manifestations de joie étaient donc contrôlées par les autorités qui y voyaient les signes tangibles d’une communion avec les sentiments du souverain. Pour autant, l’expérience de la joie publique n’était pas celle d’une obéissance passive. Les Parisiens s’appropriaient les réjouissances aussi bien en participant qu’en détournant certaines normes de réjouissances. Ils fabriquaient leur propre culture de l’approbation, empreinte d’une critique à peine… (lire la suite)
PHILIPPE MEYZIE L’unique et le véritable
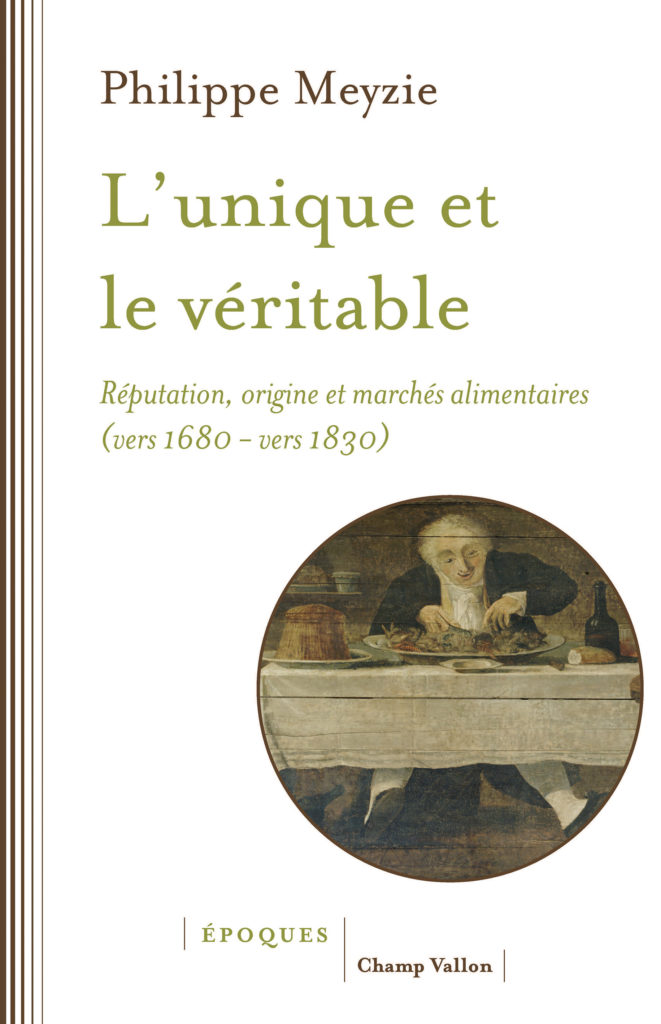
En France, l’histoire des appellations d’origine s’inscrit dans le temps long. Dès la fin du XVIIe siècle, la réputation des aliments associés à un lieu s’affirme pour distinguer les produits jugés les meilleurs. Bien loin d’un simple déterminisme naturel, le sens et la valorisation de cette identification territoriale durable sont un processus complexe où se mêlent savoir-faire techniques, stratégies commerciales, discours savants et goût des consommateurs. Comprendre pourquoi l’origine devient le critère d’une qualité supérieure attendue conduit à s’intéresser aux rôles décisifs des marchands, des consommateurs et des … (lire la suite)