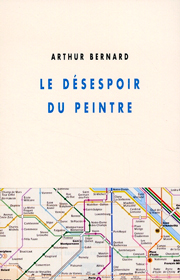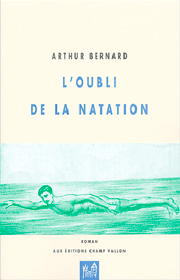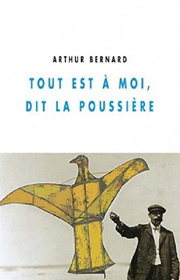« Seul en ce moment, je le suis mais pas complètement. Nulle femme en vrai à mes côtés mais une en peinture, une carte postale, souvenir d’une dame et d’un voyage à Amsterdam. J’y étais allé en solitaire, pas en touriste un accompagnement à mon bras mais seulement pour les canaux, leur eau sale et la peinture à l’huile. J’ai toujours aimé la peinture et admiré les peintres, leur désespoir quand la réalité résiste à leur entreprise, le désespoir du peintre c’est également une fleur, une saxifrage, rouge, rose, verte ou encore blanche. Fleurir c’est périr, ce que dit la fleur au peintre qui s’évertue à éterniser sa vie fragile. Ce goût, je le tiens je crois de l’enfance et de mon pépé, peintre du dimanche il était. »
Arthur | BERNARD
- Paru en Paru le 23 janvier 2009
- 12 x 19 cm, 256 pages
- ISBN 978.2.87673.498.2
- 18 €
Gabriel, alias Gaby, raconte la guerre telle qu’il l’a vécue avec sa mère depuis le jour de sa naissance en juin 1940, en pleine débâcle. Cela se passait au bord d’un fleuve, à l’époque violent et tumultueux, le Rhône pour le nommer. Et Gaby a passé toute la guerre seul avec Maman jusqu’au retour de Papa, qu’il n’avait jamais vu puisqu’il était prisonnier dans un camp, en Prusse orientale. Enfance heureuse, bienheureuse, paisible malgré la guerre et les bombardements de la Libération au cours desquels la mère et le fils auraient pu, comme d’autres, périr écrabouillés. Cela se déroulait pendant la première moitié du vingtième siècle et Gaby revient sur les lieux en l’an 01 du vingt et unième, en pleine paix, pour assister à la mort de sa mère.
Comment dire la difficulté de naître dans des circonstances historiques, exceptionnelles, d’avoir de ce fait incarné l’avenir, l’espérance en des temps désespérants et ensuite, sa vie durant, se sentir décevant, pas à la hauteur des circonstances, des événements, quels qu’ils fussent ? Et surtout comment dire la guerre avec sa mère, du commencement à la fin ?
Revue de presse
Politis
(2-8 février 2006)
Couper le cordon
Faire et défaire les liens de la mémoire, selon Arthur Bernard.
IL AURAIT PU COMMENCER par: «Je suis né libre et nulle partie ne suis dans les fers. » Mais cette phrase en clin d’oeil à Rousseau («L’homme est né libre, et partout il est dans les fers »), il lui faudra perdre sa mère et achever ses propres mémoires pour arriver à l’écrire. II a donc opté pour «Mon nom c’est Gabriel… ». Un incipit plus simple et surtout plus juste. Car son prénom fut sa première chaîne. Né en juin 1940 pendant la captivité de son père, le narrateur a été consacré archange par sa mère, qui a vu en lui une promesse d’espoir. Gage ou défi plutôt lourd. « Force de rien du tout», enfant doué pour la chute, au propre et au figuré, il ne pouvait, en grandissant, que décevoir. Paradoxalement, puisque sur fond de conflit mondial, ses premières années furent les seuls moments de paix dont il garde le souvenir. Dans le titre du roman, la Guerre avec ma mère, il faut donc d’abord entendre «la guerre passée avec ma mère», en référence à ces temps de ravissement. Et, au‑delà seulement, l’évocation du combat symbolique et initiatique de Gabriel pour se dégager des fers maternels «invisibles et doux et partant d’autant plus solides et difficiles à briser». C’est d’ailleurs, pour tout dire, la mort qui s’en est chargée.
Le jour du décès de sa mère, Gabriel est retourné sur les bords du fleuve qu’il avait traversé nouveau-né dans ses bras tout-puissants qui le protégeaient des bombes. D’une naissance‑miracle à une mort-révélation, de l’origine d’une dépendance quasi pathologique à une douloureuse libération, il y a, dans la reconstitution du narrateur, comme des mouvements de passage d’une rive à une autre. Le fleuve au bord duquel il est né (le Rhône) joue la ligne de fuite et le point d’ancrage, la métaphore et la substance, Styx ici, climat là. «L’ascension, l’élévation m’ont toujours effrayé, la crainte de ne pas être à la hauteur autant que la peur de dégringoler. Je préfère ce qui vous emporte, le fil de l’eau, le coup de vent.» Une ponctuation perturbée qui chahute le flot des phrases, des parenthèses insidieuses qui brisent la surface du propos, des traits d’humour immergés, un débit ondulant mais décidé, une oralité très écrite cherchant le naturel, un élan répété entre le passé et le futur antérieur… l’écriture prolonge le rapport au fleuve. Le récit de Gabriel, qui gagnerait presque à se lire à haute voix, oscille entre la déposition et le commentaire, avec la gaucherie typique du grand garçon qui dit «Maman», et la mélancolie, tantôt furieuse tantôt spirituelle, de la personne célébrée à son corps défendant. Les «mémoires» de cet homme «fait avec les défaites qu ‘il faut pour y arriver» s’apparentent davantage à un processus de re-création par franchissements successifs qu’à un rapport linéaire de soi sur soi. «Fiction de ma vie», résume-t-il, pas dupe des circonstances qui l’amènent moins à se remémorer qu’à «broder» sur ce qu’on lui a raconté. Et à donner, par là même, une certaine définition de l’autobiographie.
Ingrid MERCKX
Livres-Hebdo du16 janvier 2006
Le livre de la mère
Arthur Bernard est cet écrivain entré en literature avec Les Parapets de l’Europe, premier roman paru (sous le nom de Jean-Pierre Arthur Bernard) en 1988 aux editions Cent pages, maison où il continua régulièrement de publier. Bernard fit un saut chez Minuit, le temps de La chute des graves (1991), et se présente depuis 2004 (et L’oubli de la natation) sous la couverture de Champ Vallon, ce qui montre que l’homme sait choisir ses éditeurs, à moins que cela ne soit le contraire.
La guerre avec ma mere, son nouveau roman, donne la parole à Gabriel, ou Gaby, alias La-Force-de-Dieu. Celui-ci a grandi seul avec sa mère. Son père n’était pas présent au moment de sa naissance, un mardi de juin, il faisait la guerre, la «Seconde Mondiale», «en fait ne la faisait plus, l’ennemi l’ayant capturé et désarmé», avant de l’expédier au stalag en Prusse orientale.
En ces temps de débâcle, d’effondrement, d’exode et de bombardements, Gabriel fut consacré «Prince espérance», véritable centre du monde, sa bouche goulue collée au sein de «Maman». Après cinq années entre les barbelés, son père allait rentrer à la maison. Il lui apprendrait le cyclisme, le dimanche après-midi.
Petit, Gaby lisait et relisait des histoires d’avion et d’aviation, écoutait une mère qui le protégeait en permanence et lui parlait même la nuit. Elle lui racontait souvent cet épisode survenu le dernier été de la guerre lorsqu’un officier allemand, tenant son cheval à la main, avait fait son entrée dans la cour de la maison. L’animal était jaune pâle (on appelle isabelle cette couleur café au lait), l’homme portait des sandalettes de cuir tressé (et faisait penser à Napoléon III). Il cherchait du cirage, non pour lui, mais pour les sabots de la jument…
Lunaire et attachant comme son héros, La guerre avec ma mere est également jalonné par un éléphant en bois peint en vert et rapporté d’Allemagne, un exemplaire du Livre de la jungle où Mowgli traverse la savane d’un pas léger, et des tournures espiègles telles: «la réalité c’est un zèbre au galop dans la nuit étoilée» ou « c’est une supériorité de l’enfance que de tout ignorer du tourisme, cette maladie du mouton».
Alexandre Fillon
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné
Vendredi 3 février 2006
Le titre, à plus d’un titre
Le titre, au vrai, peut prêter à confusion, puisqu’il paraît loisible de le lire de deux façons. Comment comprendre cette Guerre avec ma mère, que la couverture du livre annonce? Soit on entend par là que le narrateur a vécu une guerre en compagnie de sa mère, soit on admet l’hypothèse que le narrateur a déclaré la guerre à sa mère et que cette dernière le lui a bien rendu. De prime abord, c’est la première hypothèse qui semble la plus plausible, en ce que le lecteur apprend d’emblée que le narrateur est né lors de la débâcle de juin 1940 dans une ville du bord du Rhône (qui pourrait bien être Valence) et que, son père étant alors en captivité en Prusse orientale, il a vécu les quatre premières années de sa vie dans la seule proximité de sa génitrice. C’est précisément là que le bât blesse… Le père étant absent pour une durée indéterminée, la mère reporte sur cet enfant unique toutes ses attentes et son affection. Ce dernier naît avec un catastrophique handicap: on escompte tout de lui, puisque «pour eux c’était un signe du ciel que mon arrivée dans ce merdier». Se trouver d’entrée ainsi promu au grade de «Son Altesse Sérénissime le Prince Espérance» (cela se nomme aussi un titre) ne présente pas que des avantages; et peut même se révéler d’un redoutable encombrement.
Car au surplus d’être venu au jour quand le monde n’était plus qu’une immense nuit, notre aimable narrateur fut affublé, à sa naissance, d’un prénom délicat à porter: il a été baptisé Gabriel, à l’instar d’un fameux archange de la littérature biblique, dont le nom en hébreu signifierait « La-Force-de-Dieu». C’est beaucoup pour un seul homme. D’autant que l’on sent bien que, de Dieu, le cher petit Gaby n’a guère la robustesse: brave type, à l’évidence intelligent, mais pas un foudre de guerre – un peu désordonné dans l’expression et largement dépassé par les événements. Du coup, pour tenter d’échapper à l’étreinte permanente de cette mère trop aimante, abusivement possessive, le gamin lâche la bride à son imagination, se réfugiant dans la lune… ou bien dans le jardin de ses grands-parents: «Les ruches de Grand‑Père et ce mur blanc, très blanc, me sont restés comme l’empreinte d’un été éternel et absolu, immobile et bourdonnant, tranquille et inquiétant, une sorte de Grèce locale et domestique».
Pour son huitième roman, un ouvrage nettement à part dans Ia bibliographie de l’auteur, Arthur BERNARD se livre à une flânerie plus étonnée que nostalgique dans les jeunes années de… de qui, au fait? Car, comme son personnage, le romancier grenoblois est effectivement né à Valence en 1940. Disons que si ce n’est lui, c’est donc son frère; et que, par conséquent, cette proximité imprime un ton particulier au récit. Bien que tressautant (Arthur BERNARD a fait de sa syntaxe hagarde et désorientée une sorte de marque de fabrique), l’écriture semble ici plus posée, plus apaisée, plus tendre peut-être même. Au fur et à mesure que l’on avance dans les pages, les mots se chargent d’une émotion d’autant plus palpable, qu’elle se refuse aux grandes orgues. La mort de la mère, qui clôt le livre et lui confère sa raison d’être, se révèle d’une déchirante sobriété: pudique infiniment, sans pathétisme aucun, juste terriblement désemparée. Avec ce décès, c’est (faute de combattants) la guerre qui cesse; et à plus d’un titre.
Jean-Louis ROUX
- Paru en Paru le 17 janvier 2006
- 12 x 19 cm, 128 pages
- ISBN 2.87673.431.1,
- 13 €
Ce roman enlevé met en scène les aventures de Gabriel Lavoipierre, âge, occupations, goûts indéterminés. Il habite une maisonnette dans un petit port de pêche aux aspects riants, à l’ouest sur la carte. Il fréquente les pêcheurs, qui tous possèdent un surnom qui les identifient à leur spécialité : Gas-Oil, Diesel, Sans-Fil, à un pays lointain qu’ils ont connu : Costa-Rica, à un tic de langage : Bonjour-Bonjour. Ils se voient Chez Loulou, un bar sur le port, tenu par Louise, une belle personne revenue de beaucoup de bars et de ports. Il y a aussi les maraîchers dans le décor, mais on ne les voit guère; les voisines, héritières de la Conserverie; une cohorte de dames d’âge, toutes de noir vêtues. Il y a des histoires de motos, de filles. Et ça finira mal.
Ainsi va la vie bien réglée dans le petit port de R. Mais tout n’est peut-être pas si lisse. Il y a peut-être des secrets, de sales histoires, par exemple le naufrage de la Captivante.
Il y a aussi des questions, celles que se pose Gabriel, venues de livres lus dans le temps ou qu’il invente et celles (les plus nombreuses) qu’il ne se pose jamais. Il y a aussi tout ce qu’on oublie et ce qu’on n’oublie jamais : l’éducation de maman, au siècle dernier, la lecture, la bicyclette et la natation.
Lire un extrait
L’oubli de la natation
L’extrait (pp. 7-22)
Chapitre Un
Aujourd’hui le pêcheur a apporté des maquereaux, ce n’est pas la première fois qu’il vient. Cette fois-là, la première (il y avait quelque temps déjà que j’étais installé dans la maisonnette), il avait précisé, parlant des maquereaux Vous pouvez y aller, ils sont pêchés de cette nuit, il voulait dire les manger sans crainte. Je sais, j’avais répondu, je vous ai entendu rentrer, je reconnais votre moteur. À l’époque, on se vouvoyait. Il avait paru surpris, ou flatté, que je sois réveillé de si bonne heure, que j’ai l’ouïe assez fine ou exercée pour identifier sa mécanique, ils sont une kyrielle l’un derrière l’autre, je les écoute, gisant dans mon lit quand à cette heure j’y gis, sans dormir, j’ai dans l’oreille la plupart de celles sonnées au carillon du salon, un Westminster, le salaud, il les redouble!, il faudrait qu’un jour j’arrive à lui couper le sifflet, m’en débarrasser, assis à la table de la cuisine si j’y suis, devant du café et sous la lampe, il est trop tôt pour ouvrir les volets, regarder par la fenêtre qui donne sur l’anse, l’entrée du port, souvent il fait nuit. J’écoute les moteurs, voix régulières, les accès, les ratés, l’emballement final, le crescendo avant le decrescendo, le silence enfin, quelquefois brisé par une dernière quinte, là je sais qu’ils sont à quai. C’est vrai que le Va-toujours (c’est ainsi qu’il s’appelle) possède une voix qui me paraît singulière, tantôt unie, tantôt saccadée, legato, staccato, une façon qui est sienne, une fois je l’ai vu, entendu rentrer seul, après les autres bateaux, c’est peut-être depuis ce jour-là que je l’ai dans l’oreille.
– C’est un bon bateau, le Va-toujours, dit toujours le pêcheur avec affection, il apprécie que je l’identifie comme on reconnaît quelqu’un à son intonation, son rire, pour lui son bateau, c’est une personne. – Tu peux les faire griller (on se tutoie depuis un bout de temps), c’est bon aussi au four, a-t-il ajouté aujourd’hui au moment de partir sans regarder en direction d’un présumé four, il n’y en a pas dans la maisonnette.
Comme d’habitude, les maquereaux étaient enveloppés dans deux pages de journal grossièrement ficelées, papier poissé de sang, pourtant ils ne les pêchent ni au harpon ni à l’hameçon, plus d’une fois je me suis fait la remarque. Il n’apporte que des maquereaux, n’attrapent-ils jamais autre chose? ça aussi il arrive que je me le dise, puis n’y pense plus, assez vite. J’ai jeté un coup d’œil au journal sans défaire le paquet, les nouvelles avaient cinq jours, rien de bien saisissant dans ce que je pouvais déchiffrer, près d’ici, déviation de la départementale 59 pour travaux, ailleurs, loin d’ici, sur la nationale 133, trois kilomètres après Hagetmau, collision frontale sur une ligne droite, quatre jeunes gens, fracassés dans deux autos, aucune nouvelle de la rue de la Gaîté, une rue que je connais pas mal, pas de nouvelles non plus de la rue de la Convention, une rue que je ne connais pas bien. D’ailleurs, je n’aime pas les maquereaux, le goût est trop fort, trop d’arêtes, on emboucane le quartier en les faisant griller, on s’emboucane soi-même, question de vent dominant. Il y a un barbecue au fond du jardin, derrière la maisonnette, je ne m’en suis jamais servi, il ressemble à une ferraille, et puis vous me voyez en train de faire griller des maquereaux pour moi tout seul? au four ça pue moins c’est sûr, après il faut nettoyer, surtout il faudrait que j’achète un four, c’est ce que j’avais envie de répondre au pêcheur, j’ai seulement glissé: – Merci, merci beaucoup, j’hésite, de toute façon je vais me régaler.
Dès qu’il a été parti, le verre rincé, la bouteille dans le casier à bouteilles vides dans le cellier, pas loin du casier à bouteilles pleines, je me suis demandé une fois de plus (je connaissais la réponse) ce que j’allais faire des maquereaux. La poubelle? pas question, ça se saurait, les donner aux chats?, ceux d’alentour viennent rôder (je n’ai pas de chat si j’en ai eu un), pas question non plus, ils se battraient, traîneraient les maquereaux partout dans le quartier, vous imaginez la honte Vous voyez ce qu’il fait de ce qu’on lui donne, et de bon cœur encore!, comme d’habitude, je les ai enterrés au fond du jardin, derrière la maisonnette, il y a là un véritable cimetière de maquereaux. Quelqu’un qui m’observerait – un mur assez haut me sépare des voisins que je ne vois jamais, il y a aussi une haie de pyrachantas de mon côté, on s’y piquerait si on ne faisait pas attention mais à l’automne l’arbuste donne de belles baies rouges, un buisson ardent – se demanderait ce que j’enfouis, ce que j’ai à cacher au fond de ce trou emballé dans un journal. Avec ma bêche, ma pelle, mes bottes de caoutchouc jaune, je dois avoir drôle d’allure. J’aime bien le pêcheur si je n’aime pas ses maquereaux (je ne les ai jamais goûtés), il m’arrive de le croiser dans la rue en fin de journée, il m’entraîne pour l’apéro Chez Loulou, c’est un café sur le port, le seul fréquentable, le seul que je fréquente en tout cas, j’insiste pour payer le coup, il dit que c’est sa tournée, il la paie, je paie la suivante. Alors ils étaient bons? demande-t-il, parlant des maquereaux. Délicieux, je réponds, finissant mon verre de blanc, je les ai faits au four. Jamais il n’interroge Il est où, ton four?
Le pêcheur a des amis, les autres pêcheurs, je dirai plus loin leurs noms, avec le temps j’ai appris à les connaître, pas tous, en fait ce sont des sobriquets, les vrais noms je les ignore, je serais incapable de les retenir, imagine-t-on le pêcheur ami avec un maraîcher? Les maraîchers, j’en parle parce qu’ils sont dans le décor, installés près de l’embouchure, de l’autre côté de la rivière qui se jette là dans la mer, des lignes et des lignes de serres, tunnels annelés de plastique opaque et blanc, aussi des cabanes, les maraîchers travaillent dedans, on les voit entrer et sortir, transporter des choses, sacs, instruments, plastique assez opaque pour qu’on ne distingue pas ce qu’ils font exactement. Non, maraîchers et pêcheurs ne s’aiment pas, vieilles histoires, querelles dont je ne sais rien, ne veux rien savoir, des fois ils se font des misères, en viennent aux mains, la boisson n’arrange rien, bagarres singulières, bataille rangée, on dit alors une générale, (je n’ai rien vu de tel jusqu’ici, sauf des regards noirs, des mâchoires serrées), il faut appeler la gendarmerie, la plupart du temps les choses rentrent dans l’ordre avec le dégrisement. Un jour ça finira mal, prédit madame Bleusse qui tient l’épicerie-tabacs-journaux sur le port, j’y achète l’épicerie, pas de tabacs qui sont au pluriel sur l’enseigne, je ne fume pas, mais des journaux, je lis la presse, la parisienne surtout, quand je languis de la rue de la Gaîté, que je voudrais en connaître les nouvelles, celles du quartier, j’en trouve rarement, pour ainsi dire jamais. Je réponds à madame Bleusse que si elle le dit, ça va certainement arriver, elle connaît la vie d’ici puisqu’elle en est. Elle conclut, hochant la tête Les uns sont de la terre, les autres de l’eau. Je rétorque que c’est bien résumé.
Il m’arrive de boire des coups, jamais moins de deux, rarement plus de trois, quatre le grand maximum, avec le pêcheur et ses amis à l’heure de l’apéro, mais pas tous les jours, ils me hèlent depuis l’intérieur de Chez Loulou, je vois les bras s’agiter derrière la vitre, de vrais sémaphores, les grimaces qu’ils font, alors j’entre. Et tu passais sans nous voir! reproche le pêcheur, c’est L’Empereur qui t’a repéré, il a l’œil. L’Empereur est l’un des plus anciens, je sais le pourquoi de son surnom, le dirai plus tard. Il y a aussi Gas-Oil, un mécano, Diesel, un autre mécanicien, Sans-Fil, un radio, Marche-ou-Crève, trois ans de Légion, Le Serpent, très souple et très fumier, Bonjour-Bonjour qui dit bonjour deux fois dans la foulée, Sans-Refus qui, lui, ne dit jamais non, une bonne pâte on assure, d’autres dont je reparlerai, je ne les connais pas tous au singulier, je les connais dans leur généralité. Il y a aussi Nectanébo, un silencieux, je crois n’avoir jamais entendu sa voix, et Outis tout aussi mutique, en plus il est transparent, on ne réalise qu’après coup qu’il est là. Le tout fait une fine équipe.
Celui que j’appelle le pêcheur, ses amis l’appellent Costa-Rica parce qu’il y est allé. Ils ont pourtant de vrais noms de famille, la chaîne de tout le monde, ils ne s’en servent jamais entre eux, je suis donc surpris quand je les entends dans d’autres bouches. Une fois, à l’épicerie-tabacs-journaux, madame Bleusse me parlait je ne sais plus pourquoi d’un Monsieur Flex ou Ferlinque, exactement j’ai oublié. Comme je lui disais que je ne voyais pas, agacée elle a haussé les épaules Vous savez bien, a-t-elle laissé tomber, comme si j’étais bouché ou faisais l’âne, votre ami Costa-Rica. Je ne connais pas leurs noms de famille, leur famille non plus, on se voit Chez Loulou, chez moi, dans la maisonnette avec Costa-Rica, et quand il m’arrive d’en rencontrer un en dehors du café, c’est juste Bonjour Gas-Oil, Bonjour Bonjour-Bonjour, Bonjour l’Empereur, bonjour Le Serpent, Bonjour Nectanébo qui ne répond pas autrement que d’un signe de tête, Bonjour Outis qui ne répond d’aucune façon, en plus on ne le voit qu’après coup, comme je le disais il est transparent. Un dimanche j’ai croisé Sans-Fil sur la jetée, l’ai salué d’un Bonjour Sans-Fil. Il était endimanché, toute sa smalah avec lui, la maman et la nichée, quatre je crois bien, la femme m’a fusillé du regard, elle savait d’où sortait notre connaissance, le comptoir de Chez Loulou et ses maléfices. Le pêcheur donc, j’ai eu du mal à l’appeler Costa-Rica, j’y suis arrivé pourtant, je ne sais pas si ça aurait été plus facile avec Monsieur Flex, Monsieur Ferlinque.
Ça fait un moment que je connais le pêcheur, depuis combien de temps je ne saurais le dire avec précision, celle-ci n’est pas mon fort, la première fois il passait dans la rue sifflant un air, salopette de caoutchouc jaune le haut rabattu sur le devant, bottes de caoutchouc rouge-vif, j’avais remarqué la couleur des bottes, il doit patauger dans le sang toute la journée m’étais-je raconté, pour m’expliquer la chose, pour les explications, les tortillées, je ne suis pas mauvais. Il avait souri, je relevais le courrier devant la maisonnette, le portillon du jardinet où se trouve la boîte à lettres donne sur la rue, il n’y avait rien dedans, il y a rarement quelque chose, il m’avait dit Bonjour, j’avais répondu Bonjour, (à l’époque je n’avais pas encore l’habitude de Bonjour-Bonjour) le pêcheur s’était arrêté, on se faisait face, séparés par le portillon, il avait sur les bras un plateau chargé de poissons, j’avais reconnu des maquereaux raidis dans leur livrée métallique. Les poissons morts me dégoûtent assez, c’est vraiment des cadavres en entier, pas comme la viande qu’en général on ne voit qu’en morceaux. Vous en voulez?, avait gentiment demandé le pêcheur, vous pouvez y aller, ils sont pêchés de cette nuit, je n’avais pas dit non, ça fait maintenant un bail que dure l’offrande des maquereaux, sauf qu’il ne les apporte plus sur un plateau mais ficelés dans un journal, un paquet que je n’ouvre jamais et vais enterrer direct au fond du jardin, derrière la maisonnette. Ça a fini par faire un cimetière de maquereaux, une fosse commune, il y pousse de l’herbe, des fleurs au printemps, genre boutons d’or. Je ne suis pas très jardinier, je ne touche guère au jardin, plante et sème peu, d’autres avant moi ont planté, semé, des phlox, j’en ressème, je trouve ça joli. Il y a des arbres, un cèdre déodora, le beau déodora! s’est exclamé un jour quelqu’un, les beaux phlox! J’ai regardé le nom dans le dictionnaire des fleurs, j’ai pas mal de dictionnaires, dans ma chambre sur des étagères, dont le latin-français, le grec-français, je les épluche, de temps en temps je les époussète, j’en fais mon miel, du latin mel, du grec meli. Phlox, ai-je donc lu dans le dico: Du latin phlox «violette sauvage» qui vient du grec phlox, phlogis, qui veut dire flamme (au propre et au figuré). Plante herbacée (polémiacées), cultivée pour ses fleurs de couleurs vives, citation d’un auteur que j’ignorais, j’en ignore pas mal, tous m’ignorent de leur côté: «l’odeur sucrée des phlox». Je suis allé respirer les phlox dans le jardin, me suis agenouillé pour mieux sentir, rien, pas grand-chose, pourtant je n’avais pas le nez bouché, tu repasseras pour le sucre, la tête tournée, l’effet qu’on leur prête, encore un mensonge de la littérature, on sait qu’il y en a un paquet, aussi des vérités. Dans le jardin, j’arrache les mauvaises herbes, ça me prend par accès, il y a selon les accès des tas et des tas qu’il faudrait brûler, je les laisse sécher, pourrir, à l’écart au fond du jardin, j’appelle l’endroit le pourrissoir, le sol finit par tout reprendre, la pluie, le vent égalisent. Il y a aussi un wagonnet, qui sert de citerne, comment est-il arrivé là? des fois je me dis (imagination toute pure) qu’il sort d’une mine. Il recueille la pluie, de temps en temps j’ajoute de l’eau avec le tuyau, j’y puise de quoi arroser les phlox, les autres fleurs, l’eau verdit, à la surface une écume d’insectes déjà noyés, en train d’y parvenir en se débattant, spectacle de naufrage, des insectes filiformes quadrillent l’eau à grandes enjambées, ces bestioles qu’on appelait des cordonniers quand j’étais petit, au siècle dernier, je ne sais pas leur vrai nom, n’ai pas réussi à le trouver dans un dictionnaire, je ne dois pas regarder dans le bon, une fois un rat crevé, je l’ai pris par la queue avec des gants de caoutchouc, l’ai balancé par-dessus le mur chez les voisins, leur propriété est assez vaste, je n’allais pas enterrer le rat avec les maquereaux.
Les voisins ne sont pas venus se plaindre, il y aurait eu de quoi, remarquez, si ça se trouve ils n’ont même pas vu le rat, leur jardin est immense pour ce que j’en imagine, surtout à côté du mien qui ne l’est pas, il faudra qu’un de ces jours je fasse l’acquisition d’une échelle, une échelle de peintre, pour regarder par-dessus le mur, jusqu’ici j’ai seulement entrevu la maison depuis la rue quand je passe devant, la plupart des volets fermés, portail comme celui d’une prison, murs hérissés de tessons afin de décourager l’escalade, un jour Costa-Rica m’a raconté que la maison, une grosse maison, appartenait aux anciens propriétaires de la Conserverie, un bâtiment désaffecté qui domine sur la mer, il m’est arrivé de monter jusque-là. Ça s’écaille, se lézarde, partout aux murs des inscriptions, celle-ci Vas-y Pablo! lettres noires, point d’exclamation, Pablo c’est un footballeur, un buteur, un goleador, il joue dans le principal club de la région, le grand port au nord sur la carte, plusieurs fois champion ces dernières saisons. La maison est toujours dans la famille a ajouté Costa-Rica, l’usine fermée depuis longtemps, pendant des années et des années on n’a vu personne dans la propriété, tous les volets clos, depuis quelque temps c’est rouvert, trois femmes y habitent en ce moment, la tante et la nièce et une femme à tout faire, c’est elle qui fait les courses, elle sort l’auto, allemande et noire, une fois par semaine elle va à Champion, dans la zone, cinq six kilomètres d’ici.
Les voisins, devrais-je dire les voisines maintenant que je sais?, j’y pense souvent, il faut préciser que les occasions de penser ne me manquent pas, pas comme le penseur pour le sculpteur qui le représente, menton dans la main, coude sur le genou, non, nulle philosophie pas même une philosophie nulle n’ont jamais germé dans mon esprit, mais penser à ce qui arrive, qui n’arrive pas, tête distraite et occupée à la fois, ailleurs comme ici, comme ça oui c’est tout le temps que je pense, dedans comme dehors, au jardin, dans le jardinet, au cours de mes promenades sur la plage, à l’embouchure, debout, couché, gisant au fond de mon lit quand j’y gis, espérant le sommeil qui se fait attendre. J’ai énormément de mal pour ne penser à rien, sauf peut-être quand je bêche pour enterrer les maquereaux, il me faudrait bêcher plus souvent, plus profond. Faute de bêcher tout le temps, me dépenser plus, je fais avec mes pensées, le propre si l’on peut dire, même avec les pensées dégueulasses, et dieu sait qu’il y en a! de la vie en tête-à-tête, solitaire, comme le ver on se tortille. Avec quelqu’un, une famille, on est bien obligé d’abandonner un instant ses pensées pour cuire la soupe, torcher Bébé, réchauffer les biberons, dire, ne pas tout dire à Maman, ce qu’on a fait, pas fait dans la journée, coucher Bébé, se mettre au lit avec Maman après avoir regardé la télé, avoir envie d’elle, pas envie, dans ce cas, les deux, les pensées reviennent à tire-d’aile, sur l’aile de la pensée une brune et mince qu’on prend par-derrière, alors que de tout son long, on est allongé par-devant sur Maman, blonde et large, ça va bientôt finir la gesticulation conjugale, ça y est c’est terminé. Sur le dos, dans le noir, avec le cœur qui ralentit, les pensées qui déclinent, on se dit Putain, faudrait ne plus penser!, on est vidé par ses pensées.
Penser, je n’avais que ça à faire, alors je le faisais toute la journée, sans le vouloir ni le chercher, essayant même de ne penser à rien, exercice où je ne suis pas de première force, au lit même, dans le noir, attendant le sommeil, ce retardataire, les sonneries du carillon, un Westminster, ah le salaud! Dans mes pensées de l’obscurité, gisant dans mon lit, pensées de pénombre qui ne sont pas forcément des pensées obscures ni pour autant des pensées claires, arrivait qu’y figurassent les voisines, la tante et la nièce selon la rumeur, pas grand monde en fait qui les ait vues à cette époque, une fois Costa-Rica très tôt le matin depuis la mer, il longeait la plage à quelques encablures avec le Va-Toujours (quel bon bateau! dit-il toujours). Elles marchaient sur le sable, il lui avait semblé qu’elles étaient nu-pieds, il n’était pas sûr, il faisait frisquet ce jour-là, l’une derrière l’autre, la tante devant peut-être, la primogéniture, elles se ressemblaient, jupes longues jusqu’aux chevilles, c’est peut-être aussi pour cette raison que depuis la mer on ne pouvait être affirmatif à cent pour cent sur la question des pieds nus, la tante devant si on veut, juste un peu plus de gravité dans la démarche, gros pulls l’une et l’autre, sur la tête un fichu, pas d’impers malgré un grain toujours possible en cette saison, toutes les deux des lunettes noires, ça il en était sûr, même depuis le poste du Va-Toujours, pourtant le soleil se levait à peine, un disque rouge. Bonjour-Bonjour, lui, les avait aperçues derrière les vitres de leur auto (allemande et noire), c’était la femme à tout faire, un air très chameau, qui était au volant, et l’une (la nièce?), à côté de la conductrice, l’autre (la tante?) derrière, fichu et lunettes noires toutes les deux cette fois encore, dehors il pleuvait à seaux. Bonjour-Bonjour les avait croisées dans une rue adjacente à la propriété, il conduisait sa camionnette quasiment le nez sur le pare-brise, l’essuie-glace s’emballait sans parvenir à chasser toute l’eau, les deux véhicules roulaient au pas, la rue n’est pas large, l’auto allemande et noire l’était presque autant que la camionnette. Bonjour-Bonjour les avait frôlées au ralenti, il avait regardé autant qu’il avait pu dans l’auto, autant qu’il le pouvait avec la pluie, pas la conductrice mais la supposée nièce à côté d’elle, yeux droit devant, on ne pouvait pas voir grand-chose avec cette flotte, pourtant Bonjour-Bonjour avait vu, cru voir sa bouche, son ourlé, rien aperçu de la supposée tante à l’arrière de l’auto. Parlant d’elle, il était encore sous le coup de la vision La jeune, putain! la bouche qu’elle se paie! gémissait Bonjour-Bonjour à l’apéro Chez Loulou à la troisième tournée, il y en aurait d’autres et j’y renoncerai, la vision s’enflammerait encore, je partirai avant, cette bouche on sentait que Bonjour-Bonjour la voyait comme s’il y était, comme s’il enfonçait la langue dedans, muscle épais, chargé de vin, il mordait les lèvres de ses dents ébréchées, canine biseautée et aiguisée par les années passées sur les bateaux à trancher le fil qui sert à réparer les filets, dans son imagination il froissait ces lèvres, il finirait par les poisser, on lisait dans l’œil injecté de Bonjour-Bonjour le film qu’il se faisait sur la bouche de la nièce supposée, misère de nos obsessions, je me disais regardant Bonjour-Bonjour, comme moi, plein d’autres, c’est un obsédé. Il appelait Loulou à l’autre bout du comptoir Loulou remets-nous ça, s’il te plaît!, assez de vin pour allumer la vision, vin de trop pour l’éteindre, je disais Je m’en vais, je rentrais à la maisonnette sans tenir compte des encouragements à rester.
C’étaient les nouvelles qui me réveillaient quand il m’arrivait, gisant au lit sans parvenir à m’endormir, de laisser la radio allumée, je finis toujours par sombrer sans m’en rendre compte et dans la brume ignorant si c’est encore la nuit ou déjà le matin, j’écoute la musique particulière qui annonce, prévient, quelle que soit la station Attention, attention! alerte la musique, une cloche, un tocsin qu’on voudrait ne pas entendre, renfonçant la tête sous les draps, attention claquesonne la musique, voilà les infos, un jour nouveau s’annonce qui ne recommencera jamais, ni pour moi ni pour personne, pas plus ici qu’ailleurs dans le monde, on va essayer de le vivre avec décence, ou sans, on ne sait pas d’avance pour la décence, écoutez ce qui a eu lieu hier, écoutez ce qui va se passer aujourd’hui, on parlera de demain demain si vous voulez bien. Bonjour!, dit le nouvellier. Bonjour-Bonjour le pêcheur est bon lui aussi pour les nouvelles Bonjour, Bonjour!, lance-t-il en entrant au café, il y a un dingue qui aurait pu se tuer cette nuit sur la ligne droite, avant l’épingle à cheveux de Marcel le Bègue, il roulait à je sais pas combien m’a dit un chauffeur des Conserveries Matadi qui lui a fait des appels de phare, Loulou tu nous remets ça, s’il te plaît. Bonjour, dit la radio, pour l’instant brouillard en Corse, il fera treize degrés à Issy-les-Moulineaux dans la matinée. Je me renfonçais au plus profond du lit dans lequel je gisais, j’entendais comme dans une ouate Elle porte des lunettes de soleil aux verres bleu pétrole. J’émergeais. Lunettes de soleil?, parlait-on à la radio des voisines, la tante ou la nièce?, encore que personne n’ait dit, ni Costa-Rica ni Bonjour-Bonjour que les verres fussent bleu pétrole. Mais non, à la radio ça se passait à Moscou, dans la rue, une fille de dix-huit ans qui portait ces lunettes pour se donner l’air américain, voir la vie telle qu’on la visionne en bleu pétrole, je n’avais pas bien saisi pourquoi elle parlait dans le poste, pas compris les questions qu’on lui posait. Ouste, assez gis!, m’encourageais-je, je sautais du lit, j’ouvrais les volets sur l’anse, les bateaux étaient à quai, je ne les avais pas entendus rentrer, ce n’est donc pas aujourd’hui que le pêcheur apporterait des maquereaux, donc je n’aurais pas à enterrer.
- Paru en Paru le 1er août 2004
- 14 x 22 cm, 320 pages
- ISBN 2.87673.393.5
- 19 €
Il y a Arthur Bernard, l’auteur, le narrateur qui court toujours derrière les autres noms. Il y a Arthur Ferdinand Bernard ou AFB, apprenti relieur de 18 ans à Montparnasse en 1890, également apprenti assassin puisqu’il ratera son crime et même son châtiment. Condamné à mort, il sera gracié et transporté à la Nouvelle Calédonie. Le dossier sur lui aux Archives s’arrête en 1895. Alors on va lui inventer une suite. Il deviendra là-bas relieur et notamment de L’Odyssée. Il construira aussi des cerfs-volants dont un oiseau géant capable de l’élever dans les airs, au-dessus de l’océan.
Il ne reviendra jamais. Tout appartient à la poussière, cette insatiable. Elle dissout les morts et protège les livres que liront les vivants.
- Paru en Paru le 19 août 2016
- 12 x 19 cm, 240 pages
- ISBN 979-10-267-0424-9
- 17 €