MATHIEU MARRAUD Le pouvoir marchand
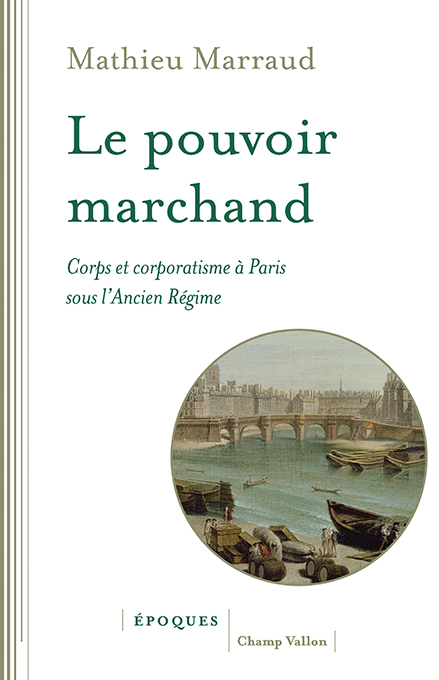
Comment dépeindre le corporatisme d’Ancien Régime ? Le terme de « corporation » est-il approprié ? Depuis les métiers qui, à Paris, se parent des titres de « corps » et de « marchand », apparaît le refus pour les acteurs du temps de se ranger derrière de mêmes droits, de mêmes statuts. C’est toute la nature conflictuelle de l’économie qui ressurgit. La diversité sociale et politique des métiers, dans une immense ville comme la capitale, donne en effet son dynamisme au commerce. Métiers, institutions royales et groupes sociaux y rivalisent pour le contrôle de marchandises qui ne sont jamais évaluées par leur seul profit, mais aussi … (lire la suite)
CAROLE REYNAUD-PALIGOT L’école aux colonies
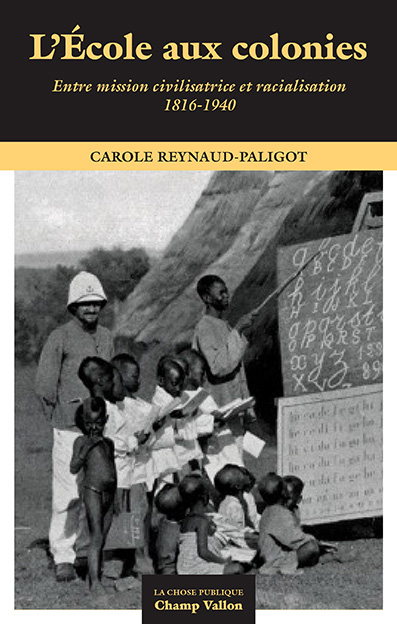
La volonté de « civiliser » les populations colonisées grâce à l’école fut hautement proclamée par les colonisateurs français mais qu’en fut-il réellement ? Cette enquête, effectuée à partir des archives coloniales, restitue les débats et les réalisations de la politique scolaire. Dès 1815, le projet colonial fut durablement établi : les colonies devaient fournir des matières premières mais aussi être des débouchés pour les produits manufacturés de la métropole. La mission de l’école s’imposa : apprendre le français, le calcul et quelques bribes de civilisation nécessaires à la bonne participation… (lire la suite)
LE MAGASIN DU XIXe SIÈCLE N° 10
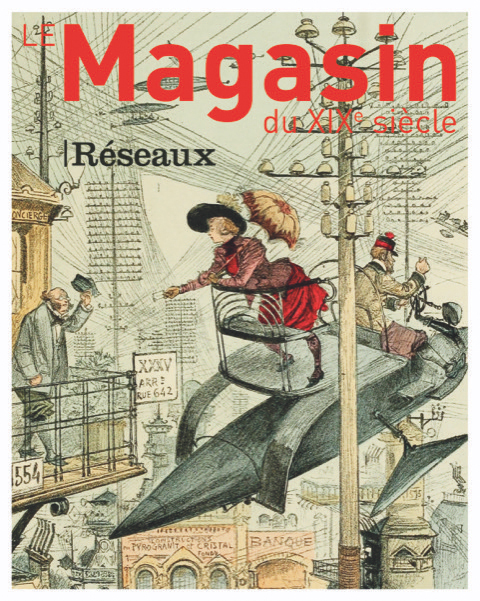
Introduction: une société en réseaux Julien Schuh
Espaces, urbanisme, modernité
L’émergence du concept moderne de réseau chez Saint-Simon et les saint-simoniens Pierre Musso
La notion de réseau chez Haussmann Pierre Pinon
Les réseaux d’espaces verts du Paris d’Adophe Alphand Chiara Santini
Image et imaginaire du réseau chez Hippolyte Taine Romain Enriquez
Réseaux occultes (sociétés secrètes, franc-maçonnerie…) Jean-Noël Tardy
Les réseaux informels dont profitent les prostituées de la middle et de la upper class sous le Second Empire et la Belle Époque Gabrielle Houbre
Réclame et réseaux de panneaux publicitaires Karen… (lire la suite)
SIMON PEREGO Pleurons-les
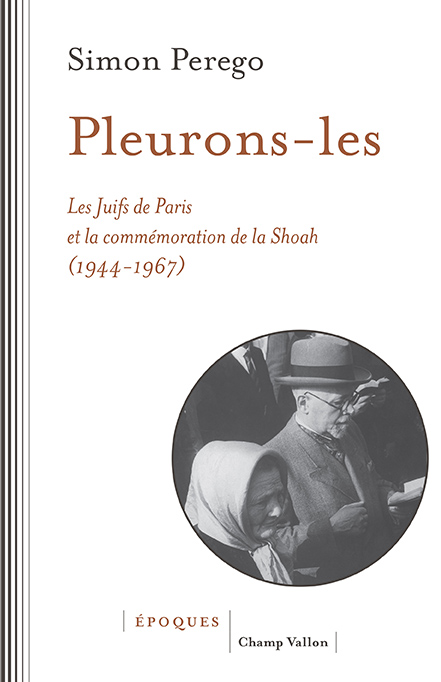
« On n’en parlait pas », se souviennent de nombreuses personnes ayant grandi dans la France de l’après-Seconde Guerre mondiale au sein de foyers intimement marqués par les persécutions antisémites et la destruction des Juifs d’Europe. Cette difficile transmission intrafamiliale des épreuves endurées sous l’Occupation a cependant cohabité après la guerre avec un large éventail d’initiatives prises dans le monde juif pour commémorer ce que l’on n’appelait pas encore la Shoah. Et parmi ces initiatives figuraient en bonne place les cérémonies du souvenir qu’organisèrent notamment, dès l’automne 1944, des associations juives établies… (lire la suite)