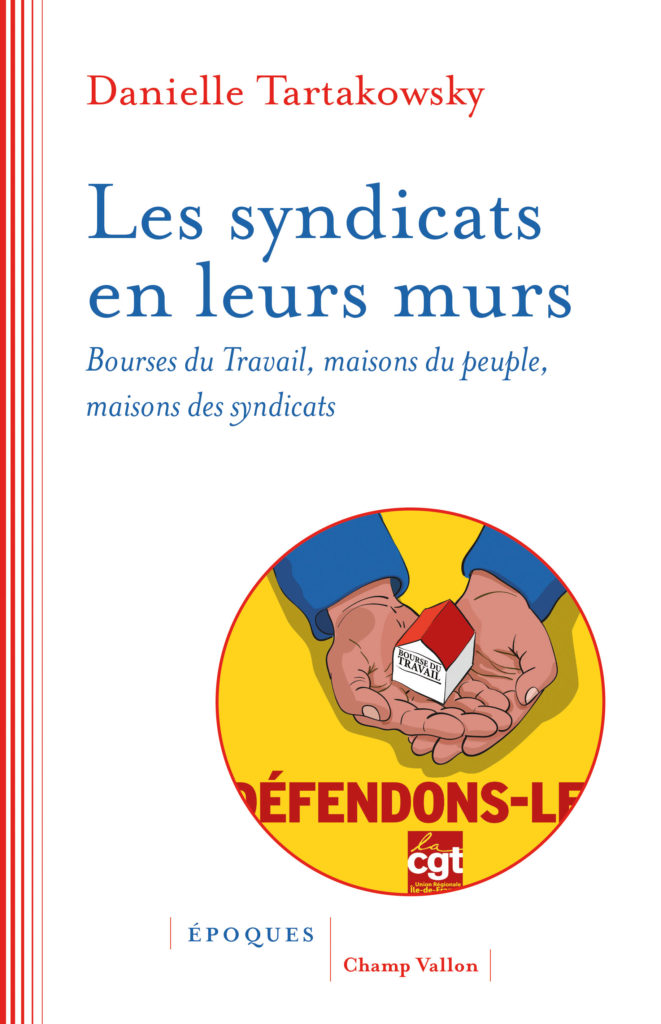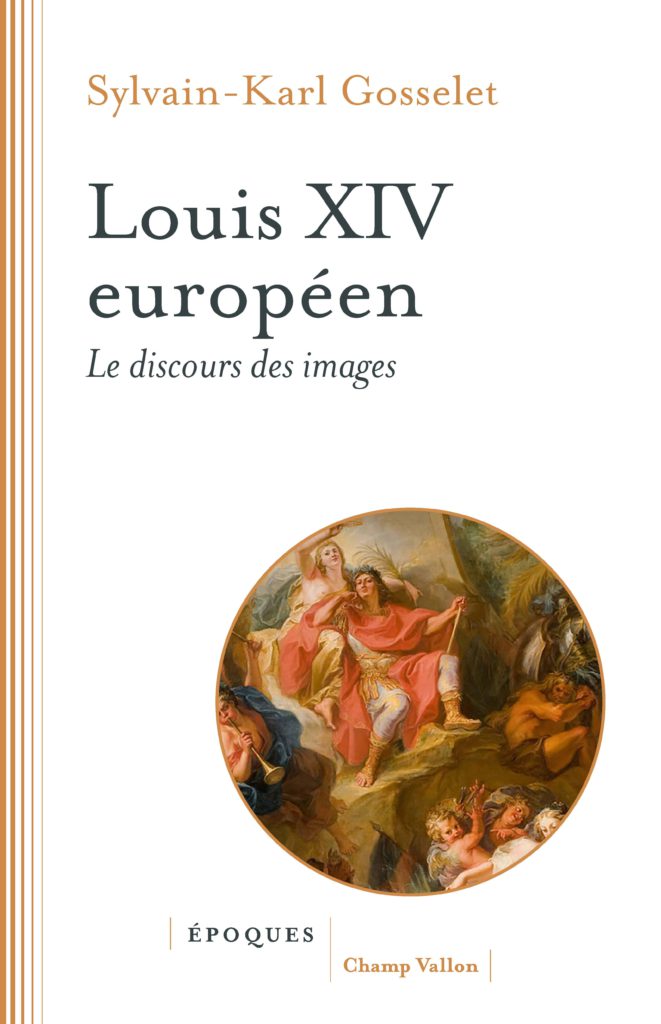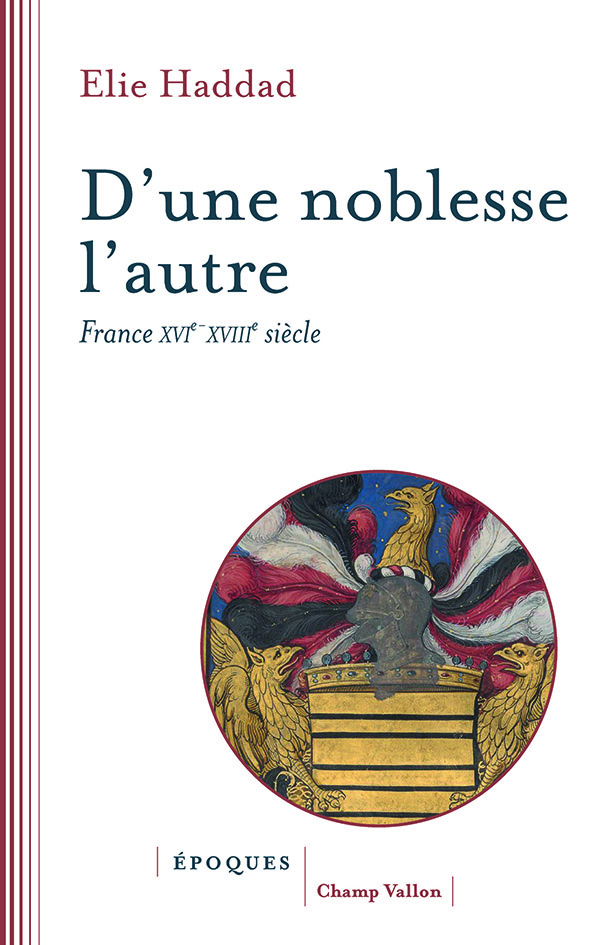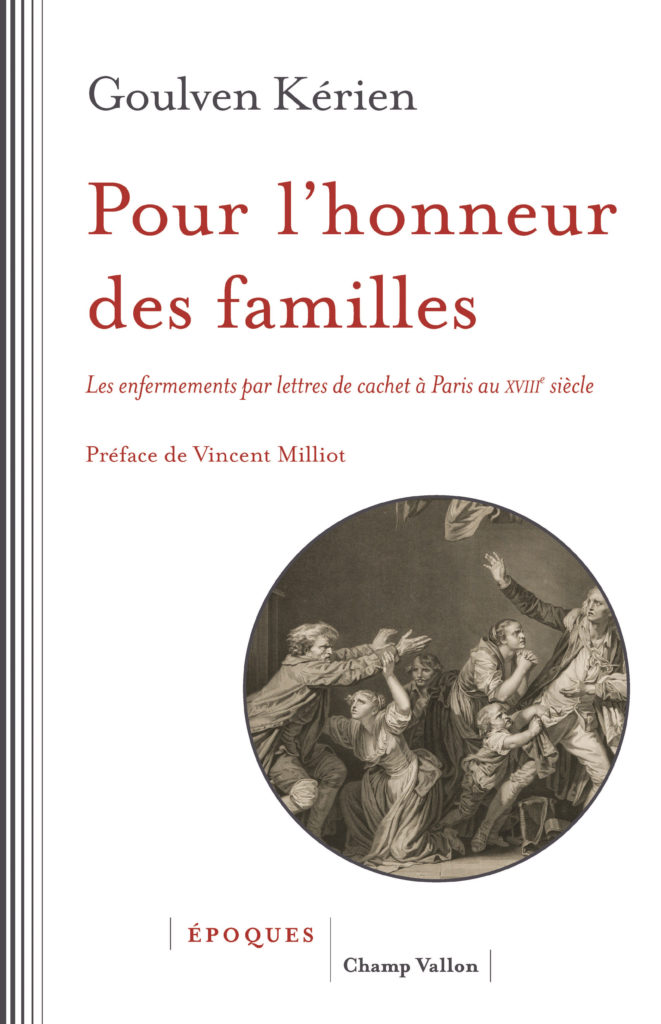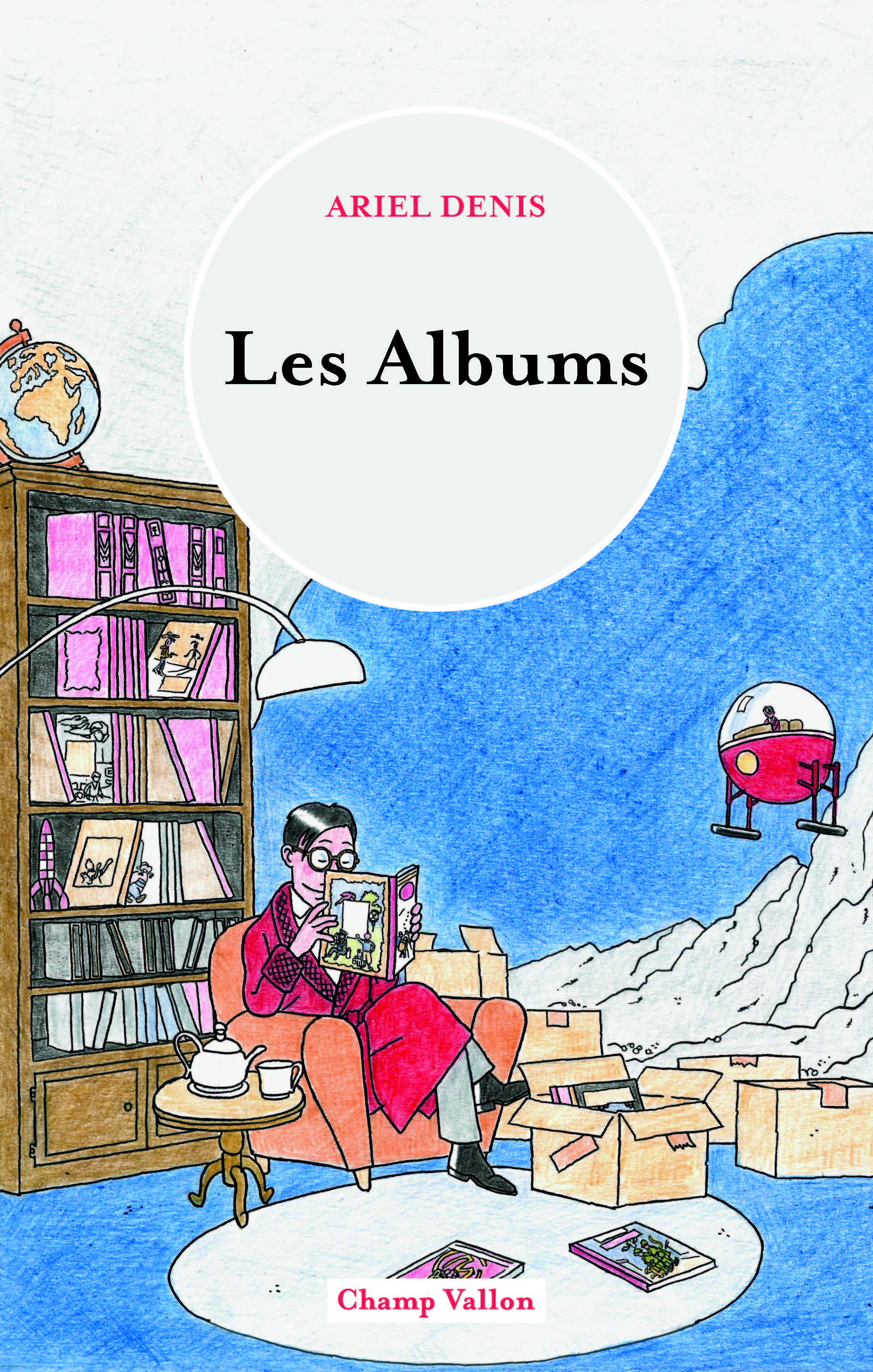DANIELLE TARTAKOWKY Les syndicats en leurs murs
A
- ABDELA, Sophie – La prison à Paris au XVIIIe siècle
- AGARD, Philippe – Plomb des grives
- ALTER, André – Hölderlin
- ALTER, André – Jean-Claude Renard
- ANDERSON, Alan Ross – Pensée et machine
- Annecy – Jean-Marie Dunoyer 1984
- ANSEEUW, Alin – La guerre vite sinon j’étouffe
- AQUIEN, Michèle – Saint-John Perse
- ARRIVÉ, Michel – L’homme qui achetait les rêves
- ARRIVÉ, Michel – La walkyrie et le professeur
- ARRIVÉ, Michel – Un bel immeuble
- ARRIVÉ, Michel – Une très vieille petite fille
- ASSO, Françoise – Rien n’est perdu
- AUBY, Danielle – La grande filature
- AZOULAY, Vincent, Patrick BOUCHERON (dir.) – Le mot qui tue
B
- BADEL, Christophe – La noblesse de l’empire romain
- BARANGER, Jonathan – Don Creux est mort
- BARANGER, Jonathan – Le legs psycho-batave
- BARANGER, Jonathan – Le siècle de Hobbards
- BARANGER, Jonathan – Chokolov City
- BARBARANT, Olivier – La juste couleur
- BARBARANT, Olivier – Un grand Instant
- BARBARANT, Olivier – Aragon
- BARBARANT, Olivier – Douze lettres d’amour au soldat inconnu
- BARBARANT, Olivier – Essais de voix malgré le vent
- BARBARANT, Olivier – Je ne suis pas Victor Hugo
- BARBARANT, Olivier – Les parquets du ciel
- BARBARANT, Olivier – Odes dérisoires
- BARBARANT, Olivier – Temps morts
- BARBARANT, Olivier – Élégies étranglées
- Barcelone – Pierre Lartigue 1990
- BARLES, Sabine – L’invention des déchets urbains
- BARLES, Sabine – La ville délétère : Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain XVIIIe-XIXe siècles
- BASTIEN, Pascal – L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle
- BAYLE, Corinne – Gérar de Nerval
- BAYLE, Corinne – Rouges Roses de l’oubli
- BAZOT, Xavier – Camps volants
- BEAUFILS, Christophe – La mort subite du nourrisson
- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – La mesure : instruments et philosophie
- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – La philosophie du remède : instruments et philosophie
- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – La vie et la mort des monstres
- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – Le déchet le rebut le rien
- BEAUNE, Jean-Claude (dir.) – Phénoménologie et psychanalyse : étranges relations
- BEAUNE, Jean-Claude – Engrenages
- BEAUNE, Jean-Claude – Le balancier du monde
- BEAUNE, Jean-Claude – Le vagabond et la machine
- BEAUNE, Jean-Claude – Machinations : anthropologie des milieux techniques (2)
- BEAUNE, Jean-Claude – Philosophie des milieux techniques
- BEAUNE, Jean-Claude – Spectres mécaniques
- BELL, David A. – La première guerre totale
- BELLET, Roger – Stéphane Mallarmé
- BELMAS, Élisabeth – Jouer autrefois
- BERG, Christian et Yves VADÉ (dir.) – Marcel Schwob
- BERGER, Anne Emmanuelle – Le banquet de Rimbaud
- BERGER, John / Nelly BIELSKI – Le dernier portrait de Francisco Goya
- BERGER, John et Françoise GUICHON (dir.) – Photographe et le pharmacien (Le)
- BERGER, John – Et nos rivages mon coeur fugaces comme des photos
- BERGER, John – Fidèle au rendez-vous
- BERGER, John – Flamme et lilas
- BERGER, John – L’oiseau blanc
- BERGER, John – La cocadrille
- BERGEZ, Daniel – Éluard
- BERGOUNIOUX, Gabriel – Dominos
- BERGOUNIOUX, Gabriel – Doucement
- BERGOUNIOUX, Gabriel – Il y a de
- BERGOUNIOUX, Gabriel – Il y a un
- BERGOUNIOUX, Gabriel – Mes nippes
- BERNARD, Arthur – Aux captifs aux vaincus
- BERNARD, Arthur – Ça va
- BERNARD, Arthur – Gaby et son maître
- BERNARD, Arthur – Gaby Grandit
- BERNARD, Arthur – L’oubli de la natation
- BERNARD, Arthur – La guerre avec ma mère
- BERNARD, Arthur – Tout est à moi dit la poussière
- BERNARD, Jean-Pierre (Arthur) – Les deux Paris
- BERNARD, Jean-Pierre (Arthur) – Paris rouge (1944-1964)
- BERQUE, Augustin (dir.) – Cinq propositions pour une théorie du paysage
- BERTHIER, Philippe – François Augiéras
- BERTRAND, Arthur – Le désespoir du peintre
- BESS, Michael – La France vert clair
- Beyrouth – Richard Millet 1987
- BIARD, Michel – Les Lilipputiens de la centralisation
- BIDENT, Christophe – Maurice Blanchot : partenaire invisible
- BIDENT, Christophe – Maurice Blanchot : partenaire invisible (réédition)
- BINOCHE, Bertrand & Franck TINLAND (dir.) – Sens du devenir et pensée de l’histoire au temps des lumières
- BINOCHE, Bertrand (dir.) – L’Homme perfectible
- BINOCHE, Bertrand (dir.) – Les équivoques de la civilisation
- BLAIS, Hélène – L’empire de la nature
- BLAUFARB, Rafe – L’invention de la propriété privée
- BOCHOLIER, Gérard – Pierre Reverdy
- Bogota – Alicia Dujovne-Ortiz 1991
- BOIS, Jean-Pierre – L’abbé de Saint-Pierre
- BOITEL, Isaure – L’image noire de Louis XIV
- BOLTANSKI, Luc – Déluge
- BONZON, Anne – La paix au village
- Bordeaux – Bernard Delvaille 1985
- BOREL, Jacques – Journal de la mémoire
- BOREL, Jacques – Propos sur l’autobiographie
- BOREL, Jacques – Sur les poètes
- BORILLO, Mario (dir.)
- BORILLO, Mario (dir.) – Dans l’atelier de l’art
- BORREIL, Jean (dir.) – Les sauvages dans la cité
- BOUCHARD, Carl – Cher Monsieur le Président
- BOUCHARENC, Myriam – L’écrivain et la publicité
- BOUGON, Patrice et Marc DAMBRE (dir.) – Henri Thomas
- BOUHÉNIC, Pascale – Le versant de la joie
- BOUQUET, Stéphane – Le fait de vivre
- BOUQUET, Stéphane – Dans l’année de cet âge
- BOUQUET, Stéphane – Le mot frère
- BOUQUET, Stéphane – Les amours suivants
- BOUQUET, Stéphane – Nos amériques
- BOUQUET, Stéphane – Un monde existe
- BOUQUET, Stéphane – Un peuple
- BOUQUET, Stéphane – Vie commune
- BOURGEOIS, Denis – Cocagne
- BOUVIER, Jean (dir.) – La France en mouvement
- BOYER-WEINMANN, Martine – Le siècle d’Irene
- BOYER-WEINMANN, Martine / Denis REYNAUD – Vestiaire de la littérature
- BOYER-WEINMANN, Martine – La relation biographique
- BOYER-WEINMANN, Martine – Vieillir dit-elle
- BRETON, Philippe & Franck TINLAND & Alain-Marc RIEU – La techno-science en question
- BRIOIST, Pascal / Hervé DREVILLON / Pierre SERNA Croiser le fer (réédition)
- BRIOIST, Pascal et Hervé DREVILLON et Pierre SERNA – Croiser le fer
- BRUNEL, Pierre – Arthur Rimbaud
- BRUNEL, Pierre – Arthur Rimbaud ou l’éclatant désastre
- BRÉTÉCHÉ, Marion – Les compagnons de Mercure
- Buenos-Aires – Alicia Duvojne-Ortiz 1984
- BURSTIN, Haim – Une révolution à l’oeuvre
- BÉGUIN, Katia – Financer la guerre au XVIIe siècle
- BÉGUIN, Katia – Les princes de Condé
- BÉGUIN, Katia – Les princes de Condé (réédition)
C
- CAPRONI, Giorgio – Le franc tireur
- CARAION, Marta – Comment la littérature pense les objets
- CARAION, Marta – Usages de l’objet
- CAROL, Anne – L’embaumement
- CAROL, Anne – Physiologie de la Veuve
- CARON, Jean-Claude (dir.) – Paris l’insurrection capitale
- CARON, Jean-Claude – Simon Deutz un Judas romantique
- CARON, Jean-Claude – Van Gogh en toutes lettres
- CARON, Jean-Claude – Frères de sang
- CARON, Jean-Claude – Les deux vies du Général Foy
- CASSAGNE, Albert – La théorie de l’art pour l’art
- CASSAN, Michel – La grande peur de 1610
- CAVALIER, Georges – Les mémoires de Pipe-en-bois
- CHANTOISEAU, Jean-Baptiste – L’En-deça des images
- CHAPLAIN, Jean-Michel – La chambre des tisseurs
- CHAPPEY, Jean-Luc – Ordres et désordres biographiques
- CHARLE, Christophe (dir.) – Le temps des capitales culturelles
- CHASSEGUET-SMIRGEL, Janine – Éthique et esthétique de la perversion
- CHASSEGUET-SMIRGEL, Janine – Éthique et esthétique de la perversion — Réédition
- CHAUCER, Geoffrey – Le parlement volatil
- CHAZAL, Gérard – Formes figures réalité
- CHAZAL, Gérard – Interfaces
- CHAZAL, Gérard – L’ordre humain ou le déni de nature
- CHAZAL, Gérard – Le miroir automate
- CHAZAL, Gérard – Les médiations théoriques
- CHAZAL, Gérard – Les réseaux du sens
- CHENERAILLE, Joseph – La bête ravissante en forme de loup
- CHENERAILLE, Joseph – Le grand ciel
- CHENY, Anne-Marie – Une bibliothèque byzantine
- Cherbourg – Michel Besnier 1986
- CHIANTARETTO, Jean-François – De l’acte autobiographique
- CHRISTEN, Carole – A l’école du soir
- Christian – Encyclopédie conceptuelle et thématique de la philosophie – GODIN
- CHRISTIN, Olivier – Confesser sa foi
- CHURCHLAND, Paul-Montgomery – Matière et conscience
- CIREFICE, Virgile – La part de l’ombre
- COHEN, Déborah – La nature du peuple
- COLLOT, Michel – Francis Ponge
- COMINA, Marc – Louis-René des Forêts
- CONORT, Benoît – Sortir
- CONORT, Benoît – Cette vie est la nôtre
- CONORT, Benoît – Main de nuit
- CONORT, Benoît – Écrire dans le noir
- COOPER-RICHET, Diana et Jacqueline PLUET-DESPATIN – L’exercice du bonheur
- CORNETTE, Joël – Un révolutionnaire ordinaire
- COSTE, Didier et Michel ZÉRAFFA (dir.) – Le récit amoureux
- COSTE, Joël – Les écrits de la souffrance
- COUTURIER, Maurice – Nabokov ou la cruauté du désir
- COUTURIER, Maurice – Roman et censure
- CROCE, Cécile – Psychanalyse de l’art symboliste pictural
- CROUZET, Denis (sous la direction de ) – Historiens d’Europe historiens de l’Europe
- CROUZET, Denis / Élisabeth CROUZET-PAVAN / Philippe DESAN / Clémence REVEST – L’humanisme à l’épreuve de l’Europe
- CROUZET, Denis – Dieu en ses royaumes
- CROUZET, Denis – Dieu en ses royaumes (réédition)
- CROUZET, Denis – La sagesse et le malheur
- CROUZET, Denis – Les guerriers de Dieu
- CROUZET, Denis – Les guerriers de Dieu (réédition)
- CROUZET, Guillemette – Genèses du Moyen Orient
- CROUZET-PAVAN, Élisabeth – Venise : une invention de la ville XIIIe–XVe siècle
D
- DAGOGNET, François (dir.) – Mort du paysage ?
- DAGOGNET, François Robert DAMIEN et Robert DUMAS – Faut-il brûler Régis Debray ?
- DAGOGNET, François – Le musée sans fin
- DAGOGNET, François – Tableaux et langage de la chimie
- DAMIEN, Robert – Eutopiques
- DAMON, Benoît – Le coeur pincé
- DAMON, Benoît – Retour à Ostende
- DAMON, Benoît – Trois visites à Charenton
- DANOU, Gérard – Le corps souffrant
- DARGENT, Jérôme – Le corps obèse
- DAUBRESSE, Sylvie – Conjurer la dissension religieuse
- DAUPHANT, Léonard – Géographies
- DAUPHANT, Léonard – Le royaume des quatre rivières
- DAVIS, Diana K. – Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb
- DEBRAND, Nicole – Constance
- DECAUNES, Luc – Poésie au grand jour
- DECOCQ, Guillaume et KALAORA Bernard et VLASSOPOULOS Chloé – La forêt salvatrice
- DECOUT, Maxime – Écrire la judéité
- DEFORGE, Yves – L’oeuvre et le produit
- DEFORGE, Yves – Le graphisme technique
- DE FRANCESCO, Antonino – L’Italie de Bonaparte
- DE GIRARDIN, René-Louis – De la composition des paysages
- DEGROOTE, Ludovic – 69 vies de mon père
- DEGROOTE, Ludovic – Monologue
- DEGROOTE, Ludovic – Un petit viol
- DEGUY, Michel – Brevets
- DEGUY, Michel – Le comité
- DE LAMARTINE, Alphonse – Histoire de Charlotte Corday
- DE LA VILLE DE MIRMONT, Jean – Oeuvres complètes
- DELUERMOZ, Quentin (dir.) – Les mondes de 1848
- DEMARTINI, Anne-Emmanuelle – Violette Nozière la fleur du mal
- DE MULDER, Caroline – Ego Tango
- DE MULDER, Caroline – Nous les bêtes traquées
- DENIEL-TERNANT, Myriam – Ecclésiastiques en débauche
- DENIS, Ariel – Les Albums
- DENIS, Ariel – Valigan
- DENIS, Vincent – Policiers de Paris
- DENIS, Vincent – Une histoire de l’identité
- DEPIERRE, Marie-Ange – Paroles fantomatiques et cryptes textuelles
- DETAMBEL, Régine – Icônes
- DETAMBEL, Régine – Émulsions
- Dijon – Pascal Commère 1989
- DI MASCIO, Patrick – Le maître de secret
- DOMINIQUE, François – Délicates Sorcières
- DORON, Claude-Olivier – L’homme altéré : races et dégénérescence (XVIIe–XIXe siècles)
- DOUMET, Christian – Grand art avec fausses notes
- DOUMET, Christian – Illettrés durs d’oreille malbâtis
- DOUMET, Christian – Poète moeurs et confins
- DOUMET, Christian – Traité de la mélancolie de cerf
- DOUMET, Christian – Vanité du roi Guitare
- DOUMET, Christian – Victor Segalen
- DOURGUIN, Claude – Escales
- DOURGUIN, Claude – La forêt périlleuse
- DOURGUIN, Claude – La lumière des villes
- DOURGUIN, Claude – Lettres de l’avent
- DOURGUIN, Claude – Recours
- DOURGUIN, Claude – Un royaume près de la mer
- DOURGUIN, Claude – Écarts
- DREVILLON, Hervé – Lire et écrire l’avenir
- DROGUET, Henri – Ventôses
- DUBOST, Jean-Pascal – Le défait
- DUC, Séverin – La guerre de Milan
- DUCCINI, Hélène – Faire voir faire croire
- DUCCINI, Hélène – Guerre et paix dans la France du Grand Siècle
- DUFRAISSE, Sylvain – Les héros du sport
- DUPILET, Alexandre — La Régence absolue
- DUPRÉ, Jocelyn – Le Canal aux cerises
- DÉSVEAUX, Emmanuel – Sexualités sociétés nativités
E
- EL KENZ, David (dir.) – Commémorer les victimes en Europe
- EL KENZ, David (dir.) – Les bûchers du roi
- EPISCOPI, Alberto – Festin et destin
- ERRE, Fabrice – Le règne de la poire
- EXBALIN, Arnaud – La grande tuerie des chiens
F
- FANLO, Jean Raymond – L’Évangile du démon
- FAURE, Étienne – Ciné Plage
- FAURE, Étienne – Horizon du sol
- FAURE, Étienne – La vie bon train
- FAURE, Étienne – Légèrement frôlée
- FAURE, Étienne – Vues prenables
- FEL, Loïc – L’esthétique verte
- FERNANDEZ-LACÔTE, Hélène – Les procès du cardinal de Richelieu
- FERRER-BARTOMEU, Jérémie – L’Etat à la lettre
- FERRIER-VIAUD, Pauline – Epouses de ministres
- FERRIÈRES, Madeleine – Le bien des pauvres
- FLEURY, Daniel – Zlotan Zékator et Joseph Staline mangent des artichauts
- FONCK, Bertrand – Le maréchal de Luxembourg
- FORERO-MENDOZA, Sabine – Le temps des ruines
- FOURNEAU, Thierry – La vie aux sources
- FOURNIER, Eric – «Nous reviendrons!»
- FOURNIER, Éric – La «Belle Juive»
- Frioux (DIR.), Stéphane – Une France en transition
- FUREIX, Emmanuel (dir.) Iconoclasme et révolutions
- FUREIX, Emmanuel – L’œil blessé
- FUREIX, Emmanuel Sylvie APRILE et Jean-Claude CARON (dir.) – La liberté guidant les peuples
- FUREIX, Emmanuel – La France des larmes
G
- GAGNEBIN, Murielle (dir.) – L’ombre de l’image
- GAGNEBIN, Murielle (dir.) – Les images parlantes
- GAGNEBIN, Murielle (dir.) – Yves Bonnefoy lumière et nuit des images
- GAGNEBIN, Murielle et Christine Savinel (dir.) – Starobinski en mouvement
- GAGNEBIN, Murielle et Julien MILLY (dir.) – L’affrontement et ses images
- GAGNEBIN, Murielle et Julien MILLY (dir.) – Les images honteuses
- GAGNEBIN, Murielle et Julien MILLY (dir.) – Les images limites
- GAGNEBIN, Murielle et Julien MILLY (dir.) – Michel de M’Uzan
- GAGNEBIN, Murielle et Suzanne LIANDRAT-GUIGUES (dir.) – L’essai et le cinéma
- GAGNEBIN, Murielle – Fascination de la laideur
- GAGNEBIN, Murielle – Les ensevelis
- GAL, Stéphane – Histoires verticales
- GARCIN, Christian – Une odyssée pour Denver
- GARCIN, Christian – Fées diables et salamandres
- GARCIN, Christian – Rien
- GARCIN, Christian – Sortilège
- GARCIN, Christian – Sortilège (réédition)
- GARRIGUES, Dominique – Jardins et jardiniers de Versailles au Grand siècle
- GARRIOCH, David – Les huguenots de Paris et l’avènement de la liberté religieuse
- GASARIAN, Gérard – Yves Bonnefoy
- GATULLE, Pierre – Gaston d’Orléans
- GAUDIN, Jean-Pierre – L’avenir en plan
- GAUTIER, Théophile – Les vacances du lundi
- Genève – Pierre Gascar 1984
- GERMA, Antoine / Evelyne PATLAGEAN / Benjamin LELLOUCH – Les Juifs dans l’histoire
- GIBERT DE L’ISLE, Charles Antoine – La fermeté de mon caractère
- GILL, André – Correspondance et mémoires d’un caricaturiste
- GILLIBERT, Jean – Folie et création
- GILLIBERT, Jean – Le psychodrame de la psychanalyse
- GIOVANNONI, Jean-Louis – Voyages à Saint-Maur
- GLORIEUX, Guillaume – À l’Enseigne de Gersaint
- Godin
- GODIN, Christian
- GODIN, Christian – La crise de la réalité
- GODIN, Christian – Victor Hugo et la Commune
- GODIN, Christian – Chaplin et ses doubles
- GODIN, Christian – La démoralisation
- GODIN, Christian – La fin de l’Humanité
- GODIN, Christian – La haine de la nature
- GODIN, Christian – Les lieux communs d’aujourd’hui
- GODIN, Christian – Le triomphe de la volonté
- GOFFETTE, Guy – Éloge pour une cuisine de province
- GOLBERG, Mécislas – Lettres à Alexis
- GOSSELET, Elie – D’une noblesse l’autre
- GOSSELET, Sylvain-Karl – Louis XIV européen
- GOUDEAU, Émile – Dix ans de bohême
- GOUREAU, Jean-Baptiste – Rappels
- GOUX, Jean-Paul – Tableau d’hiver
- GOUX, Jean-Paul – La fabrique du continu
- GOUX, Jean-Paul – La jeune fille en bleu
- GOUX, Jean-Paul – Sourdes contrées
- GOUX Jean-Paul – Sourdes contrées, Retirer un terme : Jean-Paul – Sourdes contrées
- GRANDHAYE, Julie – Russie : la République interdite
- GREEN, André – Propédeutique
- GREEN, André – Propédeutique (réédition)
- GREEN, Eugène – En glanant dans les champs désolés
- GROJNOWSKI, Daniel – La tradition fumiste
- GROUPE DE TRAVAIL DE LA MAISON D’ÉCOLE À MONTCEAU-LES-MINES, Cent ans d’école
- GUERRE, Stéphane – Nicolas Desmaretz
- GUICHARD, Charlotte – Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle
- GUILLAUMIN, Jean (dir.) – Pouvoirs du négatif dans la psychanalyse et la culture
- GUILLAUMIN, Jean – Entre blessure et cicatrice
- GUILLERME, André – Bâtir la ville
- GUILLERME, André – La Naissance de l’Industrie à Paris
- GUILLERME, André – Les Collections
- GUILLERME, André – Les temps de l’eau : La cité l’eau et les techniques
- GUILLEVIC JEAN, Raymond
- GUINIER, Arnaud – L’honneur du soldat
- GUÉRY, François (dir.) – L’idée de la ville
- GÉRARD, Alain – La Vendée 1789-1793
- GÉRAUD, Jacques – Cher Monsieur Zavatta
- GÉRAUD, Jacques – Photoroman en 47 légendes
- GÉRAUD, Jacques – Proustissimots
- Gérard et André GUILLERME et Anne-Cécile LEFORT – Dangereux
H
- HADDAD, Elie – D’une noblesse l’autre
- HAGIMONT, Steve – Pyrénées
- HARAN, Alexandre Y. – Le lys et le globe
- HASQUENOPH, Sophie – Histoire des ordres et congrégations religieuses
- HASQUENOPH, Sophie – Les Français de Moscou et la Révolution russe
- HENNEBELLE, David — De Lully à Mozart
- HESSE, Thierry – Jura
- HESSE, Thierry – Le cimetière américain
- HOCHNER, Nicole – Louis XII : les dérèglements de l’image royale
- HOPKINS-LOFÉRON, Fleur – Voir l’invisible
- HOTTOIS, Gilbert – Entre symboles et technosciences
- HUET, Bernard et Christian DEVILLERS – Le Creusot : naissance et développement d’une ville industrielle 1782-1914
I
J
- JACOBI, Bernard et SCHIELE Daniel (dir.) – Vulgariser la science : le procès de l’ignorance
- JANDOT, Olivier – Les Délices du feu
- JANNIN, Bernard – Une vraie boucherie
- JANNIN, Bernard – Ça sent le tabac
- Jean-Philippe – Des paysans écolomgistes
- JIGAUDON, insalubres et incommodes
- JORDANE, Benjamin – L’apprentissage du roman
- JORDANE, Benjamin – Toute ressemblance…
- JOURDAIN, Michel – Franck Sinatra monte au paradis
- JOURDAIN, Michel – Lettres mortes
- JOURDAIN, Michel – Une petite ville au bord du désert
K
- KALAORA, Bernard & Antoine SAVOYE – Les inventeurs oubliés : Le Play et ses continuateurs aux origines des sciences sociales
- KALAORA, Bernard et VLASSOPOULOS Chloé – Pour une sociologie de l’environnement
- KARILA-COHEN, Pierre – Monsieur le Préfet
- KEDWARD, Harry Roderick – Naissance de la Résistance dans la France de Vichy
- KENNEDY, Jérôme – Une res publica impériale en mutation
- KERRAND, Philippe – L’étrange colonel Rémy
- KIKUCHI, Catherine – La Venise des livres
- KLÉBANER, Daniel – Le désert et l’enfance
- KRAL, Petr – Témoin des crépuscules
- KÉCHICHIAN, Albert – Les Croix-de-feu à l’âge des fascismes
- KÉRIEN, Goulven – Pour l’honneur des familles
L
- LABROT, Gérard – L’image de Rome
- LABROT, Gérard – Peinture et société à Naples (XVIe–XVIIIe siècles)
- LABROT, Gérard – Sisyphes chrétiens
- LABROT, Gérard – Études napolitaines
- LACLAVETINE, Jean-Marie et Jean LAHOUGUE – Écriverons et liserons en vingt lettres
- LAHAYE, Matthieu – Le fils de Louis XIV
- LAHOUGUE, Jean – Le domaine d’Ana
- LAHOUGUE, Jean – Lettre au maire de mon village
- Lana – Henri IV roi – MARTYSHEVA
- La Nouvelle Orléans – Jean Pérol 1991
- LANOË, Catherine – Les ateliers de la parure
- LANOË, Catherine – La poudre et le fard
- LAROQUE, Didier – Lettres de Ponce Pilate
- LAROQUE, Didier – La mort de Laclos
- LAROQUE, Didier – Le Dieu Kairos
- Le Caire – Claude-Michel Cluny 1985
- LECLAIR, Bertrand – L’amant Liesse
- LECLAIR, Bertrand – Verticalités de la littérature
- LE GALL, Jean-Marie – Le mythe de saint Denis
- LE GALL, Jean-Marie – Les moines au temps des réformes
- Leipzig – Michel Besnier 1990
- LEMAIGRE-GAFFIER, Pauline – Administrer les menus plaisirs du roi
- Le Mao, Caroline
- LE MILINAIRE, André – Tristan Corbière
- LEMOINE, Bernard – L’architecture du fer
- Le Nouveau Recueil – n°34 – Toasts et tombeaux – mars/mai 1995
- Le Nouveau Recueil – n°35 – Écrire la voix – juin/août 1995
- Le Nouveau Recueil – n°36 – Sentiment paysage – septembre/novembre 1995
- Le Nouveau Recueil – n°37 – La Sainteté – décembre/février 1996
- Le Nouveau Recueil – n°38 – Récrire Réécrire – mars-mai 1996
- Le Nouveau Recueil – n°39 – La poésie dans la prose – juin-août 1996
- Le Nouveau Recueil – n°40 – La mémoire des musées – septembre-novembre 1996
- Le Nouveau Recueil – n°41 – Made in USA – décembre-février 1997
- Le Nouveau Recueil – n°42 – L’aveu – mars-mai 1997
- Le Nouveau Recueil – n°43 – Le théâtre dans l’esprit – juin-août 1997
- Le Nouveau Recueil – n°44 – Les mots de l’émotion – septembre-novembre 1997
- Le Nouveau Recueil – n°45 – Villes arabes – décembre-février 1998
- Le Nouveau Recueil – n°46 – Figures du poète – mars-mai 1998
- Le Nouveau Recueil – n°47 – L’excès – juin-août 1998
- Le Nouveau Recueil – n°48 – Exils – septembre-novembre 1998
- Le Nouveau Recueil – n°49 – L’usage du quotidien – décembre 1998/février 1999
- Le Nouveau Recueil – n°50 – Numéro anniversaire – mars/juin 1999
- Le Nouveau Recueil – n°51 – La Suisse d’ailleurs – juin-août 1999
- Le Nouveau Recueil – n°52 – D’un lyrisme critique – septembre/novembre 1999
- Le Nouveau Recueil – n°53 – Images et icônes – décembre 1999/février 2000
- Le Nouveau Recueil – n°54 – À la frontière – mars/mai 2000
- Le Nouveau Recueil – n°55 – Poèmes – juin/août 2000
- Le Nouveau Recueil – n°56 – Ce qui reste – septembre/novembre 2000
- Le Nouveau Recueil – n°57 – Pourquoi publier – décembre 2000/février 2001
- Le Nouveau Recueil – n°58 – La demeure – mars/mai 2001
- Le Nouveau Recueil – n°59 – Traduction en cours – juin/août 2001
- Le Nouveau Recueil – n°60 – Sous pseudo – septembre/novembre 2001
- Le Nouveau Recueil – n°61 – Films / Hantises – décembre 2001/février 2002
- Le Nouveau Recueil – n°62 – L’amour du livre – mars/mai 2002
- Le Nouveau Recueil – n°63 – Que peut la poésie ? – juin/août 2002
- Le Nouveau Recueil – n°64 – Au-delà du roman – septembre/novembre 2002
- Le Nouveau Recueil – n°65 – Courriers du coeur – décembre 2002/février 2003
- Le Nouveau Recueil – n°66 – Radio-graphies – mars/mai 2003
- Le Nouveau Recueil – n°67 – Rêver peut-être – juin/août 2003
- Le Nouveau Recueil – n°68 – Tous fous ? – septembre/novembre 2003
- Le Nouveau Recueil – n°69 – Encore l’amour ? – décembre 2003/février 2004
- Le Nouveau Recueil – n°70 – Pour les enfants – mars/mai 2004
- Le Nouveau Recueil – n°71 – Grèces – juin/août 2004
- Le Nouveau Recueil – n°72 – Encres de Chine – septembre/novembre 2004
- Le Nouveau Recueil – n°73 – Élégies d’aujourd’hui – décembre 2004/février 2005
- Le Nouveau Recueil – n°74 – La revue a vingt ans – mars/mai 2005
- Le Nouveau Recueil – n°75 – Sur le motif – juin/août 2005
- Le Nouveau Recueil – n°76 – La prose du roman – septembre/novembre 2005
- Le Nouveau Recueil – n°77 – XIXe Siècle – novembre 2005/février 2006
- Le Nouveau Recueil – n°78 – Écrits avec de la lumière – mars/mai 2006
- Le Nouveau Recueil – n°79 – Relais quatre fois sans maître – juin/août 2006
- Le Nouveau Recueil – n°80 – Le souci de la beauté – septembre/novembre 2006
- Le Nouveau Recueil – n°81 – Poésie italienne – décembre 2006/février 2007
- Le Nouveau Recueil – n°82 – Écritures de la pensée – mars/mai 2007
- Le Nouveau Recueil – n°83 – La poésie encore… – juin/août 2007
- Le Nouveau Recueil – n°84 – Énigme – septembre/novembre 2007
- Le Nouveau Recueil – n°85 – Lettres imaginaires – décembre 2007/février 2008
- LEROUX, Flavie – Les maîtresses du roi
- LE ROUX, Nicolas
- LE ROUX, Nicolas – La faveur du roi (réédition)
- LE ROUX, Nicolas – Le crépuscule de la chevalerie
- LE ROUX, Nicolas – Le roi la cour l’État
- LE SCANFF, Yvon – Le paysage romantique et l’expérience du sublime
- LEVACK, Brian P. – La grande chasse aux sorcières en Europe aux débuts des temps modernes
- LEVEAU-VALLIER, Alban – IA
- LEVILLAIN, Charles-Edouard – Vaincre Louis XIV
- LHEUREUX, Rosine – Une histoire des parfumeurs
- LIGNEREUX, Aurélien – Servir Napoléon
- LIGNEREUX, Yann – Lyon et le Roi
- LIMIDO, Luisa – L’art des jardins sous le Second Empire
- LINARES, Serge – Jean Cocteau
- Lisbonne – Pierre Kyria 1985
- LISTA, Giovanni – Le Futurisme
- Liège – Vera Feyder 1991
- LOCHER (DIR.), Fabien – La nature en communs
- LOIZEAU, Sophie – Féerie
- LOIZEAU, Sophie – Ma maîtresse forme
- Londres – Bernard Delvaille 1983
- LORIN, Amaury – Paul Doumer
- LOUETTE, Jean-François et Roger-Yves ROCHE (dir. – Portraits de l’écrivain contemporain
- Lourdes – Charles Le Quintrec 1984
- LUNEL, Alexandre – La maison médicale du roi
- LYON-CAEN, Nicolas / Raphaël Morera – À vos poubelles citoyens!
M
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°7 – La machine à gloire
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 11 – L’art de la récup’ 2021
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 12 – «C’est la fête» 2022
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 13 – «Eurêka!» 2023
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 14 – Les étages de la vie 2024
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°1 – La femme auteur 2011
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°2 – Les choses 2012
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°3 – Quand la ville dort
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n°4 – Sexorama
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 8 – Cosmopolis
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 9 – L’universel cabotinage
- MARCEL, Odile (dir.) – Composer le paysage
- MARCEL, Odile – Littoral : les aventures du Conservatoire du littoral
- MARCHETTI, Adriano (dir.) – Pascal Quignard : la mise au
- MARO, Anne – Solution terminale
- MARRAUD, Mathieu – Le pouvoir marchand
- Marseille – Francine de Martinoir 1989
- MARTEAU, Robert – Saisons
- MARTEAU, Robert – Ce que Corneille crie
- MARTEAU, Robert – Dans l’herbe
- MARTEAU, Robert – Des chevaux parmi les arbres
- MARTEAU, Robert – Fragments de la France
- MARTEAU, Robert – La venue
- MARTEAU, Robert – Le jour qu’on a tué le cochon
- MARTEAU, Robert – Le Louvre entrouvert
- MARTEAU, Robert – Le message de Paul Cézanne
- MARTEAU, Robert – Le temps ordinaire
- MARTEAU, Robert – Liturgie
- MARTEAU, Robert – Louange
- MARTEAU, Robert – Registre
- MARTEAU, Robert – Rites et offrandes
- MARTEAU, Robert – Salve
- MARTEAU, Robert – Sur le motif
- MARTEAU, Robert – Voyage au verso
- MARTEAU, Robert – Écritures
- MARTEAU, Robert – Études pour une muse
- MARTIN, Jean-Baptiste – La fin des mauvais pauvres
- MARTIN, Jean-Philippe – Des paysans écologistes
- MARTIN, Jean-Pierre – Le laminoir
- MARTIN, Jean-Pierre – Les laisons ferroviaires
- MASSON, Rémi – Défendre le roi
- MATHIS, Charles-François et MOUHOT Jean-François – Une protection de l’environnement à la française ?
- MATHIS, Charles-François et Émilie-Anne PÉPY – La ville végétale
- MATTÉI, Bruno – Rebelle rebelle
- MAULPOIX, Jean-Michel – Henri Michaux
- MAULPOIX, Jean-Michel – Les abeilles de l’invisible
- MAULPOIX, Jean-Michel – Papiers froissés dans l’impatience
- MAVRIKAKIS, Catherine – La mauvaise langue
- MAYNE, Gilles – En finir avec Michel Onfray
- MAZEAU, Guillaume – Le bain de l’histoire
- McNEILL, John R. – Du nouveau sous le soleil
- MENDÈS, Catulle – La maison de la vieille
- MEULDERS, Michel et Bernard FELTZ et Marc CROMMELINCK (dir.) – Pourquoi la science ?
- MEYZIE, Philippe – L’unique et le véritable
- MILLET, Audrey – Vie et destin d’un dessinateur textile
- MILLET, Richard (dir.) – Pour saluer Robert Marteau
- MILLET, Richard – Le sentiment de la langue
- MILLET, Richard – Le sentiment de la langue II
- MILLIOT, Vincent – L’admirable police
- MILLIOT, Vincent — Un policier des Lumières
- MILLY, Julien – Au seuil de l’image
- MINARD, Philippe – Typographes des Lumières
- MINOIS, Georges – Comment peut-on être persan?
- MINOIS, Georges – La cabale des dévots
- Missolonghi – Antoinette Jaume 1991
- MONCELET, Christian – René Guy Cadou
- MONTEL, Laurence – Marseille «capitale du crime»?
- Montréal – François Hébert 1989
- MORMICHE, Pascale – Le petit Louis XV
- MOTTET, Jean (dir.) – La forêt sonore
- MOTTET, Jean (dir.) – L’arbre dans le paysage
- MOTTET, Jean (dir.) – L’herbe dans tous ses états
- MOTTET, Jean (dir.) – Les paysages du cinéma
- MOUHOT, Jean-François – Des esclaves énergétiques
- MOUREY, Jean-Pierre – Philosophies et pratiques du détail
- MUS, David – La poétique de François Villon
- MUS, David – Le sonneur de cloches
- MÉNARD, Hélène – Maintenir l’ordre à Rome
N
- NADAUD, Alain – Malaise dans la littérature
- NAKAMURA, Yoshio / FRIELING Dirk / HUNT John Dixon – Trois regards sur le paysage français
- Nantes – Paul Louis Rossi 1987
- NASSIET, Michel – La violence une histoire sociale
- NATHAN, Michel – Lautréamont
- NAVAILLES, Jean-Pierre – La famille ouvrière dans l’Angleterre victorienne
- NAVAILLES, Jean-Pierre – Le tunnel sous la Manche (1802-1897)
- NAVAILLES, Jean-Pierre – Londres victorien
- NEXON, Yannick – Le Chancelier Séguier
- NOGUEZ, Dominique – Derniers voyages en France
- NORDON, Didier – L’âme et l’urine
- NUNEZ, Laurent – Les récidivistes
O
- ONIMUS, Jean – Jean Tardieu
- ONIMUS, Jean – Philippe Jaccottet
- Ostende – Jean Dubacq 1985
- OUELLET, Pierre – L’omis
- OUELLETTE, Fernand – Les heures
P
- PAGNIER, Dominique – La diane prussienne
- PAGNIER, Dominique – La muse continentale
- PAGNIER, Dominique – Le général hiver
- PARISOT, Roger – Robert Marteau
- Paris – Julien Green 1983
- PARROCHIA, Daniel (dir.) – François Dagognet un nouvel encyclopédiste ?
- PARROCHIA, Daniel (dir.) – Penser les réseaux
- PARROCHIA, Daniel – Inventer le masculin
- PARROCHIA, Daniel – L’homme volant
- PARROCHIA, Daniel – La forme des crises
- PARROCHIA, Daniel – Mathématiques & existence
- PARROCHIA, Daniel – Météores : essai sur le ciel et la cité
- PARROCHIA, Daniel – Philosophie et musique contemporaine
- PEIREIRE, Laurent – Le journal de Kikuko
- PEREGO, Simon – Pleurons-les
- PEREZ, Stanis – La santé de Louis XIV
- PEYRÉ, Yves – La bibliothèque de Belmont
- PEYRÉ, Yves – À même les voix du jour
- PIERRE, Benoist – La monarchie ecclésiale
- PIERROT, Jean – Guillevic
- PILECKI, Witold – Le Rapport Pilecki
- PINSON, Jean-Claude – Pastoral
- PINSON, Jean-Claude – Vies de philosophes
- PINSON, Jean-Claude – Abrégé de philosophie morale
- PINSON, Jean-Claude – Alphabet Cyrillique
- PINSON, Jean-Claude – Drapeau rouge
- PINSON, Jean-Claude – Fado (avec flocons et fantômes)
- PINSON, Jean-Claude – Habiter en poète
- PINSON, Jean-Claude – J’habite ici
- PINSON, Jean-Claude – Laïus au bord de l’eau
- PINSON, Jean-Claude – Poéthique
- PINSON, Jean-Claude – Sentimentale et naïve : nouveaux essais sur la poésie
- PLOUX, François – Bruit public
- PLUMAUZILLE, Clyde – Prostitution et révolution
- PONS, Gilbert (dir.) – Le paysage : sauvegarde et création
- POUILLARD, Violette – Histoire des zoos par les animaux
- Prague – Petr Kral 1988
- PRESNEAU, Jean-René – Signes et institution des sourds : XVIIIe–XIXe siècle
- PROVOST, Audrey – Le luxe les Lumières et la Révolution
- PUECH, Jean-Benoît – Fonds de miroir II
- PUECH, Jean-Benoît et Yves SAVIGNY (dir.) – Benjamin Jordane
- PUECH, Jean-Benoît – Du vivant de l’auteur
- PUECH, Jean-Benoît – Fonds de miroirs
- PUECH, Jean-Benoît – Jordane revisité
- PUECH, Jean-Benoît – Présence de Jordane
- PÉPY, Émilie-Anne et Charles-François MATHIS – La ville végétale
Q
- QUENET, Grégory – Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles
- QUENET, Grégory – Qu’est-ce que l’histoire environnementale ?
- QUINSAT, Gilles – Écrit en marge
- QUÉAU, Philippe – Le virtuel : vertus et vertiges
- QUÉAU, Philippe – Métaxu
- QUÉAU, Philippe – Éloge de la simulation
R
- RABATÉ, Jean-Michel – La beauté amère
- RABATÉ, Jean-Michel – La pénultième est morte
- RAUCH, André – L’envie une passion tourmentée
- Retirer un terme : Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 10 – Réseaux 2020 Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 10 – Réseaux 2020
- REVEST, Clémence – Romam veni
- Revue Recueil – n°1 – Crise de l’amour de la langue ? – 1984
- Revue Recueil – n°2 – Le Natal – 1985
- Revue Recueil – n°3 – Le Soucis – 1986
- Revue Recueil – n°4/5 – Musique et littérature – 1986
- Revue Recueil – n°6 – Grammaire rhétorique – 1987
- Revue Recueil – n°7 – Le sentiment de la merveille – 1987
- Revue Recueil – n°8 – Les silences – 1988
- Revue Recueil – n°9 – 1988
- Revue Recueil – n°10 – La bêtise – 1988
- Revue Recueil – n°11 – 1989
- Revue Recueil – n°12 – Classicisme modernité – 1989
- Revue Recueil – n°13 – Documents sur la langue française – 1989
- Revue Recueil – n°14 – 1990
- Revue Recueil – n°15 – 1990
- Revue Recueil – n°16 – 1990
- Revue Recueil – n°17 – 1990
- Revue Recueil – n°18 – 1991
- Revue Recueil – n°19 – 1991
- Revue Recueil – n°20 – 1991
- Revue Recueil – n°21 – 1992
- Revue Recueil – n°22 – 1992
- Revue Recueil – n°23/24 – L’écrivain à la fin du siècle – 1992
- Revue Recueil – n°25 – 1992
- Revue Recueil – n°26 – 1993
- Revue Recueil – n°27 – Littérature et enseignement – 1993
- Revue Recueil – n°28 – septembre 1993
- Revue Recueil – n°29 – Des québécois parlent aux français – décembre 1993/janvier 1994
- Revue Recueil – n°30 – mars/mai 1994
- Revue Recueil – n°31 – Lectures d’écrivains – juin/août 1994
- Revue Recueil – n°32 – septembre/novembre 1994
- Revue Recueil – n°33 – décembre 1994/février 1995)
- REYNAUD-PALIGOT, Carole – L’école aux colonies
- RICHEPIN, Jean – Les étapes d’un réfractaire
- RIDEAU, Gaël – Une société en marche
- RITTAUD-HUTINET, Jacques – Cinéma des origines (Le)
- RIVIÈRE, Philippe et CHOULET Philippe – La bonne école : I : Institution scolaire et contenus de savoir dans la civilisation industrielle
- RIVIÈRE, Philippe et CHOULET Philippe – La bonne école : II : Institution scolaire et contenus de savoir dans la civilisation industrielle
- ROCHEFORT, Suzanne – Vies théâtrales
- RODIER, Yann – Les raisons de la haine
- ROGER, Alain (dir.) – La théorie du paysage en France (1974-1994)
- ROGER, Alain (dir.) – La théorie du paysage en France (réédition)
- ROGER, Alain et GUÉRY François (dir.) – Maîtres et protecteurs de la nature
- ROGER, Alain – Hérésies du désir
- ROGER, Alain – L’art d’aimer
- ROLLIN, Jean-François – La maison des mémorables
- ROLLIN, Jean-François – Passage de la phasèle : opus 8
- ROSSIAUD, Jacques – Lyon 1250-1550
- ROSSIGNEUX-MEHEUST, Mathilde – Vies d’hospice
- Rouen – Philippe Delerm 1987
- ROUFFIAT, Françoise – Jean Follain
- ROUL, Jehanne – Le Poème en l’honneur de Louis le Pieux d’Ermold le Noir
- ROUSSEL, Diane – Violences et passions dans le Paris de la Renaissance
- ROUSSILLON, Marine – Don Quichotte à Versailles
- RUMPALA, Yannick – Hors des décombres du monde
S
- SABATIER, Gérard – Le prince et les arts
- SACHER-MASOCH, Léopold – La pêcheuse d’âme
- SACHER-MASOCH, Méopold – La mère de Dieu
- Saint-Brieuc – Maurice Le Lannou 1986
- SALOMÉ, Karine – Vitriol
- SALOMÉ, Karine – L’ouragan homicide
- SANSOT, Pierre – Cahiers d’enfrance
- SANSOT, Pierre – La France sensible
- SANTAMARIA, Jean-Baptiste – Le secret du prince
- SARMANT, Thierry – Les demeures du Soleil
- SAUVAGEOT, Anne (dir.)
- SCHALK, Ellery – L’épée et le sang
- SCHAPIRA, Nicolas – Un professionnel des Lettres au XVIIe siècle
- SELK, Philippe – Un livre d’argile
- SELLA, Jérôme – Tenir le loup par les oreilles
- SERDECZNY, Anton – Du tabac pour le mort
- SERNA, Pierre (dir.) – La politique du rire
- SERNA, PIerre – Dictionnaire d’histoire criique des animaux
- SERNA, Pierre – La république des girouettes
- SERRE, Anne – Grande Tiqueté
- SERRE, Anne – Au secours
- SERRE, Anne – Eva Lone
- SERRE, Anne – Les gouvernantes
- SERRE, Anne – Un voyage en ballon
- SIMON-CARRERE, Anne – Chanter la Grande Guerre
- SIMONIN, Louis – La vie souterraine
- Sophie – L’île du renard polaire de To Kirsikka
- SOTTOCASA, Valérie – Les brigands et la Révolution
- SOURIAC, Pierre-Jean – Une guerre civile
- SOUVAY, François – Ciné-club
- STAMELMAN, Richard et Mary Ann CAWS (dir.) – Écrire le livre autour d’Edmond Jabès
- STENDHAL, Lettres d’amour
- STÉFAN, Jude – Dialogues avec la Soeur
- STÉFAN, Jude – Dialogues des figures
- STÉFAN, Jude – L’angliciste
- STÉFAN, Jude – L’Idiot de village
- STÉFAN, Jude – La fête de la Patronne
- STÉFAN, Jude – Le nouvelliste
- STÉFAN, Jude – Le Sillographe
- STÉFAN, Jude – Les états du corps
- STÉFAN, Jude – Oraisons funestes
- STÉFAN, Jude – Scènes dernières
- STÉFAN, Jude – Vie de Saint
- SYNOWIECKI, Jan – Paris en ses jardins
T
- TARTAKOWSKY, Danielle – Les syndicats en leurs murs
- TARTAKOWSKY, Danielle – Manifester à Paris
- TEYSSEIRE-SALLMANN, Line – Métamorphoses d’une ville
- THE LISTENER, L’art et l’État
- THILLAY, Alain – Le faubourg Saint-Antoine et ses «faux-ouvriers»
- THOMAS, Mona – Comment faire un coquelicot avec une danseuse
- THOMAS, Mona – La chronique des choses
- THOMAS, Mona – Mon vis-à-vis
- THOMAS, Mona – Ton visage d’animal
- THOMSON, Ann – L’âme des lumières
- TILLIER, Bertrand – L’artiste dans la cité
- TILLIER, Bertrand – Mérovak l’homme des cathédrales
- TILLIER, Bertrand – La Commune de Paris
- TILLIER, Bertrand – Les artistes et l’affaire Dreyfus
- TINLAND, Franck (dir.) Nouvelles sciences
- TINLAND, Franck (dir.) – Systèmes naturels systèmes artificiels
- TINLAND, Franck – Ordre biologique ordre technologique
- TITUS-CARMEL, Gérard – & Lointains
- TITUS-CARMEL, Gérard – Ici rien n’est présent
- TITUS-CARMEL, Gérard – L’ordre des jours
- TITUS-CARMEL, Gérard – Seul tenant
- TITUS-CARMEN, Gérard – Travaux de fouille et d’oubli
- Tokyo – Jean Pérol 1986
- TOMALIN, Claire – Samuel Pepys
- TOUZERY, Mireille – Payer pour le roi
- TRAVERSIER, Mélanie – Le journal d’une reine
- TRICLOT, Mathieu Le moment cybernétique
- Trieste – Franck Venaille 1985
V
- VALADE, Pauline – Le goût de la joie
- VANNIER, Gilles – Paul Verlaine
- VAN ROGGER ANDREUCCI, Christine – Max Jacob
- VASSORT, Jean – Les papiers d’un laboureur au siècle des Lumières
- VAUBAN, Sébastien Le Prestre de – Oisivetés (Les)
- Venise – Frédérick Tristan 1984
- VERGNES, Sophie – Les Frondeuses
- VERJUS, Anne et DAVIDSON Denise – Le roman conjugal
- VERLAINE, Ex-madame Paul – Mémoires de ma vie
- Versailles – Pierre-Robert Leclercq 1991
- Vichy – Denis Tillinac 1986
- VIGOUREUX, Clarisse – Parole de providence
- VIROL, Michèle – Louis XIV et Vauban
- VIROL, Michèle – Vauban
- VIROL, Michèle – Vauban (réédition)
- VO-HA, Paul -Rendre les armes
- VOELLMY, Jean – René Char
- VON NEUMANN, John – Théorie générale et logique des automates
- VÉQUAUD, Yves – Bénarès
W
- WAGNEUR, Jean-Didier / Françoise CESTOR – Les Bohèmes
- WIART, Claude (dir.) – Art et fantasme
- WILLY [Jean de Tinan], Maîtresse d’esthètes