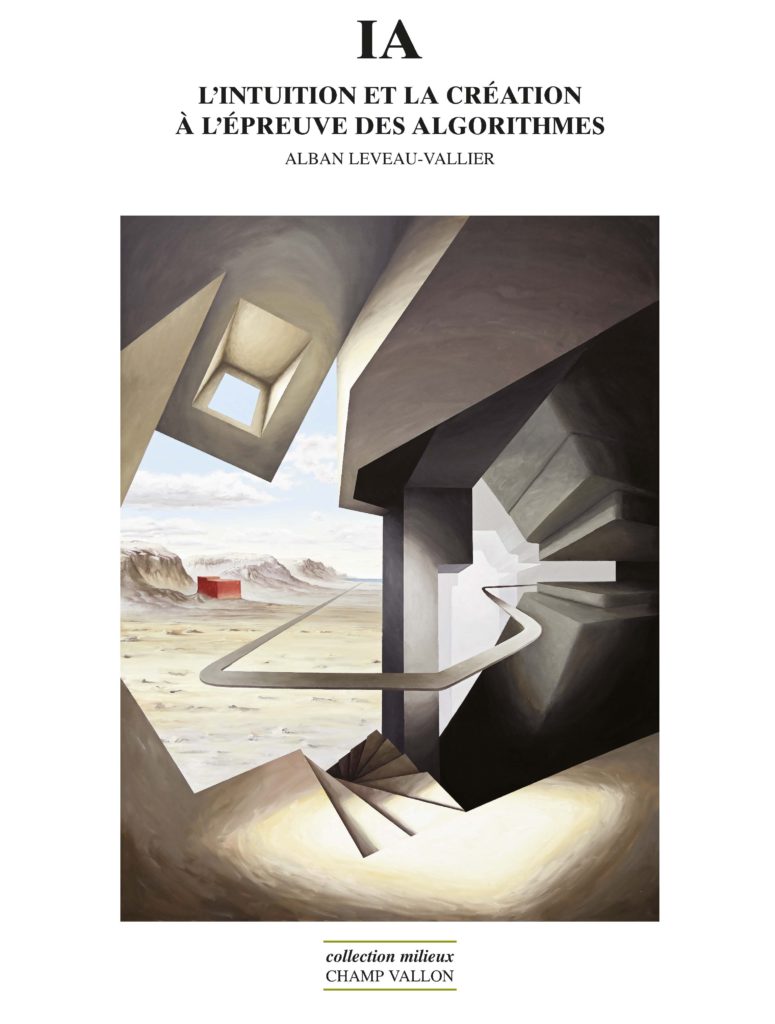Collection Milieux
«Milieux»: collection fondée par Jean-Claude Beaune
Qu’est-ce au juste que la civilisation industrielle? La plus claire forme de civilisation pour les uns, la plus noire barbarie pour les autres. Entre les deux pôles extrêmes, les études de la collection «Milieux» proposent les éclats d’un ensemble d’images multiples, contradictoires, complémentaires.
ALBAN LEVEAU-VALLIER IA
L'intuition et la création à l'épreuve des algorithmes
ROBERT DAMIEN Eutopiques
Exercices de méditations physiques
MARIO BORILLO (dir.) Dans l’atelier de l’art
Expériences cognitives
JEAN-CLAUDE BEAUNE Engrenages
Anthropologie des milieux techniques (1)
DANIEL PARROCHIA La forme des crises
Logique et épistémologie
MATHIEU TRICLOT Le moment cybernétique
La constitution de la notion d'information
ANDRÉ GUILLERME La Naissance de l’Industrie à Paris
Entre sueurs et vapeurs. 1780-1830.
DANIEL PARROCHIA Philosophie et musique contemporaine
ou le nouvel esprit musical
SABINE BARLES L’invention des déchets urbains
France: 1790-1970
JÉRÔME DARGENT Le corps obèse
Obésité, science et culture
A. GUILLERME, A.-C. LEFORT, G. JIGAUDON Dangereux, insalubres et incommodes
Paysages industriels en banlieue parisienne (XIXe–XXe siècles)
DANIEL PARROCHIA L’homme volant
Philosophie de l'aéronautique et des techniques de navigation
GÉRARD CHAZAL Interfaces
Enquêtes sur les mondes intermédiaires
FRANÇOISE DAGOGNET Tableaux et langage de la chimie
essai sur la représentation
JEAN-CLAUDE BEAUNE Le balancier du monde
la matière, la machine et la mort: essai sur le temps des techniques
GÉRARD CHAZAL Les réseaux du sens
De l'informatique aux neurosciences
PAUL-MONTGOMERY CHURCHLAND Matière et conscience
traduit de l'américain par Gérard Chazal
JEAN-CLAUDE BEAUNE Philosophie des milieux techniques
La matière, l'instrument, l'automate
FRANCK TINLAND (dir.) Nouvelles sciences
Modèles techniques et pensée politique de Bacon à Condrocet
M. MEULDERS, M. CROMMELINCK, B. FELTZ (dir.) Pourquoi la science ?
Impacts et limites de la recherche
JOHN VON NEUMANN Théorie générale et logique des automates
Traduit de l'américain par Jean-Paul Auffand
Précédé de «La pensée et les machines : le mécanisme algorithmique de John von Neumann» par Gérard Chazal
JEAN-PIERRE MOUREY Philosophies et pratiques du détail
Hegel, Ingres et quelques autres
GILBERT HOTTOIS Entre symboles et technosciences
Un itinéraire philosophique
GÉRARD CHAZAL Le miroir automate
Introduction à une philosophie de l'informatique
ANDRÉ GUILLERME Bâtir la ville
Révolutions industrielles dans les matériaux de construction : France-Grande-Bretagne (1760-1840)
JEAN-CLAUDE BEAUNE (dir.) La philosophie du remède : instruments et philosophie
(dir.)
Préface de Jacques Ruffié
DANIEL PARROCHIA Mathématiques & existence
Ordres fragments, empiètements
Préface de François Dagognet
PHILIPPE BRETON, ALAIN-MARC RIEU, FRANCK TINLAND La techno-science en question
Éléments pour une archéologie du XXe siècle
ODILE MARCEL (dir.) Composer le paysage
Constructions et crises de l'espace (1782-1992)
Préface de Michel Vovelle
PHILIPPE QUÉAU Métaxu
Théorie de l'art intermédiaire
JEAN-CLAUDE BEAUNE Les spectres mécaniques
Essai sur les relations entre la mort et les techniques : le troisième monde
BRUNO MATTÉI Rebelle, rebelle
Révoltes et mythes du mineur (1830-1946)
BERNARD LEMOINE L’architecture du fer
France : XIXe siècle
PHILIPPE QUÉAU Éloge de la simulation
De la vie des langages à la synthèse des images
Préface de François Dagognet
JEAN BORREIL (dir.) Les sauvages dans la cité
Auto-émancipation du peuple et instruction des prolétaires au XIXe siècle
Avant-propos de Jacques Derrida
JEAN-PIERRE GAUDIN L’avenir en plan
technique et politique dans la prévision urbaine (1900-1930)
FRANÇOIS GUÉRY (dir.) L’idée de la ville
Actes du colloque international de Lyon
JEAN-MICHEL CHAPLAIN La chambre des tisseurs
Louviers: cité drapière (1680-1840)
ALAN ROSS ANDERSON Pensée et machine
Présentation de Gérard Guièze
Traduit de l'américain par Patrice Blanchard
JEAN-CLAUDE BEAUNE Le vagabond et la machine
Essai sur l'automatisme ambulatoire : médecine, technique, société (1880-1910)
JEAN-PIERRE NAVAILLES La famille ouvrière dans l’Angleterre victorienne
Des regards aux mentalités
JEAN-BAPTISTE MARTIN La fin des mauvais pauvres
De l'assistance à l'assurance
Préface de Madeleine Rebérioux
FRANÇOISE DAGOGNET (dir.) Mort du paysage ?
Philosophie et esthétique du paysage
LOUIS SIMONIN La vie souterraine
Les mines et les mineurs
Préface de Jean-Claude Beaune
YVES DEFORGE Le graphisme technique
son histoire et son enseignement
Préface de Abraham A. Moles
GROUPE DE TRAVAIL DE LA MAISON D’ÉCOLE À MONTCEAU-LES-MINES Cent ans d’école
Préface de Georges Duby
A
- Adriano (dir.) – Pascal Quignard : la mise au | MARCHETTI
- Alain (dir.) – La théorie du paysage en France (1974-1994)|ROGER
- Alain (dir.) – La théorie du paysage en France (réédition)|ROGER
- Alain et GUÉRY François (dir.) – Maîtres et protecteurs de la nature | ROGER
- Alain – Hérésies du désir|ROGER
- Alain – L’art d’aimer | ROGER
- Alain – La Vendée 1789-1793 | GERARD
- Alain – Le faubourg Saint-Antoine et ses «faux-ouvriers» | THILLAY
- Alain – Malaise dans la littérature | NADAUD
- Alan Ross – Pensée et machine | ANDERSON
- Alban – IA | LEVEAU-VALLIER
- Alberto – Festin et destin | EPISCOPI
- Albert – La théorie de l’art pour l’art | CASSAGNE
- Albert – Les Croix-de-feu à l’âge des fascismes | KECHICHIAN
- Alexandre Y. – Le lys et le globe | HARAN
- Alexandre – La maison médicale du roi | LUNEL
- Alexandre — La Régence absolue | DUPILET
- Alicia – Bogota | DUJOVNE-ORTIZ
- Alicia – Buenos-Aires | DUJOVNE-ORTIZ
- Alin – La guerre vite sinon j’étouffe | ANSEEUW
- Alphonse – Histoire de Charlotte Corday | DE LAMARTINE
- Amaury – Paul Doumer | LORIN
- André – Dangereux insalubres et incommodes | GUILLERME
- André – L’envie une passion tourmentée | RAUCH
- André – Bâtir la ville | GUILLERME
- André – Correspondance et mémoires d’un caricaturiste | GILL
- André – Hölderlin | ALTER
- André – Jean-Claude Renard | ALTER
- André – La Naissance de l’Industrie à Paris | GUILLERME
- André – Les temps de l’eau : La cité l’eau et les techniques| GUILLERME
- André – Propédeutique (réédition)|GREEN
- André – Propédeutique|GREEN
- André – Tristan Corbière | LE MILINAIRE
- Anne-Emmanuelle – Violette Nozière la fleur du mal | DEMARTINI
- Anne – Grande Tiqueté | SERRE
- Anne – La paix au village | BONZON
- Anne-Marie – Une bibliothèque byzantine | CHENY
- Anne Emmanuelle – Le banquet de Rimbaud|BERGER
- Anne et DAVIDSON Denise – Le roman conjugal|VERJUS
- Anne – Au secours | SERRE
- Anne – Chanter la Grande Guerre | SIMON-CARRERE
- Anne – Eva Lone | SERRE
- Anne – L’embaumement|CAROL
- Anne – Les gouvernantes | SERRE
- Anne – Physiologie de la Veuve|CAROL
- Anne – Solution terminale | MARO
- Anne – Un voyage en ballon | SERRE
- Ann – L’âme des lumières | THOMSON
- Antoine / Evelyne PATLAGEAN / Benjamin LELLOUCH – Les Juifs dans l’histoire | GERMA
- Antoinette – Missolonghi | JAUME
- Anton – La bûche et le gras | SERDECZNY
- Antonino – L’Italie de Bonaparte | DE FRANCESCO
- Anton – Du tabac pour le mort | SERDECZNY
- Ariel – Les Albums | DENIS
- Ariel – Valigan | DENIS
- Arnaud – La grande tuerie des chiens | EXBALIN
- Arnaud – L’honneur du soldat|GUINIER
- Arthur – Aux captifs aux vaincus | BERNARD
- Arthur – Ça va | BERNARD
- Arthur – Gaby et son maître | BERNARD
- Arthur – Gaby Grandit | BERNARD
- Arthur – L’oubli de la natation | BERNARD
- Arthur – La guerre avec ma mère | BERNARD
- Arthur – Le désespoir du peintre | BERTRAND
- Arthur – Tout est à moi dit la poussière | BERNARD
- Audrey – Le luxe les Lumières et la Révolution| PROVOST
- Audrey – Vie et destin d’un dessinateur textile | MILLET
- Augustin (dir.) – Cinq propositions pour une théorie du paysage|BERQUE
- Aurélien – Servir Napoléon | LIGNEREUX
B
- Benjamin – L’apprentissage du roman | JORDANE
- Benjamin – Toute ressemblance… | JORDANE
- Benoist – La monarchie ecclésiale | PIERRE
- Benoît – Le cri du lézard | CONORT
- Benoît – Sortir | CONORT
- Benoît – Cette vie est la nôtre | CONORT
- Benoît – Le coeur pincé | DAMON
- Benoît – Main de nuit | CONORT
- Benoît – Retour à Ostende | DAMON
- Benoît – Trois visites à Charenton | DAMON
- Benoît – Écrire dans le noir | CONORT
- Bernard & Antoine SAVOYE – Les inventeurs oubliés : Le Play et ses continuateurs aux origines des sciences sociales| KALAORA
- Bernard – Bordeaux | DELVAILLE
- Bernard – Londres | DELVAILLE
- Bernard et Christian DEVILLERS – Le Creusot : naissance et développement d’une ville industrielle 1782-1914 | HUET
- Bernard et SCHIELE Daniel (dir.) – Vulgariser la science : le procès de l’ignorance | JACOBI
- Bernard et VLASSOPOULOS Chloé – Pour une sociologie de l’environnement | KALAORA
- Bernard – L’architecture du fer | LEMOINE
- Bernard – Une vraie boucherie | JANNIN
- Bernard – Ça sent le tabac | JANNIN
- Bertrand & Franck TINLAND (dir.) – Sens du devenir et pensée de l’histoire au temps des lumières| BINOCHE
- Bertrand (dir.) – L’Homme perfectible | BINOCHE
- Bertrand (dir.) – Les équivoques de la civilisation | BINOCHE
- Bertrand – L’artiste dans la cité | TILLIER
- Bertrand – Mérovak l’homme des cathédrales | TILLIER
- Bertrand – L’amant Liesse | LECLAIR
- Bertrand – La Commune de Paris | TILLIER
- Bertrand – Le maréchal de Luxembourg | FONCK
- Bertrand – Les artistes et l’affaire Dreyfus| TILLIER
- Bertrand – Verticalités de la littérature | LECLAIR
- Brian P. – La grande chasse aux sorcières en Europe aux débuts des temps modernes | LEVACK
- Bruno – Rebelle rebelle| MATTEI
C
- Carl – Cher Monsieur le Président|BOUCHARD
- Carole – A l’école du soir | CHRISTEN
- Carole – L’école aux colonies | REYNAUD-PALIGOT
- Caroline – Parlement et parlementaires | LE MAO
- Caroline – Ego Tango | DE MULDER
- Caroline – Nous les bêtes traquées | DE MULDER
- Catherine – Les ateliers de la parure | LANOË
- Catherine – La mauvaise langue | MAVRIKAKIS
- Catherine – La poudre et le fard | LANOË
- Catherine – La Venise des livres | KIKUCHI
- Catulle – La maison de la vieille | MENDÈS
- Cent ans d’école | GROUPE DE TRAVAIL DE LA MAISON D’ÉCOLE À MONTCEAU-LES-MINES
- Charles-Edouard – Vaincre Louis XIV | LEVILLAIN
- Charles-François et MOUHOT Jean-François – Une protection de l’environnement à la française ? | MATHIS
- Charles-François et Émilie-Anne PÉPY – La ville végétale | MATHIS
- Charles – Lourdes | LE QUINTREC
- Charles Antoine – La fermeté de mon caractère | GIBERT DE L’ISLE
- Charlotte – Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle | GUICHARD
- Christian – Encyclopédie conceptuelle et thématIque de la philosophie | GODIN
- Christian – La crise de la réalité | GODIN
- Christian – Marx en Amérique | LAVAL
- Christian – Une odyssée pour Denver | GARCIN
- Christian – Victor Hugo et la Commune | GODIN
- Christian et Yves VADÉ (dir.) – Marcel Schwob | BERG
- Christian – Chaplin et ses doubles | GODIN
- Christian – Fées diables et salamandres | GARCIN
- Christian – Grand art avec fausses notes | DOUMET
- Christian – Illettrés durs d’oreille malbâtis | DOUMET
- Christian – La démoralisation | GODIN
- Christian – La fin de l’Humanité | GODIN
- Christian – La haine de la nature | GODIN
- Christian – Les lieux communs d’aujourd’hui | GODIN
- Christian – Le triomphe de la volonté | GODIN
- Christian – Poète moeurs et confins | DOUMET
- Christian – René Guy Cadou | MONCELET
- Christian – Rien | GARCIN
- Christian – Sortilège (réédition) | GARCIN
- Christian – Sortilège | GARCIN
- Christian – Traité de la mélancolie de cerf | DOUMET
- Christian – Vanité du roi Guitare | DOUMET
- Christian – Victor Segalen | DOUMET
- Christine – Max Jacob | VAN ROGGER ANDREUCCI
- Christophe (dir.) – Le temps des capitales culturelles | CHARLE
- Christophe – La mort subite du nourrisson | BEAUFILS
- Christophe – La noblesse de l’empire romain | BADEL
- Christophe – Maurice Blanchot : partenaire invisible (réédition) | BIDENT
- Christophe – Maurice Blanchot : partenaire invisible | BIDENT
- Chroniques inédites du Journal de Paris | STENDHAL
- Claire – Samuel Pepys | TOMALIN
- Clarisse – Parole de providence | VIGOUREUX
- Claude (dir.) – Art et fantasme | WIART
- Claude-Michel – Le Caire | CLUNY
- Claude-Olivier – L’homme altéré : races et dégénérescence (XVIIe–XIXe siècles)|DORON
- Claude – Escales | DOURGUIN
- Claude – La forêt périlleuse | DOURGUIN
- Claude – La lumière des villes | DOURGUIN
- Claude – Lettres de l’avent | DOURGUIN
- Claude – Recours | DOURGUIN
- Claude – Un royaume près de la mer | DOURGUIN
- Claude – Écarts | DOURGUIN
- Clyde – Prostitution et révolution | PLUMAUZILLE
- Clémence – Romam veni | REVEST
- Corinne – Gérar de Nerval | BAYLE
- Corinne – Rouges Roses de l’oubli | BAYLE
- Cécile – Psychanalyse de l’art symboliste pictural|CROCE
D
- Daniel (dir.) – François Dagognet un nouvel encyclopédiste ? | PARROCHIA
- Daniel (dir.) – Penser les réseaux | PARROCHIA
- Daniel – Carnets de l’écrivain inexistant | FLEURY
- Daniel – La tradition fumiste | GROJNOWSKI
- Daniel – Zoltan Zékator et Joseph Staline mangent des artichauts | FLEURY
- Danielle – 1645: les Français ont la parole | TARTAKOSWSKY
- Danielle – Les syndicats en leurs murs | TARTAKOWSKY
- Danielle – La grande filature | AUBY
- Danielle – Manifester à Paris | TARTAKOWSKY
- Daniel – Inventer le masculin | PARROCHIA
- Daniel – L’homme volant | PARROCHIA
- Daniel – La forme des crises | PARROCHIA
- Daniel – Le désert et l’enfance | KLÉBANER
- Daniel – Mathématiques & existence | PARROCHIA
- Daniel – Météores : essai sur le ciel et la cité | PARROCHIA
- Daniel – Philosophie et musique contemporaine | PARROCHIA
- Daniel – Éluard | BERGEZ
- David (dir.) – Commémorer les victimes en Europe | EL KENZ
- David (dir.) – Les bûchers du roi | EL KENZ
- David – Les huguenots de Paris et l’avènement de la liberté religieuse | GARRIOCH
- David A. – La première guerre totale|BELL
- David – La poétique de François Villon | MUS
- David – Le sonneur de cloches | MUS
- David — De Lully à Mozart | HENNEBELLE
- Denis (sous la direction de ) – Historiens d’Europe historiens de l’Europe | CROUZET
- Denis – L’histoire introuvable | CROUZET
- Denis – Les guerriers de Dieu ¬ CROUZET
- Denis – Vichy | TILLINAC
- Denis / Élisabeth CROUZET-PAVAN / Philippe DESAN / Clémence REVEST – L’humanisme à l’épreuve de l’Europe | CROUZET
- Denis – Cocagne | BOURGEOIS
- Denis – Dieu en ses royaumes (réédition)|CROUZET
- Denis – Dieu en ses royaumes | CROUZET
- Denis – La sagesse et le malheur | CROUZET
- Denis – Les guerriers de Dieu (réédition)|CROUZET
- Denis – Les guerriers de Dieu | CROUZET
- Diana et Jacqueline PLUET-DESPATIN – L’exercice du bonheur | COOPER-RICHET
- Diana K. – Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb |DAVIS
- Diane – Violences et passions dans le Paris de la Renaissance | ROUSSEL
- Didier – L’âme et l’urine | NORDON
- Didier – Lettres de Ponce Pilate | LAROQUE
- Didier et Michel ZÉRAFFA (dir.) – Le récit amoureux | COSTE
- Didier – La mort de Laclos | LAROQUE
- Didier – Le Dieu Kairos | LAROQUE
- Dominique – Derniers voyages en France | NOGUEZ
- Dominique – Jardins et jardiniers de Versailles au Grand siècle | GARRIGUES
- Dominique – La diane prussienne | PAGNIER
- Dominique – La muse continentale | PAGNIER
- Dominique – Le général hiver | PAGNIER
- Déborah – La nature du peuple|COHEN
E
- Elie – D’une noblesse l’autre | HADDAD
- Ellery – L’épée et le sang | SCHALK
- Emmanuel (dir.) Iconoclasme et révolutions | FUREIX
- Emmanuel – L’œil blessé | FUREIX
- Emmanuel – Sexualités sociétés nativités | DESVEAUX
- Emmanuel Sylvie APRILE et Jean-Claude CARON (dir.) – La liberté guidant les peuples | FUREIX
- Emmanuel – La France des larmes | FUREIX
- Eric – «Nous reviendrons!» | FOURNIER
- Eugène – En glanant dans les champs désolés | GREEN
- Ex-madame Paul – Mémoires de ma vie | VERLAINE
F
- Fabien – La nature en communs | LOCHER (DIR.)
- Fabrice – Le règne de la poire|ERRE
- Fernand – Les heures | OUELLETTE
- Flavie – Les maîtresses du roi | LEROUX
- Fleur – Voir l’invisible | HOPKINS-LOFÉRON
- Francine – Marseille | DE MARTINOIR
- Franck (dir.) Nouvelles sciences | TINLAND
- Franck (dir.) – Systèmes naturels systèmes artificiels |TINLAND
- Franck – Trieste | VENAILLE
- Franck – Ordre biologique ordre technologique |TINLAND
- François (dir.) – L’idée de la ville | GUÉRY
- François (dir.) – Mort du paysage ?| DAGOGNET
- François – Bruit public | PLOUX
- François – Ciné-club | SOUVAY
- François – Lettres modernes | SOUVAY
- François – Montréal | HEBERT
- Françoise – Jean Follain | ROUFFIAT
- Françoise – Rien n’est perdu | ASSO
- François Robert DAMIEN et Robert DUMAS – Faut-il brûler Régis Debray ? | DAGOGNET
- François – Délicates Sorcières | DOMINIQUE
- François – Le musée sans fin | DAGOGNET
- François – Tableaux et langage de la chimie | DAGOGNET
- Frédéric – Mourir de la peste | JACQUIN
- Frédéric – Un pouvoir malhonnête | MONIER
- Frédéric – Venise | TRISTAN
G
- Gabriel – Dominos | BERGOUNIOUX
- Gabriel – Doucement | BERGOUNIOUX
- Gabriel – Il y a de | BERGOUNIOUX
- Gabriel – Il y a un | BERGOUNIOUX
- Gabriel – Mes nippes | BERGOUNIOUX
- Gaël – Une société en marche | RIDEAU
- Geoffrey – Le parlement volatil | CHAUCER
- Georges – Comment peut-on être persan? | MINOIS
- Georges – La cabale des dévots | MINOIS
- Georges – Les mémoires de Pipe-en-bois | CAVALIER
- Gilbert (dir.) – Le paysage : sauvegarde et création|PONS
- Gilbert – Entre symboles et technosciences | HOTTOIS
- Gilles – En finir avec Michel Onfray | MAYNE
- Gilles – Paul Verlaine | VANNIER
- Gilles – Écrit en marge | QUINSAT
- Giorgio – Le franc tireur | CAPRONI
- Giovanni – Le Futurisme |LISTA
- Goulven – Pour l’honneur des familles | KÉRIEN
- Grégory – Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles | QUENET
- Grégory – Qu’est-ce que l’histoire environnementale ? |QUENET
- Guillaume et KALAORA Bernard et VLASSOPOULOS Chloé – La forêt salvatrice | DECOCQ
- Guillaume – Le bain de l’histoire|MAZEAU
- Guillaume – À l’Enseigne de Gersaint | GLORIEUX
- Guillemette – Genèses du Moyen Orient | CROUZET
- Guy – Éloge pour une cuisine de province | GOFFETTE
- Gérard – & Lointains |TITUS-CARMEL
- Gérard – Formes figures réalité| CHAZAL
- Gérard – Ici rien n’est présent | TITUS-CARMEL
- Gérard – Interfaces| CHAZAL
- Gérard – L’image de Rome | LABROT
- Gérard – L’ordre des jours | TITUS-CARMEL
- Gérard – L’ordre humain ou le déni de nature | CHAZAL
- Gérard – Le corps souffrant | DANOU
- Gérard – Le miroir automate | CHAZAL
- Gérard – Le prince et les arts | SABATIER
- Gérard – Les médiations théoriques | CHAZAL
- Gérard – Les réseaux du sens | CHAZAL
- Gérard – Peinture et société à Naples (XVIe–XVIIIe siècles) | LABROT
- Gérard – Pierre Reverdy | BOCHOLIER
- Gérard – Seul tenant | TITUS-CARMEL
- Gérard – Sisyphes chrétiens | LABROT
- Gérard – Travaux de fouille et d’oubli | TITUS-CARMEN
- Gérard – Yves Bonnefoy | GASARIAN
- Gérard – Études napolitaines | LABROT
H
- Haim – Une révolution à l’oeuvre | BURSTIN
- Harry Roderick – Naissance de la Résistance dans la France de Vichy | KEDWARD
- Henri – Ventôses | DROGUET
- Hervé – Lire et écrire l’avenir | DREVILLON
- Hélène – L’empire de la nature | BLAIS
- Hélène – Faire voir faire croire | DUCCINI
- Hélène – Guerre et paix dans la France du Grand Siècle | DUCCINI
- Hélène – Les procès du cardinal de Richelieu | FERNANDEZ-LACÔTE
- Hélène – Maintenir l’ordre à Rome | MENARD
I
J
- Jacques – Cher Monsieur Zavatta | GERAUD
- Jacques – Cinéma des origines (Le) | RITTAUD-HUTINET
- Jacques – Journal de la mémoire | BOREL
- Jacques – Les Collections | GUILLERME
- Jacques – Lyon 1250-1550 | ROSSIAUD
- Jacques – Photoroman en 47 légendes | GERAUD
- Jacques – Propos sur l’autobiographie | BOREL
- Jacques – Proustissimots | GERAUD
- Jacques – Sur les poètes | BOREL
- Jan – Paris en ses jardins | SYNOWIECKI
- Janine – Éthique et esthétique de la perversion |CHASSEGUET-SMIRGEL
- Janine – Éthique et esthétique de la perversion — Réédition |CHASSEGUET-SMIRGEL
- Jean (dir.) – La forêt sonore | MOTTET
- Jean (dir.) – L’arbre dans le paysage|MOTTET
- Jean (dir.) – L’herbe dans tous ses états|MOTTET
- Jean (dir.) – La France en mouvement | BOUVIER
- Jean (dir.) – Les paysages du cinéma|MOTTET
- Jean (dir.) – Les sauvages dans la cité | BORREIL
- Jean (dir.) – Pouvoirs du négatif dans la psychanalyse et la culture | GUILLAUMIN
- Jean-Baptiste – L’En-deça des images| CHANTOISEAU
- Jean-Baptiste – La fin des mauvais pauvres | MARTIN
- Jean-Baptiste – Le secret du prince | SANTAMARIA
- Jean-Baptiste – Rappels | GOUREAU
- Jean-Benoît – Fonds de miroir II | PUECH
- Jean-Benoît et Yves SAVIGNY (dir.) – Benjamin Jordane | PUECH
- Jean-Benoît – Du vivant de l’auteur | PUECH
- Jean-Benoît – Fonds de miroirs | PUECH
- Jean-Benoît – Jordane revisité | PUECH
- Jean-Benoît – Présence de Jordane | PUECH
- Jean-Claude (dir.) – Paris l’insurrection capitale | CARON
- Jean-Claude (dir.) – La mesure : instruments et philosophie | BEAUNE
- Jean-Claude (dir.) – La philosophie du remède : instruments et philosophie | BEAUNE
- Jean-Claude (dir.) – La vie et la mort des monstres | BEAUNE
- Jean-Claude (dir.) – Le déchet le rebut le rien | BEAUNE
- Jean-Claude (dir.) – Phénoménologie et psychanalyse : étranges relations | BEAUNE
- Jean-Claude – Le nez de Balzac | CARON
- Jean-Claude – Les spectres mécaniques | BEAUNE
- Jean-Claude – Pastoral | PINSON
- Jean-Claude – Simon Deutz un Judas romantique | CARON
- Jean-Claude – Van Gogh en toutes lettres | CARON
- Jean-Claude – Vies de philosophes | PINSON
- Jean-Claude – Abrégé de philosophie morale |PINSON
- Jean-Claude – Alphabet Cyrillique | PINSON
- Jean-Claude – Drapeau rouge |PINSON
- Jean-Claude – Engrenages | BEAUNE
- Jean-Claude – Fado (avec flocons et fantômes) | PINSON
- Jean-Claude – Frères de sang|CARON
- Jean-Claude – Habiter en poète | PINSON
- Jean-Claude – J’habite ici | PINSON
- Jean-Claude – Laïus au bord de l’eau | PINSON
- Jean-Claude – Le balancier du monde | BEAUNE
- Jean-Claude – Les deux vies du Général Foy | CARON
- Jean-Claude – Le vagabond et la machine | BEAUNE
- Jean-Claude – Machinations : anthropologie des milieux techniques (2) | BEAUNE
- Jean-Claude – Philosophie des milieux techniques | BEAUNE
- Jean-Claude – Poéthique | PINSON
- Jean-Claude – Sentimentale et naïve : nouveaux essais sur la poésie | PINSON
- Jean-Didier / Françoise CESTOR – Les Bohèmes | WAGNEUR
- Jean-François et Roger-Yves ROCHE (dir. – Portraits de l’écrivain contemporain | LOUETTE
- Jean-François – De l’acte autobiographique|CHIANTARETTO
- Jean-François – Des esclaves énergétiques |MOUHOT
- Jean-François – La maison des mémorables | ROLLIN
- Jean-François – Passage de la phasèle : opus 8 | ROLLIN
- Jean – La Nouvelle Orléans | PEROL
- Jean-Louis – Voyages à Saint-Maur | GIOVANNONI
- Jean-Luc – Ordres et désordres biographiques|CHAPPEY
- Jean-Marie – Annecy | DUNOYER
- Jean-Marie et Jean LAHOUGUE – Écriverons et liserons en vingt lettres | LACLAVETINE
- Jean-Marie – Le mythe de saint Denis | LE GALL
- Jean-Marie – Les moines au temps des réformes | LE GALL
- Jean-Michel – Henri Michaux | MAULPOIX
- Jean-Michel – La beauté amère|RABATÉ
- Jean-Michel – La chambre des tisseurs | CHAPLAIN
- Jean-Michel – La pénultième est morte |RABATÉ
- Jean-Michel – Les abeilles de l’invisible | MAULPOIX
- Jean-Michel – Papiers froissés dans l’impatience | MAULPOIX
- Jean – Ostende | DUBACQ
- Jean-Pascal – Le défait | DUBOST
- Jean-Paul – Tableau d’hiver | GOUX
- Jean-Paul – La fabrique du continu | GOUX
- Jean-Paul – La jeune fille en bleu | GOUX
- Jean-Paul – Sourdes contrées | GOUX
- Jean-Philippe – Des paysans écologistes | MARTIN
- Jean-Pierre (Arthur) – Les deux Paris | BERNARD
- Jean-Pierre (Arthur) – Paris rouge (1944-1964) | BERNARD
- Jean-Pierre – L’abbé de Saint-Pierre | BOIS
- Jean-Pierre – L’avenir en plan | GAUDIN
- Jean-Pierre – La famille ouvrière dans l’Angleterre victorienne| NAVAILLES
- Jean-Pierre – Le laminoir | MARTIN
- Jean-Pierre – Les laisons ferroviaires | MARTIN
- Jean-Pierre – Le tunnel sous la Manche (1802-1897) | NAVAILLES
- Jean-Pierre – Londres victorien | NAVAILLES
- Jean-Pierre – Philosophies et pratiques du détail | MOUREY
- Jean-René – Signes et institution des sourds : XVIIIe–XIXe siècle | PRESNEAU
- Jean – Tokyo | PEROL
- Jean Raymond – L’Évangile du démon | FANLO
- Jean – Entre blessure et cicatrice|GUILLAUMIN
- Jean – Folie et création | GILLIBERT
- Jean – Guillevic | PIERROT
- Jean – Jean Tardieu | ONIMUS
- Jean – Le domaine d’Ana | LAHOUGUE
- Jean – Le psychodrame de la psychanalyse | GILLIBERT
- Jean – Les papiers d’un laboureur au siècle des Lumières | VASSORT
- Jean – Les étapes d’un réfractaire | RICHEPIN
- Jean – Lettre au maire de mon village | LAHOUGUE
- Jean – Oeuvres complètes | DE LA VILLE DE MIRMONT
- Jean – Philippe Jaccottet | ONIMUS
- Jean – René Char | VOELLMY
- Jehanne – Le Poème en l’honneur de Louis le Pieux d’Ermold le Noir | ROUL
- Jocelyn – Le Canal aux cerises | DUPRE
- John / Nelly BIELSKI – Le dernier portrait de Francisco Goya | BERGER
- John et Françoise GUICHON (dir.) – Photographe et le pharmacien (Le) | BERGER
- John R. – Du nouveau sous le soleil |McNEILL
- John – Et nos rivages mon coeur fugaces comme des photos | BERGER
- John – Fidèle au rendez-vous | BERGER
- John – Flamme et lilas | BERGER
- John – L’oiseau blanc | BERGER
- John – La cocadrille | BERGER
- John – Théorie générale et logique des automates | VON NEUMANN
- Jonathan – Don Creux est mort | BARANGER
- Jonathan – Le legs psycho-batave | BARANGER
- Jonathan – Le siècle de Hobbards | BARANGER
- Jonathan – Chokolov City | BARANGER
- Joseph – La bête ravissante en forme de loup | CHENERAILLE
- Joseph – Le grand ciel | CHENERAILLE
- José Javier Ruiz et DESCIMON Robert – Les ligueurs de l’exil | IBANEZ
- Joël – Les écrits de la souffrance | COSTE
- Joël – Un révolutionnaire ordinaire | CORNETTE
- Jude – Dialogues avec la Soeur | STÉFAN
- Jude – Dialogues des figures | STÉFAN
- Jude – L’angliciste | STÉFAN
- Jude – L’Idiot de village | STÉFAN
- Jude – La fête de la Patronne | STÉFAN
- Jude – Le nouvelliste | STÉFAN
- Jude – Le Sillographe | STÉFAN
- Jude – Les états du corps | STÉFAN
- Jude – Oraisons funestes |STÉFAN
- Jude – Scènes dernières | STÉFAN
- Jude – Vie de Saint | STÉFAN
- Julien – Paris | GREEN
- Julien – Au seuil de l’image|MILLY
- Julie – Russie : la République interdite|GRANDHAYE
- Jérémie – L’Etat à la lettre | FERRER-BARTOMEU
- Jérôme – Tenir le loup par les oreilles | SELLA
- Jérôme – Une res publica impériale en mutation | KENNEDY
- Jérôme – Le corps obèse | DARGENT
K
- Karine – Vitriol | SALOMÉ
- Karine – L’ouragan homicide | SALOMÉ
- Katia – Financer la guerre au XVIIe siècle | BEGUIN
- Katia – Les princes de Condé (réédition)|BEGUIN
- Katia – Les princes de Condé | BEGUIN
L
- L’art et l’État | THE LISTENER
- Lana – Henri IV | MARTYSHEVA
- Laurence – Marseille «capitale du crime»? | MONTEL
- Laurent – Le journal de Kikuko | PEIREIRE
- Laurent – Les récidivistes | NUNEZ
- Le Nouveau Recueil – n°34 – Toasts et tombeaux – mars/mai 1995
- Le Nouveau Recueil – n°35 – Écrire la voix – juin/août 1995
- Le Nouveau Recueil – n°36 – Sentiment paysage – septembre/novembre 1995
- Le Nouveau Recueil – n°37 – La Sainteté – décembre/février 1996
- Le Nouveau Recueil – n°38 – Récrire Réécrire – mars-mai 1996
- Le Nouveau Recueil – n°39 – La poésie dans la prose – juin-août 1996
- Le Nouveau Recueil – n°40 – La mémoire des musées – septembre-novembre 1996
- Le Nouveau Recueil – n°41 – Made in USA – décembre-février 1997
- Le Nouveau Recueil – n°42 – L’aveu – mars-mai 1997
- Le Nouveau Recueil – n°43 – Le théâtre dans l’esprit – juin-août 1997
- Le Nouveau Recueil – n°44 – Les mots de l’émotion – septembre-novembre 1997
- Le Nouveau Recueil – n°45 – Villes arabes – décembre-février 1998
- Le Nouveau Recueil – n°46 – Figures du poète – mars-mai 1998
- Le Nouveau Recueil – n°47 – L’excès – juin-août 1998
- Le Nouveau Recueil – n°48 – Exils – septembre-novembre 1998
- Le Nouveau Recueil – n°49 – L’usage du quotidien – décembre 1998/février 1999
- Le Nouveau Recueil – n°50 – Numéro anniversaire – mars/juin 1999
- Le Nouveau Recueil – n°51 – La Suisse d’ailleurs – juin-août 1999
- Le Nouveau Recueil – n°52 – D’un lyrisme critique – septembre/novembre 1999
- Le Nouveau Recueil – n°53 – Images et icônes – décembre 1999/février 2000
- Le Nouveau Recueil – n°54 – À la frontière – mars/mai 2000
- Le Nouveau Recueil – n°55 – Poèmes – juin/août 2000
- Le Nouveau Recueil – n°56 – Ce qui reste – septembre/novembre 2000
- Le Nouveau Recueil – n°57 – Pourquoi publier – décembre 2000/février 2001
- Le Nouveau Recueil – n°58 – La demeure – mars/mai 2001
- Le Nouveau Recueil – n°59 – Traduction en cours – juin/août 2001
- Le Nouveau Recueil – n°60 – Sous pseudo – septembre/novembre 2001
- Le Nouveau Recueil – n°61 – Films / Hantises – décembre 2001/février 2002
- Le Nouveau Recueil – n°62 – L’amour du livre – mars/mai 2002
- Le Nouveau Recueil – n°63 – Que peut la poésie ? – juin/août 2002
- Le Nouveau Recueil – n°64 – Au-delà du roman – septembre/novembre 2002
- Le Nouveau Recueil – n°65 – Courriers du coeur – décembre 2002/février 2003
- Le Nouveau Recueil – n°66 – Radio-graphies – mars/mai 2003
- Le Nouveau Recueil – n°67 – Rêver peut-être – juin/août 2003
- Le Nouveau Recueil – n°68 – Tous fous ? – septembre/novembre 2003
- Le Nouveau Recueil – n°69 – Encore l’amour ? – décembre 2003/février 2004
- Le Nouveau Recueil – n°70 – Pour les enfants – mars/mai 2004
- Le Nouveau Recueil – n°71 – Grèces – juin/août 2004
- Le Nouveau Recueil – n°72 – Encres de Chine – septembre/novembre 2004
- Le Nouveau Recueil – n°73 – Élégies d’aujourd’hui – décembre 2004/février 2005
- Le Nouveau Recueil – n°74 – La revue a vingt ans – mars/mai 2005
- Le Nouveau Recueil – n°75 – Sur le motif – juin/août 2005
- Le Nouveau Recueil – n°76 – La prose du roman – septembre/novembre 2005
- Le Nouveau Recueil – n°77 – XIXe Siècle – novembre 2005/février 2006
- Le Nouveau Recueil – n°78 – Écrits avec de la lumière – mars/mai 2006
- Le Nouveau Recueil – n°79 – Relais quatre fois sans maître – juin/août 2006
- Le Nouveau Recueil – n°80 – Le souci de la beauté – septembre/novembre 2006
- Le Nouveau Recueil – n°81 – Poésie italienne – décembre 2006/février 2007
- Le Nouveau Recueil – n°82 – Écritures de la pensée – mars/mai 2007
- Le Nouveau Recueil – n°83 – La poésie encore… – juin/août 2007
- Le Nouveau Recueil – n°84 – Énigme – septembre/novembre 2007
- Le Nouveau Recueil – n°85 – Lettres imaginaires – décembre 2007/février 2008
- Lettres d’amour | STENDHAL
- Line – Métamorphoses d’une ville | TEYSSEIRE-SALLMANN
- Louis – La vie souterraine |SIMONIN
- Loïc – L’esthétique verte|FEL
- Luc – Déluge | BOLTANSKI
- Luc – Poésie au grand jour | DECAUNES
- Ludovic – 69 vies de mon père | DEGROOTE
- Ludovic – Monologue | DEGROOTE
- Ludovic – Un petit viol | DEGROOTE
- Luisa – L’art des jardins sous le Second Empire|LIMIDO
- Léonard – Géographies | DAUPHANT
- Léonard – Le royaume des quatre rivières | DAUPHANT
- Léopold – La pêcheuse d’âme | SACHER-MASOCH
M
- Madeleine – Le bien des pauvres | FERRIÈRES
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 5 – America 2015
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 7 – La machine à gloire 2017
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 10 – Réseaux 2020
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 11 – L’art de la récup’ 2021
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 12 – «C’est la fête» 2022
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 13 – «Eurêka!» 2023
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 14 – Les étages de la vie 2024
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 1 – La femme auteur 2011
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 2 – Les choses 2012
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 3 – Quand la ville dort 2013
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 4 – Sexorama 2014
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 8 – Cosmopolis 2018
- Magasin du XIXe siècle (Le) – n° 9 – L’universel cabotinage 2019
- Marc – Louis-René des Forêts | COMINA
- Marie-Ange – Paroles fantomatiques et cryptes textuelles|DEPIERRE
- Marine – Don Quichotte à Versailles | ROUSSILLON
- Mario & Anne SAUVAGEOT (dir.) – Les cinq sens de la création | BORILLO
- Mario (dir.) – Dans l’atelier de l’art | BORILLO
- Marion – Les compagnons de Mercure | BRÉTÉCHÉ
- Marta – Comment la littérature pense les objets | CARAION
- Marta et BORLOZ Sophie-Valentine et LYON-CAEN Judith – Ecrire les choses | CARAION
- Marta – Usages de l’objet |CARAION
- Martine – Le siècle d’Irene | BOYER-WEINMANN
- Martine / Denis REYNAUD – Vestiaire de la littérature | BOYER-WEINMANN
- Martine – La relation biographique | BOYER-WEINMANN
- Martine – Vieillir dit-elle | BOYER-WEINMANN
- Mathieu – Le pouvoir marchand | MARRAUD
- Mathieu Le moment cybernétique | TRICLOT
- Mathilde – Vies d’hospice | ROSSIGNEUX-MEHEUST
- Matthieu – Le fils de Louis XIV | LAHAYE
- Maurice – Saint-Brieuc | LE LANNOU
- Maurice – Nabokov ou la cruauté du désir | COUTURIER
- Maurice – Roman et censure | COUTURIER
- Maxime – Écrire la judéité |DECOUT
- Maîtresse d’esthètes | WILLY [Jean de Tinan]
- Michael – La France vert clair |BESS
- Michel – Cherbourg | BESNIER
- Michel – Leipzig | BESNIER
- Michel et Bernard FELTZ et Marc CROMMELINCK (dir.) – Pourquoi la science ? | MEULDERS
- Michel – Brevets | DEGUY
- Michel – Francis Ponge | COLLOT
- Michel – Franck Sinatra monte au paradis | JOURDAIN
- Michel – L’homme qui achetait les rêves | ARRIVÉ
- Michel – La grande peur de 1610 | CASSAN
- Michel – Lautréamont | NATHAN
- Michel – La violence une histoire sociale | NASSIET
- Michel – La walkyrie et le professeur | ARRIVÉ
- Michel – Le comité | DEGUY
- Michel – Les Lilipputiens de la centralisation|BIARD
- Michel – Lettres mortes | JOURDAIN
- Michel – Un bel immeuble | ARRIVÉ
- Michel – Une petite ville au bord du désert | JOURDAIN
- Michel – Une très vieille petite fille | ARRIVÉ
- Michèle – Louis XIV et Vauban | VIROL
- Michèle – Saint-John Perse | AQUIEN
- Michèle – Vauban (réédition)|VIROL
- Michèle – Vauban | VIROL
- Mireille – Payer pour le roi | TOUZERY
- Mona – Comment faire un coquelicot avec une danseuse | THOMAS
- Mona – La chronique des choses | THOMAS
- Mona – Mon vis-à-vis | THOMAS
- Mona – Ton visage d’animal | THOMAS
- Murielle (dir.) – Cinéma et inconscient ¬ GAGNEBIN
- Murielle (dir.) – L’ombre de l’image|GAGNEBIN
- Murielle (dir.) – Les images parlantes|GAGNEBIN
- Murielle (dir.) – Yves Bonnefoy lumière et nuit des images|GAGNEBIN
- Murielle et Christine Savinel (dir.) – Starobinski en mouvement|GAGNEBIN
- Murielle et Julien MILLY (dir.) – L’affrontement et ses images|GAGNEBIN
- Murielle et Julien MILLY (dir.) – Les images honteuses|GAGNEBIN
- Murielle et Julien MILLY (dir.) – Les images limites|GAGNEBIN
- Murielle et Julien MILLY (dir.) – Michel de M’Uzan|GAGNEBIN
- Murielle et Suzanne LIANDRAT-GUIGUES (dir.) – L’essai et le cinéma|GAGNEBIN
- Murielle – Fascination de la laideur|GAGNEBIN
- Murielle – Les ensevelis vivants | GAGNEBIN
- Myriam – Ecclésiastiques en débauche | DENIEL-TERNANT
- Myriam – L’écrivain et la publicité | BOUCHARENC
- Myriam – Enquêtes sur l’identité de la «nation France» | YARDENI
- Mécislas – Lettres à Alexis | GOLBERG
- Mélanie – Le journal d’une reine | TRAVERSIER
- Méopold – La mère de Dieu | SACHER-MASOCH
N
- Nicolas / Raphaël Morera – À vos poubelles citoyens! | LYON-CAEN
- Nicolas – La faveur du roi (réédition) | LE ROUX
- Nicolas – Le crépuscule de la chevalerie | LE ROUX
- Nicolas – Le roi la cour l’État | LE ROUX
- Nicolas – Un professionnel des Lettres au XVIIe siècle| SCHAPIRA
- Nicole – Constance | DEBRAND
- Nicole – Louis XII : les dérèglements de l’image royale | HOCHNER
O
- Odile (dir.) – Composer le paysage |MARCEL
- Odile – Littoral : les aventures du Conservatoire du littoral|MARCEL
- Olivier – La juste couleur | BARBARANT
- Olivier – Un grand Instant | BARBARANT
- Olivier – Aragon | BARBARANT
- Olivier – Confesser sa foi | CHRISTIN
- Olivier – Douze lettres d’amour au soldat inconnu | BARBARANT
- Olivier – Essais de voix malgré le vent | BARBARANT
- Olivier – Je ne suis pas Victor Hugo | BARBARANT
- Olivier – Les Délices du feu | JANDOT
- Olivier – Les parquets du ciel | BARBARANT
- Olivier – Odes dérisoires | BARBARANT
- Olivier – Temps morts | BARBARANT
- Olivier – Élégies étranglées | BARBARANT
P
- Pascal – Dijon | COMMERE
- Pascal / Hervé DREVILLON / Pierre SERNA Croiser le fer (réédition)|BRIOIST
- Pascal et Hervé DREVILLON et Pierre SERNA – Croiser le fer | BRIOIST
- Pascale – Le petit Louis XV | MORMICHE
- Pascale – Le versant de la joie | BOUHÉNIC
- Pascal – L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle | BASTIEN
- Patrice et Marc DAMBRE (dir.) – Henri Thomas | BOUGON
- Patrick – Le maître de secret| DI MASCIO
- Paul-Montgomery – Matière et conscience | CHURCHLAND
- Paul -Rendre les armes | VO-HA
- Pauline – Epouses de ministres | FERRIER-VIAUD
- Pauline – Le goût de la joie | VALADE
- Pauline – Administrer les menus plaisirs du roi | LEMAIGRE-GAFFIER
- Paul Louis – Nantes | ROSSI
- Petr – Prague | KRAL
- Petr – Témoin des crépuscules | KRAL
- Philippe & Franck TINLAND & Alain-Marc RIEU – La techno-science en question | BRETON
- Philippe – L’unique et le véritable | MEYZIE
- Philippe – L’étrange colonel Rémy | KERRAND
- Philippe – Rouen | DELERM
- Philippe et CHOULET Philippe – La bonne école : I : Institution scolaire et contenus de savoir dans la civilisation industrielle | RIVIÈRE
- Philippe et CHOULET Philippe – La bonne école : II : Institution scolaire et contenus de savoir dans la civilisation industrielle | RIVIÈRE
- Philippe – François Augiéras | BERTHIER
- Philippe – Le virtuel : vertus et vertiges | QUEAU
- Philippe – Métaxu | QUEAU
- Philippe – Plomb des grives | AGARD
- Philippe – Typographes des Lumières | MINARD
- Philippe – Un livre d’argile | SELK
- Philippe – Éloge de la simulation | QUEAU
- Pierre (dir.) – La politique du rire |SERNA
- Pierre – Barcelone | LARTIGUE
- PIerre – Dictionnaire d’histoire critique des animaux | SERNA
- Pierre – Genève | GASCAR
- Pierre-Jean – Une guerre civile | SOURIAC
- Pierre – Lisbonne | KYRIA
- Pierre – Monsieur le Préfet | KARILA-COHEN
- Pierre-Robert – Versailles | LECLERCQ
- Pierre – Arthur Rimbaud ou l’éclatant désastre | BRUNEL
- Pierre – Arthur Rimbaud | BRUNEL
- Pierre – Cahiers d’enfrance | SANSOT
- Pierre – Gaston d’Orléans | GATULLE
- Pierre – L’omis | OUELLET
- Pierre – La France sensible | SANSOT
- Pierre – La république des girouettes|SERNA
Q
R
- Rafe – L’invention de la propriété privée | BLAUFARB
- Raymond | GUILLEVIC JEAN
- René-Louis – De la composition des paysages| DE GIRARDIN
- Revue Recueil – n°1 – Crise de l’amour de la langue ? – 1984
- Revue Recueil – n°2 – Le Natal – 1985
- Revue Recueil – n°3 – Le Soucis – 1986
- Revue Recueil – n°4/5 – Musique et littérature – 1986
- Revue Recueil – n°6 – Grammaire rhétorique – 1987
- Revue Recueil – n°7 – Le sentiment de la merveille – 1987
- Revue Recueil – n°8 – Les silences – 1988
- Revue Recueil – n°9 – 1988
- Revue Recueil – n°10 – La bêtise – 1988
- Revue Recueil – n°11 – 1989
- Revue Recueil – n°12 – Classicisme modernité – 1989
- Revue Recueil – n°13 – Documents sur la langue française – 1989
- Revue Recueil – n°14 – 1990
- Revue Recueil – n°15 – 1990
- Revue Recueil – n°16 – 1990
- Revue Recueil – n°17 – 1990
- Revue Recueil – n°18 – 1991
- Revue Recueil – n°19 – 1991
- Revue Recueil – n°20 – 1991
- Revue Recueil – n°21 – 1992
- Revue Recueil – n°22 – 1992
- Revue Recueil – n°23/24 – L’écrivain à la fin du siècle – 1992
- Revue Recueil – n°25 – 1992
- Revue Recueil – n°26 – 1993
- Revue Recueil – n°27 – Littérature et enseignement – 1993
- Revue Recueil – n°28 – septembre 1993
- Revue Recueil – n°29 – Des québécois parlent aux français – décembre 1993/janvier 1994
- Revue Recueil – n°30 – mars/mai 1994
- Revue Recueil – n°31 – Lectures d’écrivains – juin/août 1994
- Revue Recueil – n°32 – septembre/novembre 1994
- Revue Recueil – n°33 – décembre 1994/février 1995)
- Richard (dir.) – Pour saluer Robert Marteau | MILLET
- Richard – Beyrouth | MILLET
- Richard et Mary Ann CAWS (dir.) – Écrire le livre autour d’Edmond Jabès | STAMELMAN
- Richard – Le sentiment de la langue II | MILLET
- Richard – Le sentiment de la langue | MILLET
- Robert – Saisons | MARTEAU
- Robert – Ce que Corneille crie | MARTEAU
- Robert – Dans l’herbe | MARTEAU
- Robert – Des chevaux parmi les arbres | MARTEAU
- Robert – Eutopiques | DAMIEN
- Robert – Fragments de la France | MARTEAU
- Robert – La venue | MARTEAU
- Robert – Le jour qu’on a tué le cochon | MARTEAU
- Robert – Le Louvre entrouvert | MARTEAU
- Robert – Le message de Paul Cézanne | MARTEAU
- Robert – Le temps ordinaire | MARTEAU
- Robert – Liturgie | MARTEAU
- Robert – Louange | MARTEAU
- Robert – Registre | MARTEAU
- Robert – Rites et offrandes | MARTEAU
- Robert – Salve | MARTEAU
- Robert – Sur le motif | MARTEAU
- Robert – Voyage au verso | MARTEAU
- Robert – Écritures | MARTEAU
- Robert – Études pour une muse | MARTEAU
- Roger – Robert Marteau | PARISOT
- Roger – Stéphane Mallarmé | BELLET
- Romain / Solène Rivoal – Dernière frontière | GRANCHER
- Rosine – Une histoire des parfumeurs | LHEUREUX
- Rozenn – La honte et le châtiment | MILIN
- Régine – Icônes | DETAMBEL
- Régine – Émulsions | DETAMBEL
- Rémi – Défendre le roi | MASSON
- Rémi – Maréchal
S
- Sabine – L’invention des déchets urbains | BARLES
- Sabine – La ville délétère : Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain XVIIIe-XIXe siècles| BARLES
- Sabine – Le temps des ruines|FORERO-MENDOZA
- Serge – Jean Cocteau | LINARES
- Simon – Pleurons-les | PEREGO
- Société des études
- Sophie – Féerie | LOIZEAU
- Sophie – L’île du renard polaire de To Kirsikka | LOIZEAU
- Sophie – La prison à Paris au XVIIIe siècle | ABDELA
- Sophie – Ma maîtresse forme | LOIZEAU
- Sophie – Histoire des ordres et congrégations religieuses |HASQUENOPH
- Sophie – Les Français de Moscou et la Révolution russe | HASQUENOPH
- Sophie – Les Frondeuses | VERGNES
- Stanis – La santé de Louis XIV | PEREZ
- Steve – Pyrénées | HAGIMONT
- Stéphane – Le fait de vivre | BOUQUET
- Stéphane – Nicolas Desmaretz | GUERRE
- Stéphane – Une France en transition | FRIOUX (DIR.)
- Stéphane – Dans l’année de cet âge | BOUQUET
- Stéphane – Histoires verticales | GAL
- Stéphane – Le mot frère | BOUQUET
- Stéphane – Les amours suivants | BOUQUET
- Stéphane – Nos amériques | BOUQUET
- Stéphane – Un monde existe | BOUQUET
- Stéphane – Un peuple | BOUQUET
- Stéphane – Vie commune | BOUQUET
- Suzanne – Vies théâtrales | ROCHEFORT
- Sylvain-Karl – Louis XIV européen | GOSSELET
- Sylvain – Les héros du sport | DUFRAISSE
- Sylvie – Conjurer la dissension religieuse | DAUBRESSE
- Sébastien Le Prestre de – Oisivetés (Les) | VAUBAN
- Séverin – La guerre de Milan | DUC
T
- Thierry – Jura | HESSE
- Thierry – La vie aux sources | FOURNEAU
- Thierry – Le cimetière américain | HESSE
- Thierry – Les demeures du Soleil | SARMANT
- Théophile – Les vacances du lundi | GAUTIER
V
- Valérie – Les brigands et la Révolution | SOTTOCASA
- Vincent, Patrick BOUCHERON (dir.) – Le mot qui tue | AZOULAY
- Vincent – Policiers de Paris | DENIS
- Vincent – L’admirable police | MILLIOT
- Vincent – Une histoire de l’identité | DENIS
- Vincent — Un policier des Lumières | MILLIOT
- Violette – Histoire des zoos par les animaux | POUILLARD
- Virgile – La part de l’ombre | CIREFICE
- vous voilà! | DALISSON
- Véra – Liège | FEYDER
W
X
Y
- Yann – Les raisons de la haine | RODIER
- Yannick – Hors des décombres du monde | RUMPALA
- Yannick – Le Chancelier Séguier |NEXON
- Yann – Lyon et le Roi | LIGNEREUX
- Yoshio / FRIELING Dirk / HUNT John Dixon – Trois regards sur le paysage français|NAKAMURA
- Yves – Bénarès | VEQUAUD
- Yves – L’oeuvre et le produit | DEFORGE
- Yves – La bibliothèque de Belmont | PEYRÉ
- Yves – Le graphisme technique | DEFORGE
- Yves – À même les voix du jour | PEYRÉ
- Yvon – Le paysage romantique et l’expérience du sublime|LE SCANFF
É
- Élisabeth – Jouer autrefois | BELMAS
- Élisabeth – Venise : une invention de la ville XIIIe–XVe siècle | CROUZET-PAVAN
- Émile – Dix ans de bohême | GOUDEAU
- Émilie-Anne et Charles-François MATHIS – La ville végétale | PEPY
- Éric – La «Belle Juive» | FOURNIER
- Étienne – Ciné Plage | FAURE
- Étienne – Horizon du sol | FAURE
- Étienne – La vie bon train | FAURE
- Étienne – Légèrement frôlée |FAURE
- Étienne – Vues prenables | FAURE